Réponse de la GRC à la tuerie survenue en septembre 2022
Avertissement à propos du contenu
Cette page contient des détails sur la tuerie survenue sur le territoire de la Nation crie de James Smith et à Weldon, en Saskatchewan, le 4 septembre 2022. Le contenu peut être dérangeant pour certains lecteurs. Nous préférons vous en avertir.
À noter
Ce rapport d’examen interne a été préparé par des professionnels de l’application de la loi à l’intention d’autres professionnels de l’application de la loi. Par conséquent, le document n’est pas rédigé en langage courant et contient des mots et des termes propres au domaine policier qui ne sont pas couramment utilisés par le grand public. La GRC de la Saskatchewan publie le rapport dans sa forme originale et sans modifications afin de garantir la responsabilité et la transparence envers les personnes et les communautés qu’elle sert.
[CAVIARDÉ] apparaît lorsque des informations sensibles ont été soustraites conformément aux principes de la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Le 13 septembre 2022, la commissaire adjointe, Rhonda Blackmore, commandante divisionnaire de la GRC en Saskatchewan, a demandé au Bureau des normes et pratiques d’enquête de la GRC en Alberta de procéder à un examen approfondi et exhaustif de la réponse de la GRC à la tuerie survenue sur le territoire de la Nation crie de James Smith et à Weldon, en Saskatchewan, le 4 septembre 2022.
Le commissaire adjoint Blackmore s'est engagé à rendre publics le rapport et les réponses de la GRC de la Saskatchewan aux recommandations qui en découleront. Cette page contient le rapport.
Sur cette page
- Introduction
- Résumé
- Chronologie de l'incident
- Intervention initiale
- Structure de commandement
- Autres constatations à propos du commandement
- Service de l'air de la GRC
- Intervention du Groupe des crimes majeurs
- Communications stratégiques
- Communications opérationnelles
- Intervention visant un grand nombre de victimes
- Renseignement disponible avant lèincident
- Sommaire
- Tableau des recommandations
- Sommaire des pratiques exemplaires
- Annexe A - Lettre de mandat
- Annexe B - Lettre de réponse du BNPE
Renseignements sur les droits d’auteur
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la Gendarmerie royale du Canada, 2024
- ISBN 978-0-660-70749-5
- Numéro de catalogue PS64-221/2024F-PDF
Liste des graphiques
Liste des tableaux
Liste des acronymes et abréviations
- ACCP
- Association canadienne des chefs de police
- APU
- centre national des opérations
- ARM
- agents des relations avec les médias
- ASPS
- Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan
- ATAK
- Trousse de connaissance de la situation tactique de l’équipe pour Android
- BNPE
- Bureau des normes et des pratiques d’enquête
- BTEC
- l’équipement nécessaire à la prestation de soins de base en traumatologie
- CDOU
- Centre divisionnaire des opérations d’urgence
- CEJ
- Centre d’évaluation judiciaire
- CI
- commandant des interventions
- CIC
- commandant des interventions critiques
- CIIDS
- l’entremise du Système intégré de répartition de l’information
- CLCC
- Commission des libérations conditionnelles du Canada
- CMEN
- Comité mixte d’enquête national
- CNO
- centre national des opérations
- COTR
- Centre des opérations en temps réel
- COU
- Centre des opérations d’urgence
- CTSP
- Centres téléphoniques de sécurité publique
- DCAS
- Section divisionnaire des analyses criminelles
- DG
- Direction générale
- DRAI
- Déploiement rapide pour action immédiate
- DVRS
- système de répéteur numérique pour véhicule
- ECT
- entente communautaire tripartite
- EEMR
- Équipe d’exécution des mandats et de répression
- EGDN
- Équipe de gestion du district du Nord
- EGS
- Équipe de gestion supérieure
- EIALS
- Équipe d’intervention en matière d’application de la loi de la Saskatchewan
- EIIG
- intervention en cas d’incident grave
- ENSC
- Équipe de négociation en situation de crise
- EPI
- Équipe de protection et d’intervention
- ERC
- Équipe de réduction de la criminalité
- FNAS
- Fédération des nations autochtones souveraines
- GCG
- gestion des cas graves
- GCM
- Groupe des crimes majeurs
- GRC
- Gendarmerie royale du Canada
- GSCDG
- Groupe des sciences du comportement, Direction générale
- GSV
- Groupe des services aux victimes
- GTI
- Groupe tactique d’intervention
- ICIR
- Intervention initiale en situation de crise
- IFAK
- trousse de premiers soins personnelle
- MOC
- mode opératoire commun
- MPCI
- Modèle de programme correctionnel intégré
- MRSM
- Module de rapport de situation et de messagerie
- NCJS
- Nation crie de James Smith
- OAB
- Or-Argent-Bronze
- OREC
- officier responsable des enquêtes criminelles
- OVT
- officier de vol tactique
- PAMTS
- Programme d’analyse morphologique des taches de sang
- PAPS
- Prince Albert Police Service
- PCI
- poste de commandement d’incident
- PIC
- Programme des incidents critiques
- PTM
- poste de travail mobile
- RPTSC
- Réseau provincial de télécommunications de sécurité publique
- RPTSP
- Réseau provincial de télécommunications de sécurité publique
- SCC
- Service correctionnel du Canada
- SCI
- Système de commandement en cas d’incident
- SDAC
- Section divisionnaire des analyses criminelles
- SDSA
- Sous-direction nationale du service de l’air
- SDSO
- Service divisionnaire des stratégies opérationnelles
- SEG
- Section des enquêtes générales
- SGD
- Système de gestion des dossiers
- SIIJ
- Service intégré de l’identité judiciaire
- SIJ
- Service de l’identité judiciaire
- SIRP
- Système d’incidents et de rapports de police
- SMU
- services médicaux d’urgence
- SNLJ
- Services nationaux de laboratoire judiciaire
- SPA
- Services de police autochtones
- SPR
- Service de police de Regina
- SPS
- Service de police de Saskatoon
- SRRJ
- Système de récupération de renseignements judiciaires
- SSOM
- Services de soutien opérationnel aux membres
- STO
- Station de transmissions opérationnelles
- TTC
- tours de télécommunications mobiles
Introduction
Par suite de l'incident tragique survenu le 4 septembre 2022 dans les collectivités de la Nation crie de James Smith (NCJS) et de Weldon, en Saskatchewan, la commandante de la Division F, la commissaire adjointe Rhonda Blackmore (commissaire adjointe Blackmore) a lancé un examen interne de l'intervention de la GRC lors de l'incident. Par l'entremise de l'évaluation d'objectifs précis, l'examen permettrait de déterminer si la GRC avait adopté les leçons apprises et les recommandations découlant d'incidents ayant fait un grand nombre de victimes survenus par le passé; d'établir si l'intervention de la GRC lors de l'incident en cause était efficace; et de cerner et de formuler des recommandations aux fins d'améliorations.
Les politiques de la GRC, plus précisément celles de la Division F, imposent un seuil pour déterminer si un examen interne est requis pour la vaste gamme d’incidents pouvant survenir dans un contexte policier. Le 13 septembre 2022, la commissaire adjointe Blackmore a lancé le processus de recommandation d’un examen en envoyant une lettre de mandat (voir l’annexe A) aux Enquêtes criminelles de la Division K qui énonçait des objectifs précis. Le 28 septembre 2022, le Bureau des normes et des pratiques d’enquête (BNPE) de la Division K à Edmonton a été chargé de réaliser un examen objectif et exhaustif portant principalement sur l’intervention de la GRC, en mettant l’accent sur l’appel de service initial, les structures de commandement utilisées, les alertes publiques, les relations avec les médias, les communications opérationnelles, le soutien offert aux victimes, les politiques globales et le renseignement disponible avant l’incident (voir l’annexe B).
Équipe d’examen
Après avoir été chargé de mener l’examen, le BNPE devait commencer par former une équipe de conseillers en la matière, qui contribueraient à l’examen. On a eu recours aux principes de Gestion des cas graves tout au long du processus d’enquête; la première étape consistait toutefois à créer un triangle de commandement pour l’équipe d’enquête. Le triangle de commandement a rapidement pris la décision de faire appel à des ressources d’enquête de l’extérieur de la Division F et d’obtenir de l’aide auprès de partenaires municipaux. Des membres de l’équipe ont été sélectionnés à l’échelle nationale, selon leur expertise et les objectifs cernés. L’équipe d’enquête intégrale était formée des membres suivants :
- Officier hiérarchique :
- Surintendant principal Kevin Kunetzki, Enquêtes criminelles, Division K
- Chef d’équipe :
- Sergent d’état-major Ryan Breitkreuz, Bureau des normes et des pratiques d’enquête de la Division K
- Enquêteur principal :
- Sergent Jeff Mulroy, Bureau des normes et des pratiques d’enquête de la Division K
- Coordonnatrice des dossiers :
- Sergente Candace Robinson, Bureau des normes et des pratiques d’enquête de la Division K
Conseillers en matière d’enquête :
- Sergent Kevin Misiwich, Bureau des normes et des pratiques d’enquête de la Division K
- Surintendant Gord Corbett, Division K
- Surintendant Scott McMurchy, Division D
- Inspecteur Shawn Pike, Service de police de Winnipeg
- Inspecteur Chris Boucher, Direction générale
- Sergent d’état-major Chris Johnson, Division D
- Sergent d’état-major Dean Grunow, Division K
- Sergent d’état-major Bryce Long, Division K
- Sergent d’état-major Cory Francis, Service de police de Winnipeg
- Sergent d’état-major Clint Grabowski, Service de police de Calgary
- Sergent d’état-major Bill Krull, Service de police d’Edmonton
- Sergente Carolyn Arsenault, Division D
- Sergent Chris Massart, Division D
- Sergent Pat Frey, Division K
- Sergente Katherine Severson, Service de police de Calgary
- Sergente Amberia Sovdi, Division E
- Sergent Jackson Bernard, Direction générale
- Sergent Aaron Ewert, Division K
- Gendarme Vernon Hagen, Division K
- Rob Cyrenne, Division D
- Fraser Logan, Division K
- Steve Cox, Division K
- Heather Russell, Division F
- Soutien à la gestion des cas graves : Michelle Hounsell, Division F
Observateur indépendant
Un observateur indépendant a été intégré à l’examen afin d’assurer la liaison avec la collectivité de la NCJS et de fournir une orientation sur le plan culturel à l’équipe d’examen. Jason Stonechild, l’observateur indépendant, est directeur général de la justice de la Fédération des nations autochtones souveraines (FNAS) et chef de police adjoint à la retraite du Service de police de Prince Albert. Il a joué un rôle essentiel pour établir des liens avec les membres de la collectivité de la NCJS et pour veiller à ce que toute communication soit appropriée sur le plan culturel et adaptée à leurs besoins, à ce moment-là. M. Stonechild a été invité à participer à toutes les séances d’information et a été en mesure de consulter toute l’information fournie à l’équipe d’examen.
Commentaires de l’observateur indépendant
À la suite de l’incident tragique survenu le 4 septembre 2022 dans les collectivités des Premières Nations de James Smith, de Chakastaypasin et de Peter Chapman et la collectivité de Weldon, en Saskatchewan, la commissaire adjointe Rhonda Blackmore (commissaire adjointe Blackmore) a ordonné un examen approfondi et exhaustif de l’intervention de la GRC lors de cet incident. L’examen avait pour but d’assurer la transparence et la responsabilisation à l’appui des efforts déployés par la GRC pour maintenir la confiance du public.
D’abord, je tiens à m’adresser aux peuples des trois Nations de James Smith : j’ai été témoin d’une force incroyable manifestée par vos peuples. Les Premières Nations sont résilientes, car elles ont dû s’adapter aux traumatismes vécus au fil du temps. Nos Nations sont en situation de crise, et nos peuples ont besoin d’intervenants du système judiciaire en qui nous avons confiance et qui font preuve de compassion à l’égard des traumatismes historiques et perpétuels subis par les Premières Nations.
Le recours à un observateur civil indépendant relativement à un examen du genre est une pratique unique. Des examens de ce type, surtout des examens à l’endroit d’incidents importants comme la tragédie survenue dans la Nation crie de James Smith, pourraient soulever de nombreux exemples de réussites, mais pourraient également révéler des erreurs potentielles. Ces examens sont réalisés par des équipes externes ne relevant pas du groupe visé par l’enquête, qui sont habituellement uniquement formées de professionnels du domaine policier. L’ajout d’une surveillance civile représentant toutes les Premières Nations dans la province de la Saskatchewan était une fidèle démonstration de l’engagement de la GRC de la Saskatchewan envers la réconciliation, par l’inclusion et la transparence. Je félicite la commissaire adjointe Blackmore pour son leadership et son intérêt réel à collaborer avec les Premières Nations pour régler bon nombre d’enjeux en matière de justice qui touchent nos peuples.
J’exprime les opinions suivantes par rapport à l’examen :
- L’équipe formée aux fins de l’examen était professionnelle, très compétente, impartiale et travaillait en collaboration en vue d’obtenir les meilleurs résultats.
- L’examen comprenait des consultations d’intervenants externes qui étaient appropriées et qui représentaient les intérêts des collectivités.
- Les préoccupations des collectivités relativement à l’intervention de la GRC ont été examinées et comprises dans les constatations de l’équipe.
- Je suis convaincu que la GRC, sous la direction de la commissaire adjointe Blackmore, a un intérêt réel envers les questions de bien-être des Premières Nations.
- Je suis d’avis que les constatations du présent rapport sont pertinentes et exactes.
Je souhaite reconnaître le professionnalisme et la compétence des membres de l’équipe, notamment le surintendant principal Kevin Kunetzki, l’inspecteur Ryan Breitkreuz, le sergent Jeff Mulroy et la sergente Candace Robinson. Leur expertise et leur dévouement ont permis de réaliser l’examen avec compassion et rigueur. Je remercie chacun d’entre vous de l’inclusion et du traitement respectueux dont j’ai été témoin tout au long du processus.
Je suis très fier d’être au service de nos peuples et des dirigeants des Premières Nations. La Fédération des nations autochtones souveraines (FNAS) est une organisation solide qui protège les droits inhérents et issus des traités des Premières Nations par l’établissement de relations de collaboration, la défense des intérêts et le soutien des peuples des Premières Nations. Je tiens à reconnaître la participation du chef Bobby Cameron et du vice-chef Edward Lerat (direction du portefeuille de la justice), en plus de celle des chefs généraux de la FNAS, qui ont entièrement appuyé nos efforts relatifs l’examen et nos efforts à l’appui des collectivités de James Smith, de Chakastaypasin et de Peter Chapman. Sans le soutien des chefs, mon rôle d’observateur civil n’aurait pas été possible.
Je suis honoré d’avoir eu le privilège de participer à l’examen, et j’espère sincèrement que les constatations qui en découlent contribueront à la sécurité et au bien-être des collectivités des Premières Nations et des collectivités non autochtones pour l’avenir et aideront la GRC dans ses efforts visant à maintenir la confiance des gens qu’elle sert.
Ekosi; c’est tout!
Kinanâskomitin; merci.
Objet de l’examen
La façon la plus claire de définir ce qu’englobe l’examen est peut-être de soulever non seulement ce en quoi il consiste, mais également de préciser ce en quoi il ne consiste pas. L’objectif de l’examen n’est pas de réaliser une vérification judiciaire de l’enquête, mais plutôt de faire ressortir des constatations par rapport à l’intervention de la GRC lors de l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon, de décrire ce qui a été efficace, de soulever les améliorations à apporter et de formuler des recommandations réalistes et pertinentes accompagnées de justifications à l’appui.
Il s’agit d’un examen interne assorti d’objectifs précis qui diffère de processus d’examen plus médiatisés (comme ceux énoncés ci-dessous) qui ont déjà été lancés, ou pourraient l’être à l’avenir.
Enquête du coroner
Le 22 septembre 2022, le coroner en chef de la Saskatchewan a annoncé qu’une enquête sur les 11 décès serait lancée dans le but d’examiner les circonstances de chaque homicide. Bien qu’aucune date n’ait été fixée pour l’enquête du coroner, le coroner en chef a mentionné qu’elle serait seulement réalisée après l’achèvement de l’enquête de la police.
Enquête de l’Équipe d’intervention en cas d’incident grave de la Saskatchewan
L’Équipe d’intervention en cas d’incident grave (EIIG) de la Saskatchewan est un groupe civil indépendant chargé de faire enquête sur des incidents graves impliquant des policiers en Saskatchewan. Une enquête est réalisée lorsqu’une personne subit des blessures graves ou décède pendant qu’elle est sous garde policière ou comme suite à des mesures prises par un policier
L’EIIG réalise une enquête distincte qui vise à examiner le décès du suspect alors qu’il était sous garde. L’enquête est en cours.
Examen du Service correctionnel du Canada
Le Service correctionnel du Canada (SCC) et la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) ont convoqué un Comité mixte d’enquête national sur la libération d’office, la surveillance dans la collectivité et les décisions de la CLCC par rapport au dossier du suspect. L’enquête sera orientée par les exigences prévues par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition dans le but d’examiner et d’analyser l’ensemble des faits et des circonstances de l’affaire; de déterminer si les lois, les politiques et les protocoles ont été respectés; et de formuler des recommandations et de prendre des mesures correctives, le cas échéant. La date de diffusion des résultats de l’enquête du Comité mixte d’enquête national n’est pas encore connue.
Enquête publique
Pour l’instant, une enquête publique sur l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon n’a pas été demandée, mais il s’agit tout de même d’une possibilité, donc une courte explication sera fournie. Une enquête publique est un processus indépendant officiel conçu pour examiner des enjeux ou des incidents ayant eu de graves répercussions sur le public . Les enquêtes publiques ont pour objectif d’étudier pleinement et objectivement des enjeux d’importance nationale et sont dirigées par des experts ou des juges ayant le pouvoir d’assigner des témoins à comparaître, de recevoir des dépositions sous serment et de réclamer des documents. Une enquête publique permet également d’examiner les détails de l’enquête, afin de mieux rendre compte des gestes des contrevenants. Les constatations et les recommandations qui découlent d’une enquête publique ont une incidence considérable sur l’opinion du public et l’orientation des politiques publiques.
Au moment de la rédaction du présent document, on ignore encore si une enquête publique sera ordonnée dans le but d’évaluer l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon.
Objectifs de l’examen et méthodologie
L’équipe d’examen s’est rendue en Saskatchewan pendant la semaine du 17 au 21 octobre 2022 afin de réaliser des entrevues auprès des principaux participants à l’intervention de la GRC. Au cours de la semaine, plus de 60 membres de la GRC, y compris hauts dirigeants, membres de groupes spécialisés, membres premiers arrivés sur les lieux, responsables des relations avec les médias et opérateurs des télécommunications, ont été interrogés et ont fourni des renseignements quant au rôle qu’ils ont joué lors de l’intervention. Même si la participation n’était pas obligatoire, toutes les personnes à qui on a demandé de fournir des commentaires ont collaboré pleinement.
L’objectif des entretiens était de bien comprendre ce qui s’était produit, de reconnaître les situations où des améliorations sont requises et d’élaborer conjointement des recommandations réalisables.
Avant le début de l’examen, l’objectif initial était de consigner les constatations pour chaque objectif séparément. Toutefois, à mesure que l’enquête progressait, il est vite devenu évident que très peu de choses se sont produites de manière isolée, ce qui rendait pratiquement impossible la tâche de décrire en détail chaque objectif indépendamment des autres. Orientés par les renseignements qu’ils recueillaient, les membres de l’équipe d’examen ont rapidement constaté, étant donné la nature dynamique et évolutive de l’incident dans son ensemble, de nombreux chevauchements et recoupements de renseignements dans les diverses sections du rapport. Ainsi, les constatations sont présentées de la façon suivante afin de rendre compte des objectifs établis de manière optimale.
La méthodologie employée pour la production du rapport comprenait une analyse des renseignements obtenus lors des entrevues menées dans le cadre de l’examen, y compris tout suivi subséquent. En outre, les renseignements et les rapports sur l’incident ont été versés dans le Système d’incidents et de rapports de police (SIRP) par les membres de la GRC ayant participé à l’intervention. Dans le cadre de l’examen, l’équipe d’examen a obtenu l’accès au dossier du SIRP, ce qui lui a permis de faire des renvois à des renseignements et à des documents pertinents dans le but de mieux illustrer le contexte, au besoin. Il est important de souligner que l’examen n’était ni exhaustif ni complet. Toutefois, il a été réalisé de manière à tirer des conclusions ciblées sur le plan stratégique et des recommandations utiles.
Les domaines suivants ont été reconnus comme les éléments les plus importants de l’intervention à l’échelle divisionnaire et nationale et seront approfondis tout au long du document :
- Intervention initiale
- Structure de commandement
- Intervention du Groupe des crimes majeurs
- Service de l’air
- Communications stratégiques;
- Communications opérationnelles
- Intervention visant un grand nombre de victimes
- Renseignement disponible avant l’incident
Incidents survenus par le passé
Les examens de cette nature ne sont pas rares. La triste réalité est qu’ils découlent d’incidents tragiques ayant de profondes répercussions. Bien qu’une évaluation de l’intervention de la GRC lors d’un incident du genre soit inévitable, elle permet également de répondre à une question encore plus importante, c’est-à-dire de savoir si la GRC a tiré des leçons des incidents du passé et a adopté les recommandations formulées comme suite à ces incidents.
Des examens nationaux portant sur d’autres incidents ayant fait un grand nombre de victimes, notamment le rapport MacNeil, qui présente une évaluation des événements survenus le 4 juin 2014 à Moncton (Nouveau Brunswick), lorsque trois membres de la GRC ont été tués, ont été considérés. Les recommandations liées à l’incident sont surlignées en rouge dans le présent document.
Une enquête publique dirigée par la Commission des pertes massives, visant l’incident survenu en 2020 à Portapique (Nouvelle Écosse) lors duquel 22 personnes ont été assassinées, a été conclue à la fin de 2022. Les recommandations définitives de la Commission des pertes massives ont été publiées le 31 mars 2023. Toutefois, étant donné l’ampleur du rapport final de la Commission des pertes massives et la date de production du présent rapport, des liens avec les recommandations pertinentes du rapport final n’ont pas pu être établis en détail dans le présent document. Cela dit, l’équipe d’examen avait accès aux « documents fondamentaux » de la Commission des pertes massives, ce qui lui a permis d’obtenir, en quelque sorte, un aperçu des constatations de la Commission des pertes massives.
Point de vue de la collectivité
Comme suite à la recommandation de l’observateur indépendant, on a sollicité la participation des résidents de la NCJS et de Weldon et cherché à obtenir des commentaires et à échanger sur leurs observations de l’intervention de la GRC lors de l’incident, qui a profondément touché leur collectivité. La mobilisation de la collectivité est devenue essentielle pour comprendre les liens entre la GRC et les collectivités et pour savoir comment favoriser de manière optimale l’esprit des services de police communautaires à l’avenir.
Pour ce faire, des entrevues avec les membres de la collectivité de la NCJS ont été organisées, en consultation directe avec l’observateur indépendant et en collaboration avec des représentants du conseil de bande de la NCJS et des Aînés locaux. Ces entretiens ont eu lieu à Edmonton du 23 au 25 novembre 2022. Des mesures ont été prises pour minimiser le risque de traumatiser de nouveau les membres de la collectivité. D’une manière similaire, le 10 janvier 2023, des membres de l’équipe d’examen se sont rendus à Weldon pour mener des entrevues avec un échantillon représentatif des membres de la collectivité.
Ces entrevues ont permis aux résidents des deux collectivités de faire part de leurs préoccupations ou de leurs observations directement en lien avec l’intervention de la GRC dans leur collectivité lors de l’incident. L’intervention de la GRC a été appréciée dans son ensemble; toutefois, des éléments à améliorer ont été soulevés.
En ce qui concerne la NCJS précisément, au début du processus d’examen, on a appris que la collectivité est formée de trois bandes : Peter Chapman (chef Robert Head), Chakastaypasin (chef Calvin Sanderson) et James Smith (chef Wally Burns). Aux fins du présent rapport, la Nation crie de James Smith (NCJS) désignera l’endroit où s’est produit l’incident du 4 septembre. Toutefois, nous reconnaissons que la tragédie a fait des victimes au sein des trois bandes.
Résumé
Résumé de l’incident
Très tôt le matin du 4 septembre 2022, le Détachement de la GRC de Melfort a commencé à recevoir de multiples signalements d’agressions au couteau dans la Nation crie de James Smith (NCJS), située dans le Nord de la Saskatchewan, et plus tard, à Weldon. Peu de temps après l’appel initial, on s’est rendu compte que la situation se transformait en événement majeur, et que la GRC devait maintenant gérer un incident faisant un grand nombre de victimes. Une chasse à l’homme à l’échelle de la province a duré trois jours et s’est terminée par l’arrestation du suspect, à quelque 140 km au sud-ouest de la NCJS. Dans le cadre de l’incident, onze personnes ont été assassinées et dix-sept autres ont été blessées, ce qui représente l’une des pires tueries dans l’histoire du Canada.
Immédiatement à la conclusion de l’incident, la commandante divisionnaire, la commissaire adjointe Rhonda Blackmore (commissaire adjointe Blackmore) a lancé un processus visant à examiner l’intervention de la GRC lors de l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon. Le présent rapport est le fruit de ce processus.
Intervention globale de la GRC
L’intervention de la GRC lors de l’incident ayant fait un grand nombre de victimes a exigé que des mesures soient prises dans le cadre d’une situation complexe. Lorsque l’ampleur de la situation qui dégénérait est devenue évidente, une alerte publique initiale a été diffusée, dans le but d’informer le public de la situation et de les inciter à se mettre à l’abri. Treize autres alertes publiques ont été diffusées au cours de l’incident.
Pendant les jours qui ont suivi l’incident, plus de 500 membres de la GRC de tous les secteurs d’activité sont intervenus. Des partenaires municipaux et provinciaux ont été mobilisés pour appuyer les efforts déployés aux fins de diverses fonctions d’intervention, notamment le soutien aux familles des victimes, l’aide aux efforts d’arrestation, le traitement de plus de 40 scènes de crime ayant produit plus de 700 pièces à conviction et la réalisation d’une enquête criminelle.
Des membres sensibilisés à la culture, travaillant aux Services de police autochtones de la GRC de la Division F ou ailleurs, ont été mobilisés et affectés à des secteurs clés, ce qui a permis d’assurer une communication constante entre les intervenants clés et la GRC et de fournir de plus amples renseignements aux membres qui intervenaient quant à une conduite appropriée sur le plan culturel à adopter.
Étant donné les circonstances, de nombreux niveaux de la structure de commandement de la GRC ont été activés; divers ordres du gouvernement ont été mobilisés; la Fédération des nations autochtones souveraines (FNAS) a prêté main-forte; et les intérêts nationaux ont été mis de l’avant.
Constatations générales
De façon générale, l’équipe d’examen n’a pas soulevé de circonstances sous-jacentes ayant considérablement nui à la capacité de la GRC à gérer l’intervention lors de l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon. Cependant, certains éléments à améliorer ont été cernés dans le but sous-jacent de renforcer les interventions futures lors d’incidents similaires.
Tout au long du document, les recommandations formulées pour remédier à ces lacunes ou à d’autres lacunes cernées apparaîtront en surbrillance et italiques, à mesure qu’elles sont soulevées. Une liste complète des recommandations se trouve à la fin du présent document.
En plus de lacunes organisationnelles, l’examen soulève des mesures efficaces qui ont été abordées; elles seront désignées comme pratiques exemplaires aux fins d’interventions futures.
Principaux éléments à améliorer
- Établissement d’une structure de commandement lors d’événements majeurs
- Amélioration des relations avec la collectivité
- Réalisation d’évaluations des risques exhaustives
- Correction des lacunes en matière de communication et d’analyse relativement au tri d’un volume élevé de renseignements reçus
- Amélioration du Centre des opérations d’urgence de la Division
- Amélioration de la couverture radio de la police et de l’interopérabilité
Principales pratiques exemplaires
- Communication efficace de renseignements pertinents au public
- Réalisation d’exercices sur table avec les hauts dirigeants
- Délégation des tâches
- Mise en place rapide de rôles de soutien aux victimes
- Intégration de ressources appropriées sur le plan culturel à des postes clés pour assurer une communication constante et des pratiques adaptées à la culture
- Manifestation générale de relations solides avec la haute direction et de relations de travail solides avec des partenaires externes et les autres divisions de la GRC
Conclusion
La GRC est de plus en plus confrontée à la gestion d’événements critiques complexes. En Saskatchewan seulement, depuis plusieurs années, la GRC a dû intervenir dans le cadre de plusieurs incidents tragiques. Lors d’une fusillade dans une école de La Loche en 2016, quatre personnes ont été tuées, et sept autres, blessées. L’accident d’autobus des Broncos de Humboldt en 2018 a fait seize morts et treize blessés. Bien que les circonstances entourant ces incidents soient uniques, dans les faits, chacun a exigé une intervention policière exhaustive et coordonnée. Étant donné la fréquence à laquelle se produisent ces incidents critiques, il s’avère nécessaire de tout mettre en œuvre pour faire ressortir des pratiques exemplaires et des leçons apprises de l’intervention, afin d’améliorer la capacité de la GRC à cet égard.
Dans la foulée de l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon, un examen du déroulement de l’incident et des processus employés par la GRC permet de souligner les points forts, d’exposer les faiblesses et de cerner les difficultés. Une évaluation de cette nature qui est réalisée de manière méthodique et réfléchie peut entraîner d’importants changements dans les interventions policières lors d’incidents faisant un grand nombre de victimes et d’autres événements majeurs semblables. On espère que les constatations de l’examen susciteront des discussions à l’échelle régionale et nationale relativement aux politiques et aux mesures tactiques à adopter pendant ces incidents.
Prochaines étapes
Le présent rapport est remis à la commandante de la Division F à des fins d’examen et sera diffusé, au besoin. Bien que bon nombre des recommandations fournies visent précisément les politiques et les procédures de la Division F, l’examen a également pour but de veiller à ce que la GRC à l’échelle nationale considère les constatations et les leçons apprises. Certaines des recommandations énoncées dans le présent rapport peuvent être mises en œuvre assez facilement, tandis que d’autres exigeront davantage de temps et de collaboration.
Chronologie de l’incident
Dans le but d’établir un contexte pour les diverses sections du présent document, ce qui suit résume les déplacements du suspect, à partir du moment où il est arrivé dans la Nation crie de James Smith (NCJS) le 1 septembre, jusqu’à son arrestation le 7 septembre.
Comme il est décrit ci-dessous, Myles Sanderson (le suspect) s’est seulement rendu dans la NCJS quelques jours avant l’incident du 4 septembre, et il s’est enfui peu de temps après avoir commis de nombreux meurtres et de nombreuses tentatives de meurtre dans la NCJS et à Weldon. Une partie de l’enquête réalisée par le Groupe des crimes majeurs (GCM) sur les incidents consistait à déterminer les déplacements et les échanges du suspect dans les jours qui ont précédé l’incident, afin de mieux comprendre ce qui avait précipité un tel drame. À mesure que des renseignements étaient recueillis auprès de témoins et de connaissances, il est devenu évident que le suspect avait été impliqué dans de nombreux incidents survenus avant le 4 septembre, dont plusieurs qui sont dignes de mention.
L’enquête du GCM comprenait le tracé analytique d’incidents connus, organisés en séquences temporelles, afin de fournir un compte rendu général des activités du suspect dans les jours qui ont précédé l’incident du 4 septembre et les jours qui ont suivi, jusqu’à son arrestation, le 7 septembre. Malgré tous les efforts déployés, il y a encore des périodes pendant lesquelles nous disposons de peu d’information, voire aucune, permettant de confirmer les déplacements précis ou la chronologie des faits, car une grande partie de l’information a été recueillie auprès des témoins, et les moments exacts auxquels se sont produits les incidents étaient inconnus.
Diverses cartes sont comprises dans la chronologie et ont été créées dans le cadre de l’examen afin de clarifier certains éléments pour le lecteur et pour illustrer des moments et des lieux clés, selon l’information tirée de la chronologie de l’incident fournie par le GCM.
1 septembre
Myles Sanderson (le suspect) est arrivé dans la NCJS le 1 septembre avec [CAVIARDÉ] et leurs quatre enfants. Pendant ce temps, ils ont été logés chez Damien Sanderson (Damien) et [CAVIARDÉ].
2 septembre
Dans l’après-midi du 2 septembre, le suspect a eu une altercation physique [CAVIARDÉ]. Il l’a agressée et a tenté de lui rouler dessus avec une voiture, à l’extérieur de la résidence de Damien [CAVIARDÉ]. Comme suite à cet incident, [CAVIARDÉ] est retournée chez elle, à Saskatoon. Cet incident a seulement été signalé à la police après la perpétration des homicides. Le suspect est demeuré dans la NCJS avec son frère Damien. Plus tard ce soir-là, les deux frères ont pris le véhicule de Skye et sont allés se promener dans la NCJS pour vendre de la cocaïne.
3 septembre
À un moment donné (vers minuit le 2 septembre), le suspect et Damien se sont rendus à la résidence de [CAVIARDÉ]. [CAVIARDÉ] Damien se sont battus. Le suspect et Damien ont quitté la demeure et, au moyen du véhicule de [CAVIARDÉ], ils ont fini par se rendre à la [CAVIARDÉ], chemin North à un moment donné au petit matin du 3 septembre.
À 4 h 3, le 3 septembre, [CAVIARDÉ] a signalé à la police que son véhicule avait été volé par son [CAVIARDÉ], Damien. Pendant que les membres du Détachement de la GRC de Melfort (GRC de Melfort) se rendaient dans la NCJS, l’un d’eux a effectué une recherche sur Damien à partir de son poste de travail mobile et a trouvé une photo de lui. Les membres se sont familiarisés avec la photo afin d’être en mesure de reconnaître le suspect s’ils le croisaient. Les membres étaient également au courant que Damien était recherché en vertu de mandats d’arrestation non exécutés.
Les membres de la GRC de Melfort ont vu le véhicule de [CAVIARDÉ] à la [CAVIARDÉ] à 5 h 35. Lorsqu’ils sont arrivés à la résidence, ils pouvaient entendre de la musique forte qui provenait d’une autocaravane voisine. Ils ont vérifié dans l’autocaravane pour déterminer si Damien s’y trouvait avant de se rendre à la [CAVIARDÉ]. Deux hommes, qui semblaient très intoxiqués, ont été retrouvés dans l’autocaravane. Les hommes ont fourni leur nom aux policiers, mais on ne leur a pas demandé de fournir de cartes d’identité, car ni l’un ni l’autre ne correspondait à la description de Damien.
Les membres de la GRC se sont ensuite rendus à la [CAVIARDÉ], la personne qui se trouvait à la résidence. [CAVIARDÉ] a informé les membres que Damien n’y était pas. Elle ne savait pas où il se trouvait ni comment le véhicule de [CAVIARDÉ] était arrivé à sa résidence. Les membres sont entrés dans la résidence pour tenter de trouver Damien. Ils ont trouvé plusieurs personnes, dont trois hommes qui ne correspondaient pas à la description de Damien. Les clés du véhicule de [CAVIARDÉ] ont été retrouvées sur la table de la cuisine et ont été remises à [CAVIARDÉ], qui s’est rendue à la résidence après avoir été informée par la police que son véhicule avait été retrouvé.
Les membres de la GRC de Melfort ont quitté la [CAVIARDÉ] et ont continué à chercher Damien dans la NCJS, en se rendant à des lieux où il aurait pu se trouver, d’après les renseignements fournis par [CAVIARDÉ]. Les membres ont parlé à [CAVIARDÉ] à plusieurs reprises ce matin-là (entre huit et dix fois, on croit), et [CAVIARDÉ] n’a pas mentionné que Damien était avec une autre personne lorsqu’il a pris son véhicule : Myles Sanderson, le suspect, n’a été mentionné à aucun moment lors de ces échanges.
Au courant de la journée, Damien et le suspect se sont rendus à Kinisinto pour aller chercher de la nourriture et sont revenus dans la NCJS, où ils ont fait des allées et venues entre diverses résidences. Vers 17 h, le suspect et Damien se sont rendus à la résidence de [CAVIARDÉ], au [CAVIARDÉ], et pendant qu’ils étaient là, le suspect a mentionné qu’il « y était pour un corps » en faisant référence [CAVIARDÉ]. [CAVIARDÉ] a fini par se présenter à la résidence et a été agressé par le suspect. Aucun dossier n’indique que cet incident a été signalé à la police avant la perpétration des homicides.
Après l’agression, Damien s’est rendu au Kinistino Bar avec [CAVIARDÉ]. Pendant qu’il était au bar, Damien a fait un commentaire à [CAVIARDÉ], en mentionnant que lui et le suspect « avaient une mission à accomplir ». Damien a fini par se faire déposer à la résidence de [CAVIARDÉ]. On ne sait pas où se trouvait le suspect à ce moment ci.
Vers 23 h, [CAVIARDÉ] est retourné chez lui et a trouvé le suspect qui était assis sur les marches de l’escalier extérieur de sa maison, au [CAVIARDÉ], avenue Edward Burns. Le suspect a quitté les lieux en disant qu’il partait à la recherche de Damien. Les deux frères ont fini par se retrouver et sont arrivés à la résidence de [CAVIARDÉ]. Pendant qu’ils y étaient, ils ont agressé physiquement [CAVIARDÉ] avant de quitter la résidence pour se rendre à la demeure de [CAVIARDÉ], où ils sont restés jusqu’au petit matin du 4 septembre.
4 septembre
Vers 2 h, le suspect et Damien se sont rendus à la résidence de [CAVIARDÉ], ont pris sa Dodge Caravan grise et sont allés vendre de la cocaïne pendant un certain temps. Ils sont ensuite revenus à la résidence de [CAVIARDÉ]. Vers 4 h 45, le suspect et Damien étaient à la résidence de [CAVIARDÉ], et des témoins ont dit qu’ils « buvaient de l’alcool à grandes gorgées pour se motiver », avant de repartir à bord de la Dodge Caravan grise.
Vers 5 h 30, le suspect et Damien sont entrés dans la résidence de [CAVIARDÉ].
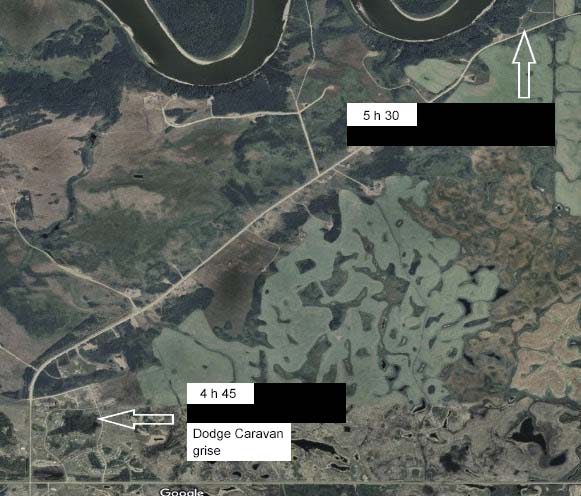
Description de l'image
Carte de la Nation crie de James Smith décrivant l’endroit où le suspect et Damien Sanderson se trouvaient et la distance physique qu’ils ont parcourue entre 4 h 45 et 5 h 30 le 4 septembre 2022. Une flèche pointe vers le [CAVIARDÉ] et une flèche pointe vers le [CAVIARDÉ] d’où est partie la Dodge Caravan grise.
Après avoir cherché [CAVIARDÉ], Damien a dit à [CAVIARDÉ] ce serait la dernière fois qu’elle le verrait. Damien a pris le téléphone cellulaire de [CAVIARDÉ] et a quitté la résidence en compagnie du suspect. À partir de ce moment-là, on croit que le suspect et Damien se seraient rendus au [CAVIARDÉ], chemin North, toujours à bord de la Dodge Caravan grise.
[CAVIARDÉ], chemin North
Vers 5 h 40, le suspect et Damien sont entrés dans la résidence située au [CAVIARDÉ], chemin North et ont provoqué une altercation avec le propriétaire, [CAVIARDÉ]. Le suspect a tenté d’agresser au couteau et de tuer [CAVIARDÉ], après quoi Damien serait intervenu. [CAVIARDÉ] a reçu des coups de couteau non mortels avant le départ des deux frères. Cette altercation a mené à l’appel de service initial à la GRC en lien avec les incidents qui étaient sur le point de se produire. En outre, on s’est servi des renseignements de la plainte initiale pour lancer la première alerte publique, dans laquelle le suspect et Damien étaient identifiés comme les auteurs d’une série de crimes violents.
Après leur départ à bord de la Dodge Caravan grise, le suspect a poignardé Damien à plusieurs reprises alors qu’ils étaient à l’intérieur du véhicule. Damien a été en mesure de sortir de la minifourgonnette et de s’éloigner de la route, où il a fini par succomber à ses blessures. Toutefois, le corps de Damien a seulement été découvert le lendemain (le 5 septembre) à 11 h 25.
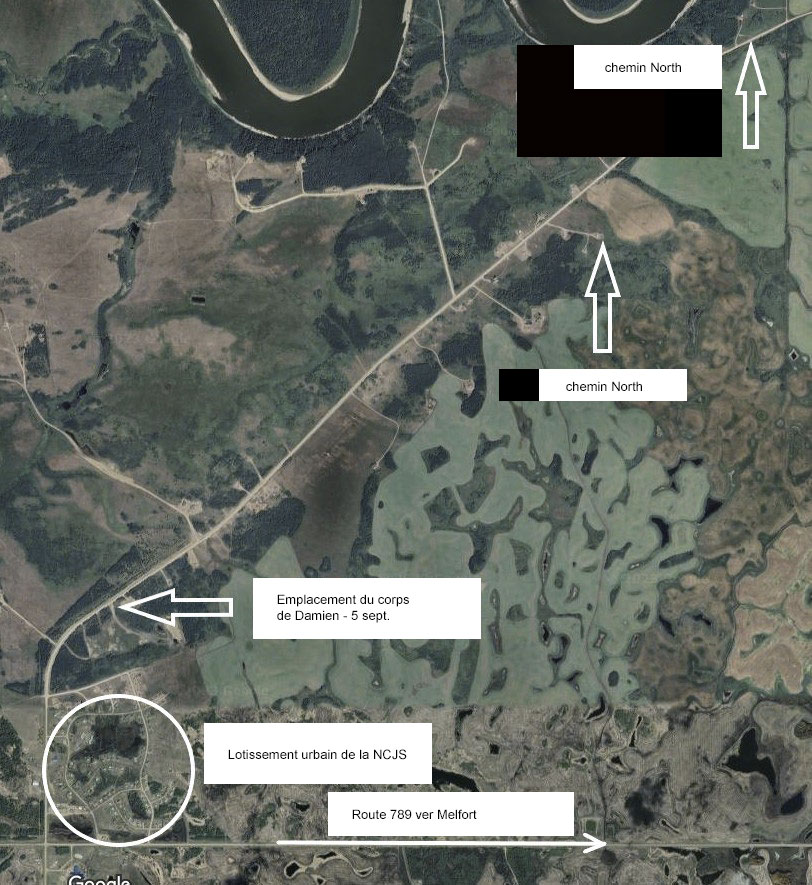
Description de l'image
Carte de la Nation crie de James Smith montrant l’emplacement de la résidence du [CAVIARDÉ], chemin North où se trouvaient le suspect et Damien, et l’emplacement où le corps de Damien a été retrouvé le 5 septembre. Une flèche pointe vers le [CAVIARDÉ], chemin North qui est la résidence de Skye Sanderson, une flèche pointe vers le [CAVIARDÉ], chemin North, une flèche pointe vers l’emplacement où le corps de Damien a été trouvé, le village de la Nation crie de James Smith est encerclé et l’emplacement de la route 789 vers Melfort est indiqué.
[CAVIARDÉ], chemin New York
Après l’homicide de Damien (Homicide 1) , d’autres agressions au couteau ont été signalées peu de temps après 6 h, à la [CAVIARDÉ], sur le chemin New York, situé à quelque 12 km au sud-est de la résidence visée par l’appel de service initial [CAVIARDÉ]. Au volant de la Dodge Caravan grise, le suspect a foncé dans la [CAVIARDÉ], et après y être entré, a poignardé [CAVIARDÉ] à plusieurs reprises avant de partir à pied vers la résidence de [CAVIARDÉ], c’est-à-dire la [CAVIARDÉ]. [CAVIARDÉ] ont été trouvés morts (Homicide 2, Homicide 3 et Homicide 4) , et [CAVIARDÉ], blessés. Il s’agit du premier lieu où des membres de la GRC de Melfort se sont rendus, vers 6 h 23. Le suspect a pris la Ford F350 blanche de [CAVIARDÉ] qui se trouvait à la [CAVIARDÉ] et a quitté les lieux.
![Carte de la Nation crie de James Smith montrant les emplacements de deux résidences fréquentées par le suspect, la [CAVIARDÉ] et la [CAVIARDÉ].](/sites/default/files/img/jscn-review-003-fra.jpg)
Description de l'image
Carte de la Nation crie de James Smith montrant les emplacements de deux résidences fréquentées par le suspect. Une flèche pointe vers la [CAVIARDÉ], une flèche pointe vers la [CAVIARDÉ], le lotissement urbain de la Nation crie de James Smith est encerclé, et les emplacements des chemins School House et New York sont notés.
[CAVIARDÉ], avenue Edward Burns
À partir du chemin New York, le suspect a pris la route vers le nord, en se dirigeant vers le « lotissement urbain » de la NCJS (à quelque 6 km) et a fini par s’arrêter au [CAVIARDÉ], avenue Edward Burns, où il a attaqué et blessé [CAVIARDÉ], vers 6 h 14. Il a ensuite abandonné la Ford F-350 blanche et s’est dirigé vers le nord à pied, pour se rendre à une résidence voisine, au [CAVIARDÉ], avenue Edward Burns, où il a poignardé et tué [CAVIARDÉ] (Homicide 5) et blessé [CAVIARDÉ].
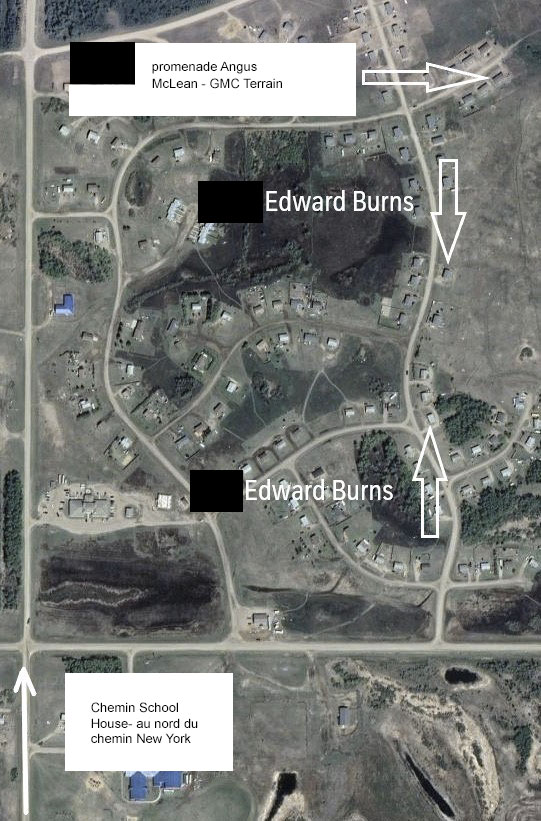
Description de l'image
Carte de la Nation crie de James Smith illustrant l’emplacement des résidences fréquentées par le suspect. Une flèche pointe vers le [CAVIARDÉ], promenade Angus McLean où la GCM Terrain blanche a été volée, une flèche pointe vers le [CAVIARDÉ], avenue Edward Burns, une flèche pointe vers le [CAVIARDÉ], avenue Edward Burns, et l’emplacement du chemin School House en direction du nord à partir du chemin New York est noté.
[CAVIARDÉ], chemin North
Le suspect est demeuré dans ce secteur à pied, puis a volé une GMC Terrain blanche qui se trouvait au [CAVIARDÉ], promenade Angus McLean. À 6 h 19, il avait conduit le véhicule jusqu’au [CAVIARDÉ], chemin North (dans le secteur où s’était produite l’agression initiale, à 5 h 40). C’est à cet endroit que le suspect a attaqué [CAVIARDÉ], au moyen d’un couteau. Le suspect a poignardé [CAVIARDÉ] à plusieurs reprises. Pour sa part, [CAVIARDÉ] a reçu des coups non mortels. Le suspect et [CAVIARDÉ] ont quitté les lieux chacun au volant de leur propre véhicule : le suspect à bord de la GMC Terrain blanche, et [CAVIARDÉ] à bord d’un autobus scolaire. [CAVIARDÉ] a fini par succomber à ses blessures et a plus tard été retrouvé mort (Homicide 6) dans l’autobus scolaire, à quelque 2,5 km au sud-ouest de sa résidence.
![Carte de la Nation crie de James Smith montrant l’emplacement du [CAVIARDÉ], chemin North et l’endroit où se trouvait l’autobus scolaire.](/sites/default/files/img/jscn-review-005-fra.jpg)
Description de l'image
Carte de la Nation crie de James Smith montrant l’emplacement du [CAVIARDÉ], chemin North et l’emplacement où les enquêteurs ont trouvé l’autobus scolaire. Une flèche pointe vers le [CAVIARDÉ], chemin North, une flèche pointe vers l’emplacement où l’autobus scolaire a été trouvé, et le lotissement urbain de la Nation crie de James Smith est encerclé.
C’est environ à ce moment-ci (6 h 20) que les deux premiers membres de la GRC sont arrivés dans la NCJS et ont entrepris le processus de déterminer l’ampleur de la situation (nombre de victimes et de lieux), en se fondant sur les appels de service déjà reçus et la gravité des blessures des victimes. Les membres de la GRC se sont d’abord rendus au [CAVIARDÉ], chemin New York, car ils croyaient qu’il s’agissait du lieu où était survenu le premier homicide. Comme il a déjà été mentionné, on croit que Damien aurait été la première victime de meurtre; toutefois, à ce moment-là, la GRC ne savait pas qu’il était mort et son corps n’avait pas encore été découvert. Un membre de la GRC est demeuré au [CAVIARDÉ], chemin New York, et l’autre s’est dirigé vers le nord (à quelque 10 km), pour se rendre au lieu de l’appel de service initial, à la résidence de [CAVIARDÉ], située au [CAVIARDÉ], chemin North. Le membre y est arrivé à 6 h 32.
[CAVIARDÉ], rue Abel McLeod
Après avoir réalisé une évaluation au [CAVIARDÉ], chemin North, le membre de la GRC s’est dirigé vers le sud (lotissement urbain), au [CAVIARDÉ], rue Abel McLeod (à quelque 5,5 km), car deux autres décès avaient été signalés à cet endroit. À son arrivée, le membre a trouvé [CAVIARDÉ] assassinés (Homicide 7 et Homicide 8), ainsi que [CAVIARDÉ] blessés. Pendant qu’il se dirigeait vers le [CAVIARDÉ], rue Abel McLeod, le membre de la GRC a croisé l’autobus scolaire qu’avait conduit [CAVIARDÉ] et qui se trouvait maintenant dans le fossé. Il ignorait toutefois à ce moment-là [CAVIARDÉ] était décédé. Le corps [CAVIARDÉ] a seulement été découvert à 8 h 28 ce jour-là.
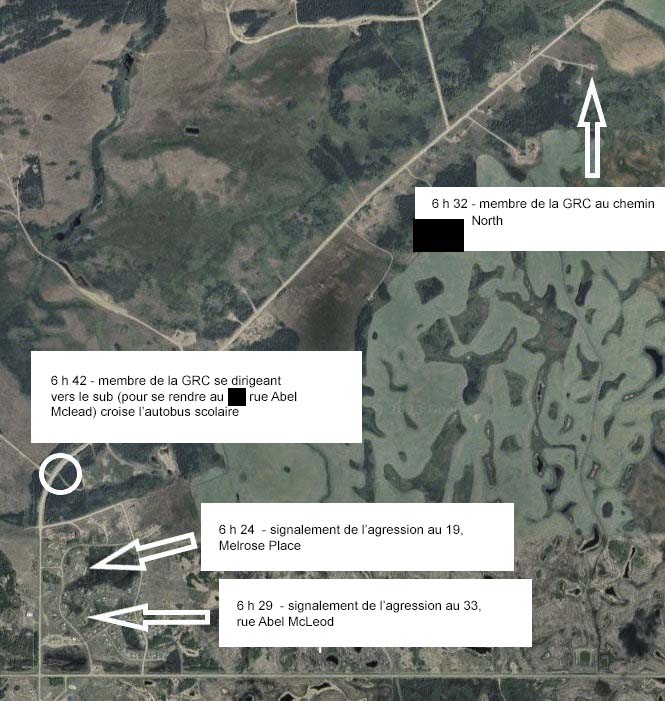
Description de l'image
Carte de la Nation crie de James Smith montrant les emplacements de plusieurs résidences où des attaques ont été signalées et les emplacements où la GRC est intervenue entre 6 h 24 et 6 h 42. Une flèche indique le [CAVIARDÉ], Melrose Place où une attaque a été signalée à 6 h 24, une flèche indique le [CAVIARDÉ], rue Abel McLeod où une attaque a été signalée à 6 h 29, et une flèche indique le [CAVIARDÉ], chemin North où la GRC est intervenue à 6 h 32, et une flèche pointe vers l’emplacement où la GRC a croisé l’autobus scolaire à 6 h 42 en allant répondre au signalement au [CAVIARDÉ], rue Abel McLeod.

[CAVIARDÉ], Melrose Place
Avant que le membre de la GRC se rende au [CAVIARDÉ], rue Abel McLeod, le suspect avait abandonné la GMC Terrain blanche et s’était dirigé vers le nord à pied, jusqu’au [CAVIARDÉ], Melrose Place, où il a attaqué et blessé [CAVIARDÉ].
À ce moment-ci, on ne sait pas si le suspect savait que des membres de la GRC étaient arrivés dans la NCJS; les membres étaient appelés à se rendre à des endroits qui ne se trouvaient pas à proximité immédiate du suspect.
Le suspect est demeuré dans le lotissement urbain à pied, puis s’est rendu au [CAVIARDÉ], Angus McLean, où il a blessé [CAVIARDÉ], et ensuite à la résidence de sa mère, au [CAVIARDÉ], Melrose Place, puis au [CAVIARDÉ], allée George Burns, où il a attaqué et blessé [CAVIARDÉ], avant de voler leur Dodge Caravan rouge.
Retour au [CAVIARDÉ], avenue Edward Burns
Après avoir abandonné la Dodge Caravan rouge, le suspect est retourné au [CAVIARDÉ], avenue Edward Burns, où il avait déjà tué sa 5 victime [CAVIARDÉ]. Il a alors assassiné [CAVIARDÉ] (Homicide 9 et Homicide 10) avant de se déplacer à pied et de s’introduire par effraction dans une résidence voisine, au [CAVIARDÉ], rue Abel McLeod, où il a volé la Nissan Rogue noire de [CAVIARDÉ].

Description de l'image
Carte de la Nation crie de James Smith montrant les emplacements de deux résidences fréquentées par le suspect et l’emplacement de la Dodge Caravan rouge abandonnée. Une flèche pointe vers le [CAVIARDÉ], rue Abel McLeod où la Nissan Rogue noire a été volée, une flèche pointe vers le [CAVIARDÉ], avenue Edward Burns où le suspect est retourné, et une flèche pointe vers l’emplacement de la Dodge Caravan rouge abandonnée.
Pendant ce temps, le membre de la GRC était arrivé au [CAVIARDÉ], rue Abel McLeod puis avait remarqué la GMC Terrain blanche. Le membre qui intervenait croyait qu’il s’agissait encore du véhicule à bord duquel le suspect se déplaçait; il ne savait pas qu’il se trouvait maintenant à bord d’une Nissan Rogue noire, à quelques maisons au nord de cet endroit. Étant donné la proximité des deux résidences, il est possible que le suspect ait vu la voiture de patrouille de la GRC et qu’il s’agisse de la première fois où le suspect ait été mis au courant de la présence de la GRC dans la NCJS, ce qui pourrait avoir entraîné son départ de la collectivité.

Description de l'image
Carte de la Nation crie de James Smith illustrant la distance entre les résidences fréquentées par le suspect et l’emplacement des membres de la GRC qui sont intervenus. L’emplacement du [CAVIARDÉ], rue Abel McLeod est encerclé et l’emplacement du [CAVIARDÉ], rue Abel McLeod est encerclé, où la GRC s’est rendue à 6 h 43.

Le suspect quitte les lieux en direction sud – chemin School House
Le suspect, toujours à bord de la Nissan Rogue noire, a quitté les lieux en direction sud et s’est rendu à environ 3 km du lotissement urbain de la NCJS, au [CAVIARDÉ], chemin School House, où il a blessé [CAVIARDÉ].
De Kinistino jusqu’au [CAVIARDÉ], à Weldon
À 7 h, des signalements ont été reçus selon lesquels le suspect était arrivé à Kinistino, à quelque 27 km au sud-ouest de la NCJS, à la recherche d’essence. Le suspect a ensuite roulé 12 km vers l’ouest et est arrivé à Weldon. À 7 h 10, il s’est introduit par effraction dans la résidence au [CAVIARDÉ], où il a tué sa dernière victime, [CAVIARDÉ] (Homicide 11).
![Carte du lotissement urbain de Weldon avec une flèche pointant vers le [CAVIARDÉ], rue Central à Weldon. L’emplacement de la route no 682 à partir de Kinistino est indiqué.](/sites/default/files/img/jscn-review-011-fra.jpg)
À 7 h 12, la première de plusieurs alertes publiques a été diffusée par la GRC, laquelle informait le public des agressions au couteau dans la NCJS et demandait aux résidents de se mettre à l’abri.
Après son dernier meurtre, le suspect a été vu à divers endroits à Weldon, alors qu’il fouillait dans des véhicules et qu’il demandait de l’aide auprès de membres de la collectivité en disant qu’il avait été poignardé. Selon des témoins, le suspect était couvert de sang. À 7 h 24, la Nissan Rogue noire a été vue sur caméra vidéo en train de se déplacer vers le sud, vraisemblablement pour sortir de Weldon.
À 7 h 57, une deuxième alerte publique a été diffusée : le nom et la description physique du suspect ont été fournis, ainsi que la description du véhicule présumé qu’il conduisait.
Signalements du suspect aperçu sur la route 41
Entre 16 h et 20 h 8, on a reçu un grand nombre de signalements de gens ayant vu un suspect seul (Myles Sanderson) près de la route 41, entre Melfort et Wakaw. À ce moment-là, Damien avait déjà été tué, mais son corps allait seulement être découvert le lendemain. L’un des plaignants connaissait le suspect personnellement en raison de liens familiaux. Le Détachement de la GRC de Wakaw a donné suite aux signalements, mais n’a pas été en mesure de retrouver ni le suspect ni la Nissan Rogue noire.
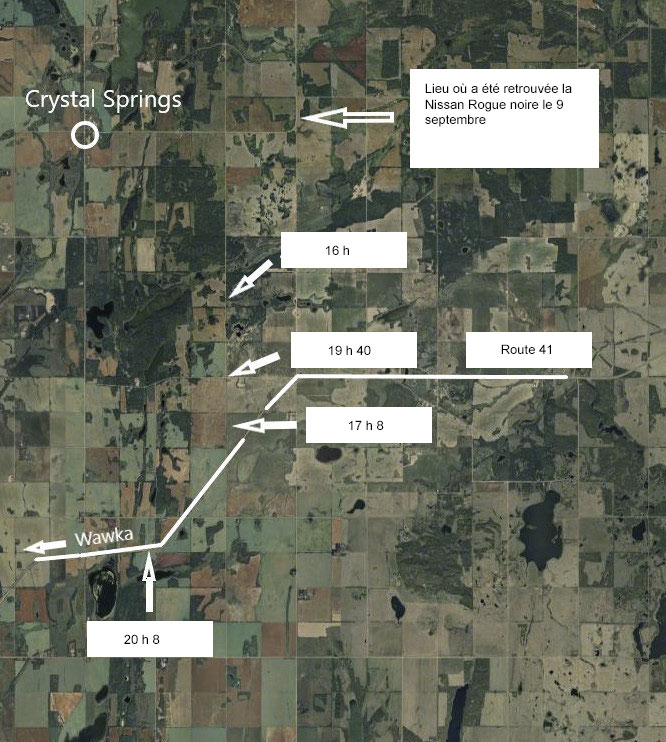
Description de l'image
Carte décrivant la région de Crystal Springs/route 41 et indiquant les emplacements où le suspect a été vu et où la Nissan Rogue noire a été retrouvée. Crystal Springs est encerclé, une flèche indique l’endroit où le suspect a été vu à 16 h, une flèche indique l’endroit où le suspect a été vu à 19 h 40, une flèche indique l’endroit où le suspect a été vu à 17 h 08, une flèche indique l’endroit où le suspect a été vu à 20 h 08, une flèche indique la direction de Wawka et une flèche indique le lieu où a été retrouvée la Nissan Rogue noire le 9 septembre.
7 septembre
Secteur de Crystal Springs
À 14 h 6, [CAVIARDÉ] a téléphoné au 911 pour signaler une introduction par effraction dans sa résidence, située près de Crystal Springs, et le vol de sa Chevrolet Avalanche blanche.
Première Nation de One Arrow
Vers 14 h 40, [CAVIARDÉ] a signalé que le suspect se trouvait à sa résidence, située au [CAVIARDÉ], Première Nation de One Arrow. Le suspect était à l’extérieur de la résidence et demandait qu’on le conduise jusqu’à la ville. [CAVIARDÉ] a dit au suspect que sa camionnette ne fonctionnait pas et l’a observé partir à grande vitesse à bord de la Chevrolet Avalanche blanche, en se dirigeant vers l’ouest.
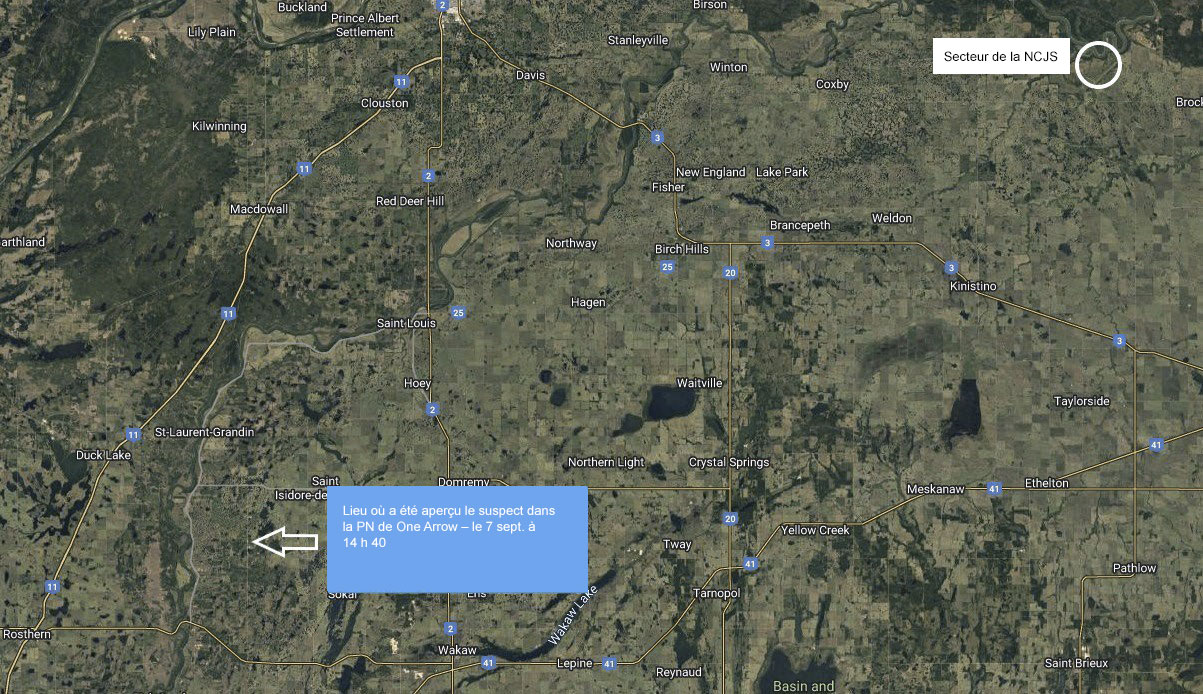
À 15 h 17, un véhicule de police banalisé a repéré la Chevrolet Avalanche blanche, qui roulait en direction ouest sur la route 312, vers Rosthern. Le suspect a fini par se rendre compte qu’il avait été repéré et a commencé à fuir la police; une poursuite s’est ensuivie. Le véhicule du suspect roulait vers le sud dans la voie en direction nord de la route 11 (vers Saskatoon), jusqu’à ce que la GRC force la Chevrolet Avalanche blanche à quitter la route, au sud de Rosthern, à 15 h 32.
Le suspect a été arrêté et s’est immédiatement retrouvé en état de détresse médicale. Les services médicaux d’urgence ont transporté le suspect à l’hôpital de Saskatoon à 15 h 51. Toutefois, le décès du suspect a été prononcé à 16 h 38, malgré les efforts déployés pour le réanimer.
Intervention initiale
Avant d’examiner toute intervention ayant fait suite à l’appel initial ou aux appels initiaux dans le cadre de l’incident survenu dans la Nation crie de James Smith (NCJS) et à Weldon, il convient de donner un aperçu du Détachement de la GRC de Melfort, des collectivités touchées et du processus de répartition des appels au 911, afin de replacer la situation dans son contexte.
C’est le Détachement de la GRC de Melfort qui assure le maintien de l’ordre dans les collectivités de la NCJS et de Weldon. La NCJS est située à environ 45 km au nord-ouest de Melfort, a une population d’environ 1 800 personnes et s’étend sur une superficie d’environ 150 km carrés. Weldon, pour sa part, est un petit village d’environ 200 personnes situé à 42 km au nord-ouest de Melfort.
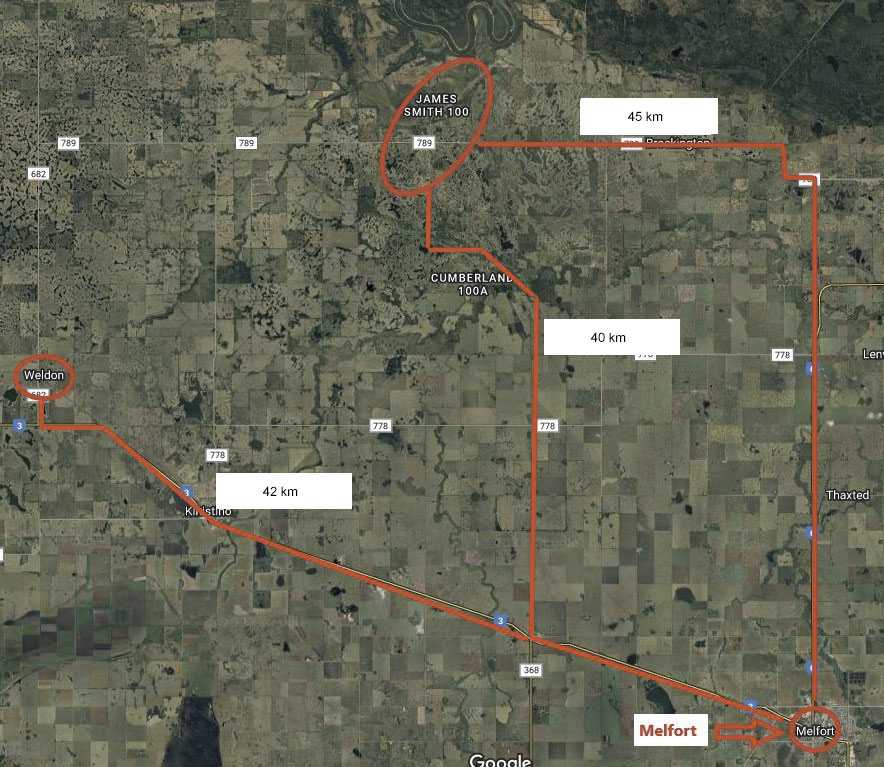
Description de l'image
Carte du territoire desservi par le Détachement de la GRC de Melfort, illustrant la distance entre Melfort, Weldon et la Nation crie de James Smith. La distance entre Melfort et la Nation crie de James Smith est de 40 à 45 kilomètres, selon l’itinéraire emprunté. La distance entre Melfort et Weldon est de 42 kilomètres.
Lorsque son effectif est complet, le Détachement de la GRC de Melfort compte seize policiers en uniforme. Le Détachement est dirigé par un sergent d’état-major et compte deux caporaux et treize gendarmes. Onze des gendarmes travaillent aux Services généraux, un gendarme est affecté à un poste réservé aux Premières Nations et un gendarme est affecté aux services de liaison avec les tribunaux. Le Détachement de Tisdale se trouve à environ 40 km à l’est de Melfort et son horaire de quarts de travail est fusionné avec celui du Détachement de Melfort. L’effectif complet du Détachement de Tisdale compte huit policiers en uniforme, dont un sergent, un caporal et six gendarmes.
Le jour de l’incident ayant fait un grand nombre de victimes dans la NCJS/à Weldon, il y avait treize membres opérationnels au Détachement de Melfort et six au Détachement de Tisdale..
[CAVIARDÉ]
Comme il sera expliqué plus loin dans la présente section, lors de l’appel de service initial en provenance de la NCJS, un membre du quart de jour était « en disponibilité » (mais il était au bureau), et un autre membre avait été désigné pour lui servir de renfort (il était chez lui) (chapitre 16.9 du MO de la GRC, Renforts).
Dans un effort visant à obtenir des ressources additionnelles durant l’intervention menée en réponse à l’incident, un appel à l’Équipe de protection et d’intervention (EPI) a été lancé par l’entremise du gouvernement de la Saskatchewan. Un certain nombre d’agents de conservation et de membres de la Patrouille routière de la Saskatchewan qui se trouvaient dans les environs ont répondu à l’appel.
L’EPI du gouvernement de la Saskatchewan a été créée en 2017 en tant qu’initiative visant à réduire la criminalité dans les zones rurales de la province. Le programme fait appel à des membres de la Patrouille routière et à des agents de conservation dotés de pouvoirs élargis qui travaillent avec la GRC et les services de police municipaux de la province dans le but d’améliorer l’intervention de la police lors d’appels de service urgents.
Appels au 911
L’Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan (ASPS) fournit un accès aux services d’urgence du 911 dans toute la province par l’entremise du système Sask911. Des opérateurs formés aux services du 911 reçoivent les appels destinés à la police, aux services d’incendie, aux services de sauvetage et aux services médicaux d’urgence. Après avoir déterminé la nature de l’urgence, ils transfèrent l’appel à un répartiteur des appels d’urgence.
En Saskatchewan, les appels au 911 se rendent aux Centres téléphoniques de sécurité publique (CTSP) situés à Regina, à Saskatoon et à Prince Albert. Les appels au 911 qui proviennent de l’extérieur des frontières municipales de Saskatoon et de Regina sont dirigés vers Prince Albert.
C’est le CTSP de Prince Albert qui a d’abord reçu les appels au 911 liés à l’incident ayant fait un grand nombre de victimes dans la NCJS/à Weldon. Après une évaluation initiale visant à déterminer si ces appels relevaient des services de police, des services d’incendie ou des services médicaux d’urgence (SMU), ils ont été transférés à la Station de transmissions opérationnelles (STO) de la Division, puisqu’il s’agissait d’une affaire concernant la police. Cette question est examinée plus en profondeur dans la section Communications opérationnelles du présent rapport.
Mesures tactiques et intervention lors de l’appel initial
Généralement, on fait appel à la police dans des situations qui sont soit sous contrôle (c’est-à-dire qu’il n’y a plus de menace pour la sécurité du public ou des policiers), soit en cours (c’est-à-dire que l’information dont on dispose est limitée et qu’il y a un danger imminent pour les membres du public et/ou les policiers). Le type de situation dictera si les mesures à prendre par les membres qui interviennent au départ relèvent davantage de l’enquête ou de la démarche tactique.
En ce qui concerne l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon, la STO a d’abord communiqué avec le gendarme Tanner Maynard (gendarme Maynard), du Détachement de Melfort, vers 5 h 44; il était déjà au Détachement, car il avait été appelé plus tôt à s’y rendre dans le cadre d’un incident non connexe. Le premier plaignant a signalé que le suspect et son frère étaient entrés par effraction chez lui et l’avaient poignardé, lui infligeant des blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger. Le suspect et son frère étaient ensuite repartis dans une direction inconnue.
Après la répartition, et conformément aux politiques, le gendarme Maynard a immédiatement appelé le membre qui avait été désigné pour lui servir de renfort, le gendarme Dave Miller (gendarme Miller). Lorsque le gendarme Miller est arrivé au Détachement, le gendarme Maynard l’attendait déjà dans son véhicule de police. Le gendarme Miller a rejoint le gendarme Maynard et tous deux sont partis à bord du même véhicule en direction de la NCJS, environ 9 minutes après la répartition. À ce moment-là, une seule plainte avait été reçue, et les deux policiers croyaient qu’ils intervenaient par suite d’une seule agression à l’arme blanche pour laquelle les suspects avaient déjà quitté les lieux.
Pendant qu’ils roulaient vers la NCJS, ils ont commencé à recevoir des mises à jour de la STO et du groupe des Services de soutien opérationnel aux membres (SSOM) (explications à venir). Il était évident que la situation évoluait rapidement, car le nombre de victimes et de lieux touchés augmentait sans cesse. À leur arrivée sur les lieux, ils se sont fiés aux renseignements tirés des plaintes initiales et ultérieures (qu’ils recevaient de la STO et des SSOM) ainsi qu’à leurs propres observations pour prendre des décisions tactiques, qui seront examinées dans le cadre du présent objectif.
Le chapitre 16.9.3.1 du Manuel des opérations précise que, lorsqu’ils interviennent à la suite d’un incident, les membres doivent faire une évaluation du risque conformément au chapitre 17.1 du Manuel des opérations (Modèle d’intervention pour la gestion d’incidents), qui sera expliquée plus loin.
À leur arrivée dans la NCJS, environ 28 minutes après avoir quitté Melfort, les premiers membres à intervenir se sont d’abord rendus sur les lieux précisés, en commençant par la [CAVIARDÉ] du chemin New York. Lorsqu’ils y ont trouvé les premières victimes décédées, les gendarmes Maynard et Miller ont discuté de la stratégie à employer par la suite. Ils avaient très peu de temps pour élaborer un plan, car l’information continuait d’arriver tandis que la situation évoluait. Ils ont alors décidé de se séparer; le gendarme Miller resterait sur place pour donner les premiers soins aux victimes et assurer la continuité sur les lieux (chapitre 1.2.2.4 du Manuel des opérations) de ce qu’ils croyaient être les premiers homicides. Le gendarme Maynard, pour sa part, se rendrait plus au nord, sur les lieux d’où était provenu le premier appel, tout en continuant de faire un « tri » des victimes et des nouveaux lieux touchés à mesure qu’il recevait l’information. À ce moment-là, ils ignoraient où se trouvaient les suspects, et le nombre de victimes et de lieux touchés ne cessait d’augmenter (voir la Chronologie de l’incident ci dessus).
Nombre d’agents à bord d’un même véhicule
L’examen a révélé que les gendarme Maynard et Miller méritent d’être félicités pour leurs actions dans le cadre de l’intervention globale durant cet incident. Leur travail a été remarquable, dans une situation incroyablement difficile. Ils ont réagi rapidement, de manière décisive, et ont eu à relever des défis inimaginables.
Ceci étant dit, dans les présentes circonstances, la décision de se séparer a mis les deux agents dans une situation tactique désavantageuse, au moins pendant un certain temps. Les suspects (car on croyait encore qu’ils étaient deux à ce moment-là), étaient encore en fuite, et lorsque le gendarme Maynard est arrivé au [CAVIARDÉ], chemin North, une distance d’environ 12 km les séparait maintenant, lui et le gendarme Miller. La réception des téléphones portables était mauvaise (explications à venir), et le gendarme Miller n’aurait eu aucun moyen de prêter main-forte au gendarme Maynard si celui-ci avait croisé le ou les suspects. Par ailleurs, si le ou les suspects étaient revenus à la [CAVIARDÉ] du chemin New York, le gendarme Miller se serait retrouvé seul. Bien que cela ne se soit pas produit, il convient d’analyser les circonstances et les risques inhérents à une telle situation.
Une autre question qui se pose, toutefois, est celle de savoir si les deux gendarmes ont été désavantagés sur le plan tactique uniquement en raison du fait qu’ils se sont séparés ou, aussi, en partie parce qu’ils avaient décidé de se déplacer ensemble dans un même véhicule. Cette question est complexe et, sur le plan organisationnel, il n’existe pas encore de politique ou de directive nationale sur la question des patrouilles à une ou à deux personnes. En rétrospective, certains pourraient dire qu’il était préférable qu’ils se déplacent dans un même véhicule, s’ils ne s’étaient pas séparés à un moment donné. Ainsi, ils auraient été deux et auraient été ensemble s’ils étaient tombés sur le ou les suspects. Par contre, d’autres pourraient soutenir que le fait de se déplacer dans deux véhicules distincts leur aurait permis de couvrir plus de terrain, de chercher le ou les suspects et de se rendre sur les lieux d’autres appels, tout en restant à proximité l’un de l’autre.
Bien que l’on se penche encore aujourd’hui sur les avantages et les inconvénients, pour les policiers, de se déplacer seul ou à deux dans un même véhicule de patrouille, on peut affirmer que les patrouilles à deux personnes sont plus courantes dans les grandes municipalités, où il y a généralement plus de ressources dans les environs. Cependant, si certains sont pour et d’autres sont contre les patrouilles à deux agents dans les grandes municipalités, il devient moins évident de déterminer la meilleure option tactique à employer dans les zones rurales, ou lorsque seulement deux membres sont disponibles au départ.
La solution la plus évidente serait de toujours déployer le plus grand nombre de membres possible avec le plus grand nombre de véhicules de patrouille possible. Cependant, dans les faits, ce scénario est rarement envisageable en région rurale de nos jours. Puisqu’il s’agit de la réalité actuelle, la GRC gagnerait à analyser cette question plus en profondeur. La présente analyse attire l’attention sur les risques que pose la décision de se séparer, peu importe le nombre désigné de membres dans un même véhicule.
Modèle d’intervention pour la gestion des incidents
Le MIGI est l’outil dont se servent les agents de la GRC pour évaluer et gérer les risques lors de toute rencontre avec des membres du public. Ce modèle est principalement utilisé comme ligne directrice pour aider les agents à articuler le processus de prise de décisions au moment de choisir une option d’intervention en particulier. Les membres qui sont intervenus lors du présent incident n’ont pas eu à confronter le suspect à leur arrivée dans la NCJS après l’appel initial, et par conséquent, il n’y a pas lieu de se demander si le bon outil d’intervention a été utilisé à ce moment-là. Cela dit, on trouve systématiquement dans toutes les composantes du MIGI la notion selon laquelle la simple présence d’un agent est un facteur clé de l’intervention. Comme il a été indiqué dans la Chronologie de l’incident, le moment où le suspect a vu les membres de la GRC dans la NCJS a peut-être contribué à le faire s’en aller de la communauté.
Lorsqu’il s’agit de déterminer le niveau d’intervention nécessaire en fonction des circonstances, les diverses étapes du MIGI mettent en évidence la nécessité d’évaluer constamment le risque pendant toute la durée d’une situation.
Le groupe des Services de soutien opérationnel aux membres (SSOM) a communiqué avec le chef du Détachement de la GRC de Melfort, le sergent d’état-major Darren Simons (sergent d’état-major Simons), peu de temps après la répartition initiale pour l’informer de ce qui se passait. Une explication plus détaillée des SSOM se trouve à la section Structure de commandement du présent rapport; toutefois, pour donner un peu de contexte à ce moment-ci, mentionnons que le groupe des SSOM compte des sous-officiers supérieurs de la GRC sur place en permanence (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) à la Station de transmissions opérationnelles (STO) à Regina. Des membres des SSOM peuvent également être consultés en l’absence de superviseurs ou du chef de détachement. Le sergent d’état-major Simons a demandé au membre des SSOM d’entamer le processus de mobilisation de policiers et de ressources supplémentaires.
À son arrivée dans la NCJS, le sergent d’état-major Simons a rencontré le gendarme Maynard, qui lui a fourni une vue d’ensemble des événements survenus jusqu’alors. Après avoir déterminé que le gendarme Maynard avait la situation bien en main, le sergent d’état-major Simons l’a quitté pour continuer à coordonner et à sécuriser les autres lieux. Tandis que les appels continuaient d’arriver pour signaler d’autres décès ou blessures, le sergent d’état-major Simons se rendait aux divers endroits touchés, selon les besoins.
WQu’ils en aient eu conscience ou non, les agents ont suivi, durant l’intervention initiale par suite de l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon, les principes établis du Système de commandement en cas d’incident (explications à venir à la section Structure de commandement).
Bien que le gendarme Maynard ait géré la situation de manière efficace, il convient quand même de mentionner qu’il existe un certain nombre de cours en ligne auxquels tous les membres réguliers ont accès et qui offrent une formation de base en matière de gestion des incidents critiques. Cette formation découle des recommandations formulées dans le rapport MacNeil.
Parmi les cours disponibles, mentionnons les suivants :
Intervention initiale en situation de crise (ICIR) – niveau 100 : Ce cours donne aux membres réguliers les connaissances nécessaires pour prendre efficacement le commandement et le contrôle d’un incident critique de manière logique et méthodique, jusqu’à ce qu’un commandant des interventions critiques (CIC) prenne la relève.
Exercices sur table – Intervention initiale en situation de crise du Détachement : Ce cours vise à mieux préparer les superviseurs à gérer et à superviser un incident critique jusqu’à ce qu’un commandant des interventions critiques (CIC) prenne la relève. Un certain nombre de scénarios conçus sous la forme d’exercices sur table sont proposés aux équipes pour qu’elles planifient et mettent en pratique leur intervention en cas d’incident critique dans une zone qui relève du Détachement.
Si cela n’est pas déjà une priorité, il faut continuer à encourager les membres débutants et les superviseurs à suivre la formation de base ICIR afin qu’ils puissent être le mieux préparés possible à tout incident critique futur.
À mesure que la situation évoluait, on effectuait un triage des victimes, qui recevaient des soins des services médicaux d’urgence (SMU) ou des premiers intervenants de la collectivité, tandis que l’ambulance aérienne du STARS transportait certains des blessés à l’hôpital. La situation était chaotique, et certains l’ont comparée à une zone de guerre. Tandis qu’arrivaient des ressources additionnelles de la GRC dans la NCJS, celles-ci se voyaient abordées par des membres de la collectivité, dont certains qui étaient couverts de sang, pour être dirigées vers de nouveaux lieux. Les familles des victimes étaient présentes sur les lieux, à la recherche de réponses et d’information. En outre, on craignait de nouvelles violences par représailles une fois que la communauté avait appris l’identité des responsables présumés.
Cette « première vague » de membres de la GRC chargés de l’intervention ont été forcés par les circonstances de gérer eux-mêmes la situation, avec l’appui des SSOM (explications à venir), jusqu’à l’arrivée de ressources de supervision additionnelles. Les tâches consistant à faire le triage des lieux et des victimes, en affectant les ressources au fur et à mesure qu’elles étaient disponibles, ont été accomplies selon les principes du commandement et du contrôle, une notion couramment utilisée pour décrire la majorité des opérations policières menées au Canada.
Le mot commandement fait référence à la chaîne de commandement à laquelle les services de police adhèrent naturellement afin de gérer tout type d’incident dès le départ. Les principes du commandement et du contrôle sont évolutifs et permettent une intervention également évolutive de la part des services de police si un incident en vient à se transformer en incident critique. Souvent, les rôles et les tâches sont fondés sur le grade, l’ancienneté ou l’expérience.
Comme il sera expliqué dans la section suivante, depuis les premiers appels de service en provenance de la NCJS jusqu’à ce que l’on reconnaisse que l’incident était plus vaste et grave qu’on ne l’avait cru au départ, d’autres structures de commandement ont été mises en place
Communications radio
Lors d’incidents très stressants comme celui décrit ci-dessus, les protocoles de communication radio peuvent avoir tendance à s’éroder. Les agents qui intervenaient et qui communiquaient ensemble avec leur ordinateur portable (lorsque cela était possible) ou la radio dans leur véhicule de police ont en grande partie utilisé les communications radio de manière appropriée. Bien que l’on ne sache pas exactement à quel moment un canal radio crypté réservé a été défini, le langage clair est surtout ce qui a été utilisé. On a signalé que des codes-10 ont parfois été diffusés; toutefois, cela ne semble pas avoir créé de lacunes dans la communication. Il n’y a eu aucune occasion où les lacunes en matière de communication ont découlé d’un mauvais protocole radio ou d’une mauvaise façon de communiquer de la part des membres.
Les membres peuvent avoir tendance à éviter d’utiliser le langage clair lorsqu’ils ne savent pas si leur communication est chiffrée, afin d’éviter que les détails ne soient diffusés au grand public. Étant donné que les codes-10 de la GRC sont largement disponibles dans le domaine public, le risque posé par l’utilisation du langage clair, que la communication soit chiffrée ou non, était minime, en particulier au cours de cet incident. La question des communications radio est abordée plus en détail dans la section Communications opérationnelles du présent document.
Certains membres interrogés dans le cadre de l’examen ont indiqué que la formation par scénarios Déploiement rapide pour action immédiate (DRAI) leur avait été utile durant les incidents stressants lors desquels ils étaient intervenus et où une communication claire avait été indispensable.
Abstraction faite du langage utilisé durant cet incident critique, il faut mentionner que la réception radio était très mauvaise dans la NCJS. On a signalé que les membres devaient sortir des résidences chaque fois qu’ils souhaitaient faire une transmission au moyen de la radio portative. Les membres ont déclaré que cette situation avait été chose courante dans la NCJS. Pratiquement tous les membres interrogés durant l’examen ont dit avoir eu des problèmes causés par la mauvaise réception radio dans la NCJS.
[CAVIARDÉ]. Il convient cependant d’ajouter que, bien que le [CAVIARDÉ] offre une solution à la mauvaise réception radio, dans la réalité, il ne fonctionne que dans un type de scénario très précis et n’est pas pratique dans la plupart des cas.
Même si le téléphone cellulaire n’est pas aussi efficace que la radio, tous les membres qui sont intervenus dans la NCJS en avaient un, et on a dit qu’ils avaient offert une solution de rechange efficace à la radio. On examine la question de la mauvaise réception radio dans la NCJS plus en profondeur dans la section Communications opérationnelles du présent rapport.
Équipement et options d’intervention
On avait inclus dans les objectifs du présent rapport un examen de l’équipement auquel les membres avaient accès, de l’équipement dont ils ont eu besoin et des Rapports après action; il convient donc de les présenter brièvement ici. Les quelques 500 policiers qui ont été appelés à intervenir dans la NCJS/à Weldon n’ont pas tous été interrogés dans le cadre du présent examen; l’accent a été mis sur les membres de première ligne qui se sont retrouvés ou qui auraient pu se retrouver dans les situations les plus compromettantes en raison de leur rôle. Les paragraphes qui suivent concernent les agents qui sont intervenus initialement et les membres du Groupe tactique d’intervention (GTI).
Agents chargés de l’intervention initiale
Les deux membres appelés à intervenir les premiers dans la NCJS portaient tous les deux l’uniforme de travail et étaient équipés de leur pistolet de service chargé et de deux chargeurs pleins additionnels. L’un d’eux avait son arme à impulsions, qu’il avait été formé à utiliser.
[CAVIARDÉ]. Ces options d’intervention sont restées avec le gendarme Maynard dans le véhicule de police lorsque le gendarme Miller et lui se sont séparés après avoir constaté l’ampleur de la situation à leur arrivée dans la NCJS (voir ci-dessus). [CAVIARDÉ]
[CAVIARDÉ]
Les deux membres avaient à leur disposition toutes leurs options d’intervention et ont déclaré que celles-ci fonctionnaient correctement.
Conformément aux politiques, chaque véhicule contient une trousse de premiers soins. Certains membres avaient suivi la Formation sur l’équipement nécessaire à la prestation de soins de base en traumatologie (BTEC), et d’autres (mais pas tous) avaient une trousse de premiers soins personnelle (IFAK) sur eux. Certains avaient reçu une telle trousse, mais l’avaient laissée au Détachement, donc ils n’ont pas pu l’utiliser. Il n’y a pas de directive qui stipule que la trousse IFAK doit obligatoirement être ajoutée au ceinturon de service. Les membres qui ont de la place à leur ceinturon et qui ont reçu une trousse IFAK peuvent choisir de l’y ajouter. Comme il s’agit d’une trousse personnelle, on a limité le nombre de fournitures qu’elle contient afin qu’elle soit suffisamment petite pour être ajoutée au ceinturon; certains intervenants ont signalé qu’ils avaient manqué de fournitures (gaze, bandages de contention) pendant qu’ils donnaient les premiers soins aux victimes.
Groupe tactique d’intervention
Le Groupe tactique d’intervention (GTI) est l’un des groupes du Programme des incidents critiques de la Division F. Le GTI est déployé lors de diverses situations à haut risque. Le responsable du GTI s’appelle le « commandant des interventions critiques » (CIC). Le premier CIC à intervenir durant l’incident, le sergent d’état-major Steve Bergerman, a commencé à faire des appels immédiatement après avoir été mis au courant de la situation; dès 7 h le 4 septembre, des ressources du GTI avaient été mobilisées et chargées, au départ, de saturer la région de la NCJS à la recherche des suspects.
Équipement
[CAVIARDÉ]
[CAVIARDÉ]
[CAVIARDÉ]
[CAVIARDÉ]
Rapport après action
Le compte rendu d’incident du GTI est un formulaire normalisé (formulaire 1225) à remplir à la suite d’un incident au cours duquel le GTI a été déployé. Le formulaire comporte beaucoup de menus déroulants et de champs à remplir et ne permet pas de consigner suffisamment d’information pour permettre la formulation d’une intervention appropriée lors d’appels complexes. Le GTI de la Division F utilise un document préformaté en guise de complément au formulaire 1225 pour la plupart de ses appels afin de documenter correctement les mesures prises. La difficulté de créer un formulaire normalisé a été reconnue, principalement en raison de la nature unique des appels que reçoit le GTI. Le complément joint au formulaire 1225 a été considéré comme satisfaisant aux exigences en matière de rapport.
Entretiens avec des membres de la Nation crie de James Smith
À la suite des entretiens tenus auprès de membres de la NCJS, l’information pertinente suivante a été recueillie dans le cadre du présent objectif.
Temps de réponse
OL’un des sujets de préoccupation soulevés par les membres de la NCJS a été le temps qu’il a fallu aux membres de la GRC pour arriver dans la communauté le matin du 4 septembre. Naturellement, dans une situation comme celle qui s’est produite ce matin-là, tout le temps passé à attendre l’arrivée de la police et des services d’urgence sera remis en question. Le public dans son ensemble, et pas seulement les membres de la NCJS, accorde une grande importance au délai d’intervention de la police, notamment parce que ce délai crée un sentiment de sécurité et qu’il est considéré comme un facteur clé de la prévention du crime.
Le temps de réponse en soi n’est pas nécessairement difficile à mesurer; il suffit de déterminer le temps où un appel de service a été reçu et le temps qu’il a fallu ensuite aux policiers pour arriver sur les lieux (voir ci après). Cela dit, des éléments variables ont une incidence sur le temps qu’il faut à la police pour arriver sur les lieux. Comme on l’a vu plus haut, le Détachement de la GRC de Melfort emploie un modèle de services dans le cadre duquel des membres sont « en disponibilité » à la maison et peuvent être appelés à répondre à une plainte. En outre, lorsqu’un appel de service est reçu (dans ce cas-ci, par le centre d’appels 911), il peut s’écouler, entre la réception de l’appel et l’envoi de la police sur les lieux, une période qui aura une incidence sur l’intervention.
Retards attribuables à la « mise en disponibilité »
En ce qui concerne l’intervention initiale dans la NCJS, les heures suivantes sont connues :
- Heure de l’appel initial au 911 :
- 5 h 40
- Heure à laquelle l’appel au 911 a été réparti au Détachement de Melfort :
- 5 h 43
- Heure à laquelle l’appel au 911 a été réparti au Détachement de Melfort :
- 5 h 52
- Heure d’arrivée des membres au premier lieu touché ([CAVIARDÉ] ch. New York) :
- 6 h 20
- Temps total écoulé entre la répartition et l’arrivée des membres :
- 37 minutes
Il convient de noter à ce moment-ci que les renseignements tirés du rapport GPS du véhicule des membres dépêchés indiquent qu’ils ont pris la route qui partait directement de Melfort vers le nord sur la route 6 (voir la carte ci-dessus) et que leur vitesse a varié entre 155 km/h et 178 km/h lorsqu’ils roulaient sur cette route principale. Sur les routes secondaires, la vitesse a varié entre 115 km/h et 140 km/h.
Pour revenir brièvement sur la chronologie de l’incident présentée ci-dessus, l’enquête a révélé ce qui suit au sujet de la période durant laquelle les agressions et les homicides ont eu lieu le matin du 4 septembre.
- L’agression au couteau de [CAVIARDÉ] serait la première agression à avoir été commise par le suspect. Elle se serait produite entre 5 h 30 et 5 h 40
- Damien Sanderson est la victime du premier homicide, qui se serait produit après que le suspect et lui ont quitté la résidence de [CAVIARDÉ], vers 5 h 40.
- [CAVIARDÉ], est la victime du dernier homicide, qui se serait produit aux alentours de 7 h 10.
- Selon ces heures, la série de crimes violents du suspect aurait duré environ 1 heure et 40 minutes.
Comme indiqué ci-dessus, il y a, au Détachement de Melfort, des périodes régulières durant lesquelles un membre en disponibilité n’est pas tenu d’être au Détachement en personne. Toutefois, le matin du 4 septembre, le gendarme Maynard se trouvait déjà au Détachement pour un incident sans lien avec celui-ci lorsque l’appel initial au 911 a été réparti. Le seul « délai » dans le temps de réponse de la part de la GRC de Melfort a été le temps qu’il a fallu à l’agent servant de renfort au gendarme Maynard (le gendarme Miller) pour arriver au détachement une fois qu’il a reçu l’appel chez lui. Il va sans dire que le gendarme Maynard a respecté les politiques en s’assurant d’avoir du renfort pour répondre à cette plainte. Selon les politiques de la GRC, du renfort était requis en raison de la nature de l’appel. Le fait de répondre à cet appel sans renfort n’était pas une option, et cela n’a pas été envisagé. À l’arrivée du gendarme Miller au Détachement, les deux membres ont immédiatement quitté Melfort en direction de la NCJS.
Le temps qu’il a fallu au gendarme Miller pour arriver au détachement a été raisonnable. La décision du gendarme Maynard d’attendre l’arrivée de renforts afin que les deux agents puissent partir ensemble dans son véhicule de police n’a pas créé de retards déraisonnables dans l’intervention.
Retards attribuables à la répartition 911
Comme il a déjà été mentionné, en Saskatchewan, les appels au 911 sont acheminés aux Centres téléphoniques de sécurité publique (CTSP) à Regina, à Saskatoon et à Prince Albert. En ce qui concerne l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon, l’appel au 911 initial et les appels subséquents ont été transmis de Prince Albert à la STO de la GRC à Regina. Par la suite, des membres de la GRC de Melfort ont été dépêchés sur les lieux de l’incident.
Pendant l’examen, on n’a relevé aucune indication selon laquelle d’autres appels au 911 auraient été reçus en même temps que l’appel initial de l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon le matin du 4 septembre. Ce n’est qu’après l’appel initial qu’un flot d’autres appels au 911 a été reçu. Le processus de répartition dans son intégralité pour l’appel au 911 initial a pris très peu de temps et n’aurait pas pu être simplifié davantage.
La question des appels au 911 liés à cet incident est à nouveau abordée dans la section Communications opérationnelles du présent examen.
Étant donné le contexte susmentionné dans lequel les deux membres ont été dépêchés dans la NCJS, en plus de la distance à parcourir, le temps de réponse a été approprié.
Visibilité de la GRC
Dans l’ensemble, les membres des communautés de la NCJS et de Weldon sont reconnaissants des efforts déployés par toutes les ressources qui sont intervenues dans le cadre de cet incident. Toutefois, au cours des discussions subséquentes, les membres des communautés en sont venus à évoquer la question de la visibilité globale de la GRC, plus particulièrement dans la NCJS
Tout comme le délai d’intervention, la visibilité de la police dans les communautés qu’elle sert peut susciter un sentiment de sécurité, et on croit largement que cela contribue à la prévention de la criminalité en général. Lorsque les membres du public voient des policiers circuler, en véhicule ou à pied, dans un quartier ou une ville, ils sont plus enclins à croire que leur communauté a de l’importance. Cette notion est largement répandue et ne se limite pas qu’à la communauté de la NCJS.
Plusieurs membres de la NCJS ont dit croire que s’il y avait eu un membre de la GRC directement affecté dans la NCJS au moment de l’incident, le nombre de victimes aurait été moins élevé. Ici encore, il s’agit d’une opinion qui peut se former spontanément à la suite d’un événement tragique. Malheureusement, le type de modèle de prestation de services en question n’était pas une option, et cela dépasse la portée du présent examen, qui consiste à évaluer l’intervention de la GRC. Néanmoins, vu le nombre de membres de la communauté qui ont mentionné le manque de visibilité de la GRC dans la NCJS et le fait que les membres de la GRC ne sont pas connus au sein de la NCJS, il convient d’aborder cette question dans les paragraphes qui suivent.
Après avoir interrogé des membres de la NCJS, on constate que les avis sont partagés en ce qui concerne les relations entre la GRC de Melfort et la NCJS.
Durant l’intervention lors de l’incident du 4 septembre et les jours qui ont suivi, énormément de membres de la GRC de Melfort se trouvaient dans la NCJS et les environs. Pourtant, lorsqu’ils ont exprimé leur reconnaissance quant à l’intervention de la GRC, certains membres de la NCJS ont demandé pourquoi, à part le chef de détachement, personne du Détachement de Melfort n’était venu. Étant donné que tous les membres du Détachement de Melfort qui étaient disponibles ont bel et bien participé à l’intervention, il faut peut-être en conclure que les membres du Détachement de Melfort de la GRC ne sont pas bien connus au sein la NCJS.
Le Détachement de Melfort n’a pas conclu d’entente communautaire tripartite (ECT) avec la NCJS. Dans le cadre d’une telle entente, des policiers d’un service de police existant, normalement la GRC, sont affectés à une collectivité inuite ou des Premières Nations. Comme l’ont souligné des membres de la NCJS, par le passé, le « déclic » s’est parfois fait entre la communauté et ces policiers, mais pas toujours. Le membre qui occupe actuellement ce poste au Détachement de Melfort est autochtone, et il consacre beaucoup de temps et d’énergie à ses responsabilités dans la NCJS. On a parlé de lui en termes élogieux et loué son travail dans la communauté; bref, la NCJS l’aime beaucoup. Toutefois, ce membre était absent le 4 septembre et n’a pas pu participer à l’intervention. Ce que l’on essaie de dire, c’est qu’il est nécessaire de renforcer les liens avec tous les membres du Détachement, et pas seulement avec ceux qui ont une description de poste précise.
Le sentiment général dans la NCJS est que la GRC doit s’efforcer d’être plus visible au sein de la communauté et d’encourager une plus grande et meilleure communication avec la NCJS, non seulement lors d’événements communautaires planifiés auxquels elle est appelée à participer, mais en général. Si la confiance accrue du public peut être un résultat de ces efforts, l’engagement de la communauté est peut-être l’élément le plus essentiel susceptible d’avoir un effet durable sur la réduction de la criminalité dans la communauté.
Mesures efficaces
Intervention globale de la GRC
ML’intervention de la GRC dans le cadre des incidents survenus dans la NCJS/à Weldon a été en grande partie axée sur l’apport d’aide et de secours au grand nombre de victimes; cette question est d’ailleurs abordée en profondeur à la section Intervention visant un grand nombre de victimes du présent rapport. Il convient de mentionner que l’intervention globale de la GRC dans la NCJS a été reconnue et saluée.
Dans la communauté, une impression persiste, à savoir que « l’autorité » de la GRC n’est pas ce qui a prévalu dans ses communications avec les membres de la communauté durant les incidents, mais plutôt le « respect » et la « bienveillance ». Les membres de la GRC ont été considérés comme très accessibles, ce qui a eu un effet rassurant pendant l’incident. On a aussi indiqué que le fait que certains membres de la GRC participant à l’intervention étaient autochtones a été bénéfique et l’aurait été encore plus s’ils avaient parlé la langue de la communauté
Triage initial des divers lieux touchés et des victimes
Il sera mentionné tout au long du présent rapport que les circonstances entourant ces incidents sont une chose à laquelle la grande majorité des policiers ne seront jamais confrontés durant leur carrière. La tragédie qui attendait les premiers intervenants à leur arrivée sur les lieux, les responsabilités et les décisions à prendre à l’égard de toutes les victimes, tout cela aurait facilement écrasé la grande majorité d’entre nous.
Les mesures prises, tant par les premiers intervenants que par les membres de la communauté, sont dignes d’éloges. Avant et pendant l’arrivée de la GRC le matin du 4 septembre, les membres de la NCJS (membres de la communauté et familles) ont eu à gérer directement les conséquences des agressions. Ils ont dû prendre des décisions cruciales et rapides dans des circonstances inimaginables. Même si on ne parle que de la Structure de commandement de l’incident dans son ensemble dans la section suivante, il convient de noter qu’en ce qui concerne les premières interventions, le sang-froid dont ont fait preuve toutes les personnes impliquées a été remarquable.
Les premiers intervenants ont dû prendre des décisions sur plusieurs fronts : évaluation initiale des lieux, triage des victimes, gestion du nombre croissant de lieux et de victimes, orientation du déplacement des victimes vers les points de rassemblement, premiers soins, et appréhension possible du ou des suspects. Toutes ces décisions devaient être prises tandis qu’un nombre croissant de ressources arrivaient sur les lieux et avaient besoin d’instructions, et que le ou les suspects, qui venaient de tuer un grand nombre de personnes, changeaient sans cesse de véhicules et étaient toujours en liberté.
Lors d’un incident faisant un grand nombre de victimes comme celui-ci, les mesures prises par les premiers intervenants peuvent souvent faire la différence entre une situation mal gérée, qui met en danger les victimes et l’enquête, et une situation bien gérée qui permet de parvenir à une issue plus positive. Les membres qui ont pris la relève au commandement ont indiqué à plusieurs reprises que le leadership dont avaient fait preuve les premiers intervenants était ce qui avait facilité la transition.
La rapidité avec laquelle les membres de la communauté ont établi le Centre des opérations d’urgence (COU), la communication entre les membres de la communauté et la GRC afin d’orienter les membres de la GRC vers les différents lieux touchés et les victimes, les décisions prises concernant les personnes chargées du triage des lieux et des victimes, tout cela a contribué à créer un sentiment général d’organisation dans une situation par ailleurs exceptionnellement chaotique.
Aperçu du Système de commandement en cas d’incident
Quel que soit le type de situation pour laquelle la GRC est appelée à intervenir, la structure de commandement détermine en tout temps les rôles et les responsabilités des personnes qui participent à l’intervention. Lorsqu’une plainte reçue n’est pas de nature critique, la structure de commandement reste au niveau du détachement et se compose des membres qui se sont rendus sur les lieux ou qui jouent un rôle de supervision au détachement. Par contre, dans une situation plus critique et complexe, le commandement peut être transféré du détachement au district, voire à la division. Au niveau de la division, les intérêts nationaux et la supervision sont chose courante. Lorsqu’une situation passe d’un niveau à un autre, cela apporte des changements dans la structure de commandement chargée de donner de l’orientation en vue d’atteindre les objectifs fixés.
La grande majorité des incidents nécessitant une intervention policière commencent et se terminent localement et sont gérés, au quotidien, par l’autorité qui se trouve au plus bas échelon géographique, organisationnel et administratif. Dans environ 95 % des incidents, la structure organisationnelle des opérations comprend un commandement et des ressources uniques. Il est très rare qu’il soit nécessaire de « passer à un échelon supérieur » et d’activer un niveau de gestion plus élevé. La GRC a l’habitude de gérer ce type d’incidents ou d’enquêtes ponctuels, où les structures de commandement reconnues sont préétablies.
Dans certains cas, cependant, même si le commandement reste à l’échelle locale, il faut faire appel à des protocoles et à des ressources de commandement spéciaux. Examinons deux exemples d’incidents critiques « de niveau supérieur » :
Homicide : Lors d’un homicide, les membres du détachement local sont normalement les premiers à intervenir, et ils font appel au Groupe des crimes majeurs (GCM). À son arrivée sur les lieux, le GCM prend le commandement et utilise les principes de la gestion des cas graves GCG pour aiguiller les ressources. Un triangle de commandement, composé d’un chef d’équipe, d’un enquêteur principal et d’un coordonnateur des dossiers, forme la structure hiérarchique pour toute l’équipe d’enquête. Souvent, le ou les suspects sont identifiés et appréhendés par les ressources d’enquête dans un temps relativement court. Le plus haut niveau de commandement dans une intervention de cette nature ne va pas au-delà du triangle de commandement.
Sujet armé et barricadé : Lors d’un incident de ce type, lorsque le suspect pose un risque important mais qu’il est confiné dans une zone précise, on fait appel au Programme des incidents critiques (explications à venir), et un commandant des interventions critiques (CIC) prend alors le commandement global de l’intervention. Même si l’enquête criminelle est menée au niveau local, le CIC en reste responsable jusqu’à l’arrestation du sujet. Ici encore, très souvent, un suspect est identifié et appréhendé dans un délai assez court. Ces incidents, bien que graves, sont fréquents et ne nécessitent pas de ressources autres que celles du détachement local et du Programme des incidents critiques (PIC).
Dans les deux exemples qui précèdent, il est bien établi que toutes les ressources relèvent d’un superviseur du détachement, du chef de détachement, du chef d’équipe du GCM ou du commandant des interventions critiques du PIC, selon le cas. Cela dit, et malgré le fait que la grande majorité des incidents sont gérés au niveau local, la GRC est appelée à composer avec de plus en plus d’incidents critiques qui sortent du cadre de la structure de commandement traditionnelle. Les suspects sont plus mobiles, ont accès à des armes à feu de type « arme d’assaut », communiquent avec d’autres suspects par la voie numérique et utilisent des téléphones intelligents, ce qui complique l’intervention policière dans des situations de plus en plus risquées. Ces incidents, surtout lorsqu’un confinement n’est pas rapidement établi, peuvent vite se transformer en incidents qui nécessitent une approche multidisciplinaire, qui touchent plusieurs administrations et qui nécessitent beaucoup de ressources additionnelles et du soutien opérationnel. Une telle situation peut submerger les structures de commandement locales ou traditionnelles. Même si la plupart des incidents critiques nécessitent moins de 20 ou 30 ressources, on doit désormais composer avec des incidents qui nécessitent l’intervention de centaines de ressources, par exemple l’incident qui a mené à des pertes massives en Nouvelle-Écosse en 2020 et l’incident survenu à Moncton en 2014 au cours duquel trois membres de la GRC ont perdu la vie.
L’incident survenu dans la NCJS/à Weldon s’est transformé presque immédiatement en intervention à l’échelon divisionnaire. L’intervention policière a comporté un certain nombre d’éléments et a nécessité l’aide de divers groupes, divisions et services de police. Une situation comme celle-là requiert la coordination efficace des ressources de toutes les organisations qui interviennent. Ce type d’incident est de plus en plus fréquent en raison de l’environnement dynamique dans lequel évoluent les services de police, où des appels de service apparemment routiniers peuvent se transformer très rapidement en incidents critiques complexes. Ce changement a forcé la GRC à revoir ses façons d’intervenir lors de tels incidents; cependant, il n’y a pas de politiques ou de procédures reconnues à l’échelle nationale pour orienter l’intervention de la GRC lors d’incidents de cette envergure. Cela dit, une politique divisionnaire en Alberta (Division K) et une autre en Colombie-Britannique (Division E) décrivent l’utilisation de la structure Or-Argent-Bronze en conjonction avec le Système de commandement en cas d’incident pour les incidents d’envergure nécessitant une intervention policière. Bien que ces politiques divisionnaires clarifient quelque peu l’intervention, il subsiste de l’incertitude quant à l’interrelation entre les deux systèmes, et, comme on l’a déjà dit, il n’existe toujours pas de norme nationale à cet égard.
Donnons maintenant une brève description des deux structures de commandement susmentionnées, dans un souci de clarté pour la présente partie du rapport.
Incident Command System Overview
Le Système de commandement en cas d’incident (SCI) est un modèle qui sert à commander, à superviser et à coordonner les interventions d’urgence sur les lieux d’une urgence. Il permet de coordonner les efforts déployés par des organismes et des ressources qui collaborent à la prise en charge, au contrôle et à l’atténuation d’une situation d’urgence de façon sécuritaire. Bien qu’il ait été conçu à l’origine pour lutter contre les incendies de forêt dans les années 1970, le SCI a évolué pour devenir un système tous risques adapté à tous les types d’incidents, y compris à ceux qui font de nombreuses victimes et qui nécessitent une intervention à plusieurs organismes.
L’organisation du SCI s’articule autour des cinq fonctions principales suivantes : Commandement, Opérations, Planification, Logistique et Finances/administration.
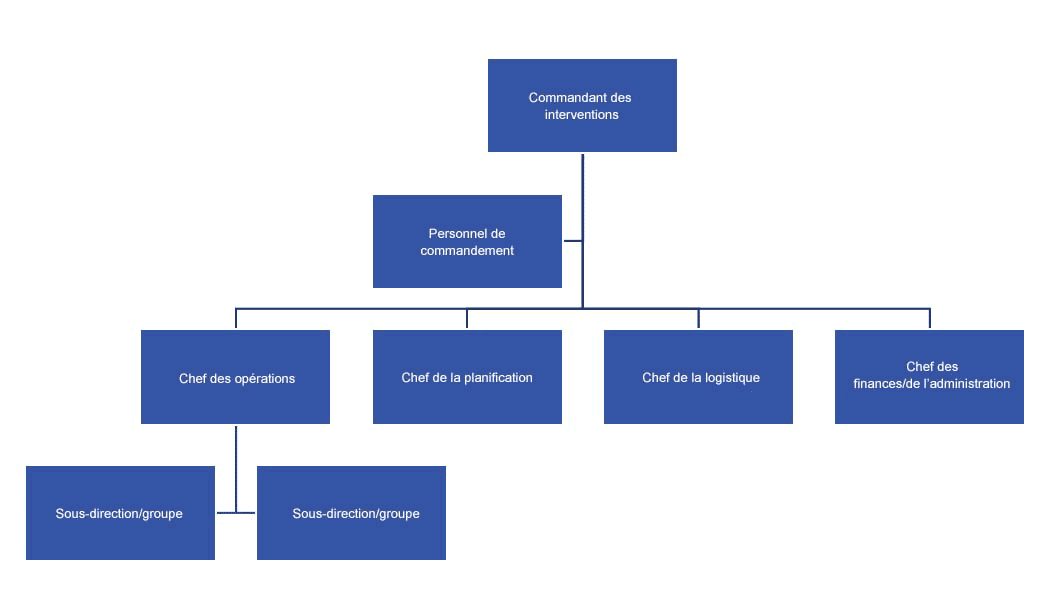
Description de l'image
Une boîte blanche contenant huit boîtes bleues avec du texte à l’intérieur, disposées hiérarchiquement pour illustrer un organigramme du Système de commandement en cas d’incident (SCI). Le niveau de commandement le plus élevé, indiqué dans la case située en haut de l’organigramme, est celui du commandant des interventions. Au-dessous se trouve le personnel de commandement. Le troisième niveau est composé du chef des opérations, du chef de la planification, du chef de la logistique et du chef des finances/de l’administration. Le chef des opérations est ensuite subdivisé en sous-directions ou en groupes.
La fonction de commandement est dirigée par le commandant des interventions (CI); le CI est le chef sur les lieux de l’incident, et il doit être pleinement qualifié pour diriger l’intervention. Le rôle de CI est d’abord assumé par le premier intervenant arrivé sur les lieux de l’incident. Cette personne est responsable de gérer toutes les ressources tactiques et de superviser les opérations. Dans environ 95 % des cas, la structure organisationnelle des opérations se composera d’un commandement des interventions et de ressources ponctuelles. Il est très rare qu’on doive « passer à l’échelon supérieur » et activer les fonctions de planification, de logistique ou de finances/administration, car il s’agit d’éléments de gestion qui ont moins à voir avec l’intervention tactique.
L’élément planification, lorsqu’on y a recours, tient à jour l’état des ressources et prépare la documentation relative à l’intervention. L’élément logistique, pour sa part, fournit des services et du soutien pour répondre aux besoins liés à l’incident ou à l’intervention, par exemple l’acquisition de ressources et d’autres services requis, tandis que l’élément finances/administration gère les coûts et les dépenses associés à l’intervention.
Aperçu de la structure Or-Argent-Bronze
La structure de commandement Or-Argent-Bronze (OAB) offre un cadre d’intervention stratégique, opérationnel et tactique lors d’incidents spontanés ou d’opérations planifiées. Elle permet d’établir des processus pour faciliter la diffusion de l’information afin de veiller à ce que les décisions soient communiquées de manière efficace et documentées pour établir une piste de vérification.
La plupart des incidents et des opérations sont résolus à l’aide d’une structure de commandement OAB simple comportant des protocoles de commandement. qui énoncent clairement les responsabilités et les obligations redditionnelles de chaque commandant. La structure de commandement est propre au rôle, et non au grade, et autorise une certaine souplesse.
Le commandant Or contrôle l’ensemble des ressources de son organisation appelées à intervenir sur le lieu de l’incident. Cette personne n’est pas nécessairement elle-même sur les lieux; elle peut se trouver dans une salle de contrôle à part, d’où elle formule et supervise la stratégie pour gérer l’incident.
Le commandant Argent est le commandant opérationnel qui gère la mise en œuvre opérationnelle selon l’orientation stratégique reçue du commandant Or; il transforme cette orientation stratégique en un ensemble de mesures qui seront mises en œuvre par le commandant Bronze. La présence du commandant Argent sur les lieux varie selon l’incident et l’organisme.
Le commandant Bronze est responsable du commandement d’un groupe de ressources et de voir à l’exécution des responsabilités fonctionnelles ou géographiques liées au plan tactique.
Si l’incident touche une zone géographique étendue, différents commandants Bronze peuvent être désignés pour assumer la responsabilité à différents endroits.
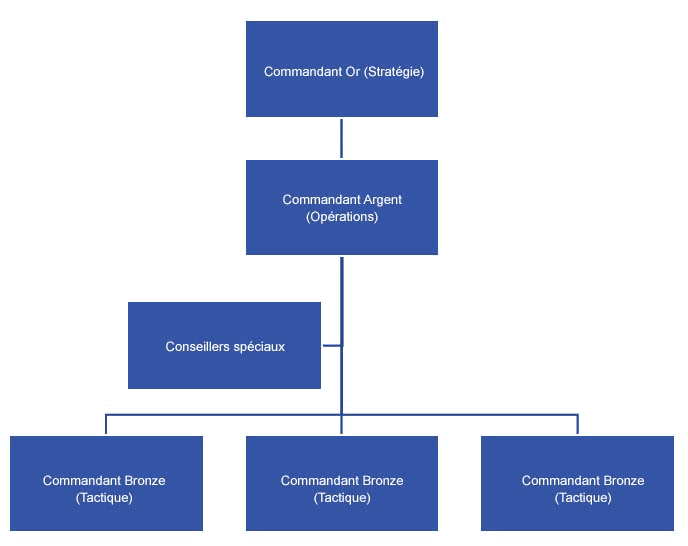
Description de l'image
Une boîte blanche avec six boîtes bleues avec du texte à l’intérieur qui sont disposées hiérarchiquement pour démontrer la structure de commandement OAB. Le niveau de commandement le plus élevé figurant dans la case en haut du tableau est celui du commandant Or (Stratégie). Au-dessous de lui se trouve le commandant Argent (Opérations). Sous le commandant Argent se trouvent les conseillers spéciaux. Le commandant Argent est ensuite divisé en trois boîtes de commandant Bronze (Tactique).
La structure du Système de commandement en cas d’incident et la structure Or-Argent-Bronze font l’objet de débats depuis un certain temps déjà. Les deux systèmes sont utilisés principalement en raison de la souplesse qu’ils offrent aux organismes d’intervention (services de police, services d’urgence, etc.) de n’utiliser que les éléments qui conviennent concrètement à un incident donné. Les deux modèles favorisent l’adaptabilité sans compromettre la clarté des lignes de communication ou de responsabilité. Quel que soit le modèle adopté par une organisation, ce sont les processus et les méthodologies de ce modèle qui doivent être au centre de la discussion, et non le modèle lui-même.
Incident survenu dans la NCJS/à Weldon – défis méthodologiques
Comme on le verra, plusieurs éléments du « commandement » peuvent être examinés lorsqu’on tente de déterminer après coup l’efficacité globale d’une intervention. Ce volet du rapport a été de loin le plus difficile à examiner et à documenter en raison, notamment, de l’absence d’organigramme précisant les différents rôles et responsabilités des personnes chargées de gérer l’événement dans son ensemble. À la complexité de l’examen s’ajoutait la réalité susmentionnée, à savoir qu’il n’existe pas de politique nationale ferme permettant de faire une évaluation appropriée.
Tout au long du présent rapport, on mentionne diverses expressions liées au commandement, comme « commandant des interventions ». Bien que ces expressions renvoient à des éléments précis du Système de commandement en cas d’incident ou de la structure Or-Argent-Bronze (ou des deux), cela ne veut pas dire que la Division F de la GRC a orienté son intervention en se fondant uniquement sur l’un ou l’autre de ces deux modèles. Lorsqu’une terminologie particulière est utilisée, c’est parce que les membres interrogés y ont fait référence eux-mêmes ou parce que l’équipe chargée de l’examen est tombée sur un rôle ou sur un terme de commandement précis.
La présente section comporte plusieurs organigrammes. Ces organigrammes n’ont pas été fournis à l’équipe d’examen mais ont plutôt été générés par elle afin de clarifier l’évolution des structures de commandement au fur et à mesure que se déroulait l’intervention dans la NCJS/à Weldon.
TIl sera amplement question des postes de commandement dans la présente section. Peu importe la philosophie, on admet communément qu’il convient d’avoir un seul poste de commandement d’incident pour les incidents critiques, car il s’agit du lieu à partir duquel le commandant des interventions (CI) supervise toutes les opérations. Dans des circonstances « normales », le rôle du CI est tenu par le commandant des interventions critiques (CIC)Z (voir ci-après), puisque la grande majorité des incidents ne nécessitent pas le recours à une fonction de commandement qui dépasse le niveau du CIC. Cependant, comme on l’explique dans le présent rapport, l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon a rapidement surpassé la capacité du CIC sur place à gérer l’ensemble de l’intervention, et il a fallu mobiliser un commandant des interventions (CI). Le CIC et le CI ont eu des rôles distincts à jouer durant l’intervention, et c’est pourquoi deux postes de commandement ont été utilisés, soit l’un qui servait de poste de commandement d’incident et l’autre, de poste de commandement tactique responsable des efforts d’arrestation. L’évolution des deux postes de commandement sera expliquée plus en détail ci-après, mais une présentation générale de leurs fonctions respectives à ce stade-ci contribuera à expliquer pourquoi il y a eu, à l’occasion, de la confusion quant à la personne qui exerçait le commandement dans des circonstances précises durant les trois jours de l’intervention.
Interface de commandement
Dès le premier appel de service et l’arrivée sur les lieux des premiers intervenants, le Programme des incidents critiques (PIC) a été activé et un commandant des interventions critiques (CIC) a été mobilisé; celui-ci en est venu à assumer le commandement sur place, le 4 septembre en milieu de matinée, et y est resté pour la majeure partie de l’intervention. En même temps, des membres de la direction travaillaient à partir du Centre divisionnaire des opérations d’urgence (CDOU), qu’on était en train d’activer, pour prêter main-forte à la logistique, aux séances d’information exhaustives et aux rapports de la haute direction. Au CDOU, on tentait alors d’établir un horaire de travail par quarts de sorte à pouvoir composer avec plusieurs périodes opérationnelles. Le Groupe des crimes majeurs (GCM) a également été mobilisé et, après avoir déterminé l’ampleur de ce qui se passait, il a créé des « sous-équipes » jugées nécessaires qui relevaient du chef d’équipe du GCM.
L’activation de ces divers niveaux de commandement en si peu de temps démontre que la police est généralement efficace lorsqu’elle fonctionne au sein d’une structure organisationnelle plus « locale »; toutefois, lorsqu’une situation évolue au-delà du niveau local, c’est alors que les lignes de commandement peuvent devenir plus floues.
Liens hiérarchiques émergents
Durant les heures ayant précédé l’arrestation du suspect, des liens hiérarchiques ont été établis afin que les groupes tactiques sur les lieux (Groupe des crimes majeurs, commandant des interventions critiques, Service de l’identité judiciaire, etc.) relèvent du CDOU, où le commandant des interventions et le commandant du CDOU étaient en poste.
Bien que les différentes fonctions aient été dûment utilisées pendant toute l’intervention, certains éléments du modèle de commandement auraient bénéficié d’une approche plus structurée. Cette structure hiérarchique émergente, bien qu’elle n’ait pas été définie au moment des faits, a peut-être contribué à une partie de l’ambiguïté quant à savoir qui exerçait le « commandement global » à divers moments.
Commandement de l’intervention dans la NCJS/à Weldon
Même si l’intervention dans la NCJS/à Weldon ne s’est pas faite de manière linéaire, avec des heures de début et de fin clairement définies pour les divers niveaux de commandement, l’examen séquentiel des rôles de commandement qui ont évolué s’impose en tant que format le plus logique à retenir. Comme on le verra, l’activation de certaines fonctions du commandement ne s’est pas faite de manière isolée, étant donné qu’il y avait à tout moment plusieurs tâches en cours de préparation qui ont entraîné la mise sur pied de divers groupes ainsi que l’attribution de tâches propres à certains éléments du commandement.
Une fois que l’intervention a atteint l’échelon divisionnaire, les fonctions de commandement primaires ont surtout gravité autour du commandant des interventions critiques et des gestionnaires qui travaillaient à partir du CDOU; par conséquent, la présente section portera en grande partie sur ces fonctions. De plus, l’accent sera mis sur le travail des Services de soutien opérationnel aux membres (et des membres qui sont intervenus initialement), de l’agent de service des Opérations criminelles et du Groupe des crimes majeurs de la Division F. On a déjà beaucoup parlé des mesures prises par les membres qui sont intervenus initialement dans la section précédente du rapport, et à compter de maintenant, on n’en parlera plus que si cela s’avère nécessaire.
Au départ, l’intention du présent examen était d’évaluer chaque volet du commandement en tant qu’objectif distinct; cependant, à mesure que l’examen progressait, le fait de documenter chaque rôle de manière isolée ne facilitait guère la compréhension du lecteur. On sait déjà qu’il y a eu une grande interaction entre les différents niveaux de commandement et que ceux-ci étaient parfois entremêlés. Ainsi, la description de chaque rôle de commandement précis ne sera pas confinée aux rubriques mentionnées, mais débordera dans l’ensemble de la section lorsqu’il le faut.
Groupe des Services de soutien opérationnel aux membres
Structure et fonction
Plusieurs divisions de la GRC comptent un groupe des Services de soutien opérationnel aux membres (SSOM) composé de sous-officiers supérieurs (sergents ou membres de grades supérieurs) à temps plein. Un élément du rôle des SSOM consiste à passer en revue tous les appels prioritaires que reçoit la Station de transmissions opérationnelles (STO) divisionnaire par l’entremise du Système intégré de répartition de l’information (système CIIDS). Les SSOM peuvent ainsi exercer un contrôle sur les dossiers à mesure qu’ils arrivent à la STO afin qu’ils puissent intervenir très tôt si la situation évolue.
Les membres des SSOM peuvent être consultés en l’absence d’un superviseur ou du chef de détachement. En temps normal, on n’appelle un superviseur ou le chef de détachement en congé que dans les situations les plus graves ou lorsqu’un membre des SSOM le recommande. C’est ce qui s’est passé le 4 septembre, c’est à dire que les SSOM ont avisé le chef du Détachement de Melfort après la réception des appels initiaux.
Le groupe des SSOM peut fournir de l’aide ou des conseils à divers degrés aux membres de première ligne, selon la situation. En gros, chaque fois qu’un membre de première ligne est confronté à une incertitude opérationnelle, il peut faire appel aux SSOM pour recevoir des conseils sur la manière de procéder ou de réagir. En Saskatchewan, le groupe des SSOM est établi au quartier général de la GRC à Regina et est intégré à la STO. Les membres peuvent communiquer avec lui par l’entremise de la STO et ainsi recevoir de l’aide en temps réel lorsqu’il le faut. Dans certaines divisions de la GRC, on souhaite transformer le programme des SSOM en Centre des opérations en temps réel (COTR), une approche davantage axée sur le travail d’équipe pour fournir du soutien au commandement et/ou du soutien opérationnel. Dans le présent examen, seul le groupe des SSOM a été examiné.
À la Division F, on a créé un groupe des SSOM à temps plein en partie pour donner suite à la recommandation suivante du rapport MacNeil (2014), dont on a déjà parlé.
Le mandat du groupe des SSOM de la Division F est le suivant : transmettre aux membres l’information et les politiques les plus récentes pour les aider dans l’exercice de leurs fonctions et servir de point de contact entre le public et la police.
Commandement initial
Groupe des SSOM/membres qui sont intervenus initialement
Comme il a déjà été expliqué, le 4 septembre, vers 5 h 44, le gendarme Maynard a été dépêché par la STO sur les lieux d’une agression au couteau dans la NCJS. À ce moment-là, un membre des SSOM était de service à la STO et avait été mis au courant de l’appel initial.
Même si l’appel était de nature urgente, rien ne laissait encore supposer que cette plainte différait d’autres plaintes similaires reçues dans le passé, et aucune information ne permettait encore de croire qu’un incident plus grave était en train de se produire. Lorsque, quelques minutes plus tard, la STO a reçu un autre appel, le membre des SSOM a communiqué avec les membres chargés d’intervenir, et on a discuté de la possibilité qu’il y ait un lien entre les deux agressions. Vers 6 h 11, la STO a reçu des appels additionnels, et c’est à ce moment-là qu’il est devenu clair qu’il s’agissait d’un incident qui allait faire plusieurs victimes. Les gendarmes Maynard et Miller étaient encore en route vers la NCJS lorsque la STO recevait ces mises à jour, et à partir de ce moment, ils sont restés en communication constante avec le membre des SSOM, travaillant de concert avec lui pour établir le commandement de l’intervention. Le membre des SSOM a immédiatement appelé le sergent d’état-major Simons et l’agent de service en disponibilité (voir ci dessous) pour les informer de ce qui se passait. Dès 6 h 47, le commandant des interventions critiques (CIC) en disponibilité avait été avisé. Malgré cela, le commandement de l’incident est resté, à ce moment-là, aux mains des deux membres chargés d’intervenir initialement (sous la supervision des SSOM), puisque c’était eux qui avaient la plus grande connaissance de la situation.
À 7 h, il y a eu une relève de quart, et les membres des SSOM nouvellement arrivés ont continué d’appeler d’autres membres ou groupes pour venir aider les intervenants dans la NCJS. Les SSOM ont à leur disposition le numéro de personnes-ressources au sein d’organismes partenaires (p. ex. le Service de police de Regina) afin de pouvoir communiquer rapidement avec elles. L’utilité de tels « contacts directs » a été prouvée lorsqu’on a pu identifier un suspect grâce à des renseignements reçus de cette manière. On a ensuite pu communiquer rapidement avec un employé des Services correctionnels responsable du suspect. Les SSOM ont communiqué avec les Services cynophiles, le Groupe des crimes majeurs, les Services de l’identité judiciaire et tous les autres groupes requis aux fins de déploiement. Le membre des SSOM qui avait reçu l’appel initial est resté en poste jusqu’à une heure avancée de la matinée pour apporter son aide au CDOU (explications à venir), qui était également en cours d’activation à ce moment-là.
Les SSOM et les membres intervenant sur les lieux ont été en mesure de reconnaître l’ampleur et la portée de l’incident qui se déroulait encore, de sorte qu’il a été possible d’élargir très rapidement la portée de l’intervention et d’obtenir le plus grand nombre de ressources possible.
Le sergent d’état-major Simons, à son arrivée dans la NCJS à 7 h 38, est devenu le commandant des interventions de facto avec l’appui des SSOM. À ce moment-là, des fonctions de commandement de niveau supérieur étaient en cours d’organisation; cependant, les membres sur place étaient aux commandes, car ils avaient toute la connaissance de la situation et dirigeaient les ressources dont ils disposaient. Les premiers intervenants ont reconnu et compris que le sergent d’état-major Simons était devenu responsable des interventions à son arrivée sur les lieux.
Le sergent d’état-major Simons avait suivi de la formation sur le Système de commandement en cas d’incident (SCI) et sur l’Intervention initiale en situation de crise (ICIR), comme le recommande le Raport MacNeil (susmentionné). Le sergent d’état-major Simons a toutefois admis qu’aucune formation n’aurait pu les préparer, lui et ses membres, à ce qui les attendait le matin du 4 septembre.
Le sergent d’état-major Simons a autorisé le gendarme Maynard à poursuivre le triage des victimes et des lieux et à orienter les ressources additionnelles à mesure qu’elles arrivaient. Il s’agissait d’une décision réfléchie, car le sergent d’état-major Simons était devenu le chef du Détachement de Melfort six semaines auparavant seulement, et à son avis, le gendarme Maynard était tout à fait capable de continuer à coordonner l’intervention sur les lieux.
En raison de la complexité de l’incident et de la nécessité d’agir rapidement, il aurait été contre-productif pour le sergent d’état-major Simons de se charger lui-même de toutes ces tâches simplement en raison de son grade. Le sergent d’état-major Simons a apporté son aide sur les lieux et auprès des victimes selon les besoins, tout en restant en communication avec les SSOM, le CDOU (une fois celui-ci activé) et la STO, dans le but de déployer des ressources additionnelles dans la NCJS.
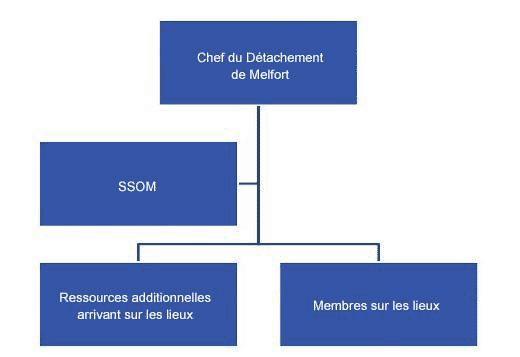
Description de l'image
Une boîte blanche avec quatre boîtes bleues avec du texte à l’intérieur qui sont disposées hiérarchiquement pour démontrer l’organigramme initial impliquant le Détachement de Melfort et les SSOM. Le niveau de commandement le plus élevé figurant dans la case en haut de l’organigramme est celui du chef de Détachement de Melfort. Le niveau inférieur est celui des SSOM. Le troisième niveau se décompose en membres sur les lieux et en ressources additionnelles arrivant sur les lieux.
Agent de service et officier responsable des enquêtes criminelles
Comme on l’a déjà mentionné, les SSOM ont rapidement communiqué avec l’inspecteur Murray Chamberlin (inspecteur Chamberlin), qui était l’agent de service en disponibilité (agent de service) le 4 septembre. Pour clarifier, un agent de service est un officier breveté désigné qui reçoit les avis et les mises à jour de haut niveau lors d’incidents en cours qui présentent un intérêt divisionnaire. Un agent de service est en disponibilité lorsque les agents du district et les membres des équipes de gestion du district ne travaillent pas, exerçant la surveillance et veillant à ce que la haute direction soit informée de tout événement critique en cours.
À ce moment-là, l’inspecteur Chamberlin, qui était l’agent de service, tenait aussi le rôle d’agent du district du Nord. Essentiellement, il assumait simultanément deux niveaux de notification : agent de service et agent du district du Nord (par intérim).
À titre d’agent de service, l’inspecteur Chamberlin a immédiatement avisé l’officier responsable des enquêtes criminelles (OREC), le surintendant principal Teddy Munro (surintendant principal Munro) de ce qui se passait. Durant leur premier entretien, à 8 h 32, la décision d’activer le Centre divisionnaire des opérations d’urgence (CDOU) a été prise. Il a été décidé que l’inspecteur Chamberlin gérerait le CDOU à partir du quartier général à Regina (voir ci-après), et que le surintendant principal Munro interromprait ses vacances pour se rendre d’abord à Prince Albert, pour s’assurer que l’Équipe de gestion du district du Nord (EGDN) fonctionnait efficacement, puis à Regina, pour assumer ses fonctions d’OREC au quartier général. D’autres membres du personnel supérieur de la Division ont également été appelés à se rendre au CDOU, où la plupart sont restés jusqu’à la fin de l’incident.
Lorsque l’inspecteur Chamberlin et le surintendant principal Munro ont décidé d’activer le CDOU, cela a pour ainsi dire mis fin au rôle d’agent de service de l’inspecteur Chamberlin, et celui ci est devenu gestionnaire du CDOU. Même si aucun titre précis n’a été mentionné, l’inspecteur Chamberlin est pour sa part devenu commandant du CDOU. Mais peu importe le rôle que tenait l’inspecteur Chamberlin en tout temps, le surintendant principal Munro et lui sont restés étroitement alignés pendant toute la durée de l’intervention.
Comme il sera expliqué plus tard dans la section Communications stratégiques, l’inspecteur Chamberlin a approuvé la diffusion de l’alerte publique initiale dans son rôle d’agent de service, mais il n’a donné aucune orientation opérationnelle dans ce rôle. Essentiellement, le rôle d’agent de service a été de courte durée.
Au moment où l’agent de service avisait l’OREC de ce qui se passait, à 8 h 32, l’OREC avait déjà assumé le commandement global de l’incident et détenait l’ultime responsabilité de l’intervention de la GRC; cependant, toute orientation tactique en ce qui concerne l’incident en cours et l’affectation des ressources sur les lieux est restée aux mains des premiers intervenants et des groupes spécialisés qui se trouvaient sur les lieux, avec l’appui des SSOM. Bien qu’il ne soit pas officiel, l’organigramme suivant semble correspondre à la structure en évolution :
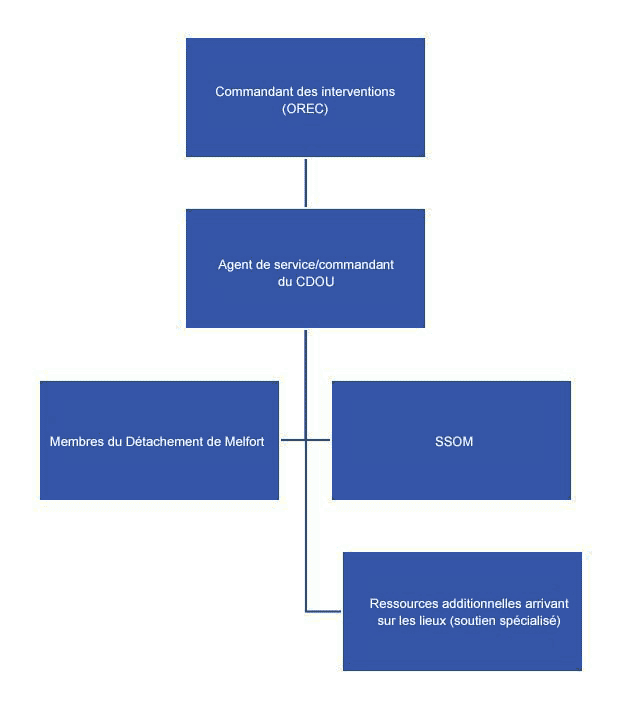
Description de l'image
Une boîte blanche contenant cinq boîtes bleues avec du texte à l’intérieur, disposées de manière hiérarchique pour illustrer l’organigramme élargi afin d’inclure l’agent de service/OREC. Le niveau de commandement le plus élevé figurant dans la case en haut de l’organigramme est celui du commandant des interventions (OREC). Le niveau inférieur est celui de l’agent de service ou du commandant du CDOU. Le troisième niveau est constitué des membres du Détachement de Melfort et des SSOM. L’agent de service ou commandant du CDOU est ensuite subdivisé en ressources additionnelles arrivant sur les lieux (soutien spécialisé).
À ce moment-ci, il n’y avait pas encore de poste de commandement d’incident. Bien que le CDOU ait été en cours d’activation afin d’aider à l’affectation des ressources, le commandant des interventions critiques (voir ci-dessous) n’était pas encore arrivé sur les lieux pour établir une base quelconque à partir de laquelle superviser l’ensemble de l’opération.
L’incident en cours était très dynamique et il est devenu apparent qu’il fallait de toute urgence intensifier l’intervention après l’arrivée sur les lieux des premiers intervenants en provenance du Détachement de Melfort. Les SSOM ont, par conséquent, procédé à un déploiement initial de ressources, et l’agent de service et l’OREC, reconnaissant que l’incident prenait de l’ampleur et qu’il fallait disposer de processus décisionnels stratégiques à plus haut niveau et à plus long terme, ont activé le CDOU, dans le but de répondre à ce besoin initial.
Centre divisionnaire des opérations d’urgence
Organisation et fonction primaire
Toutes les divisions de la GRC ont un Centre divisionnaire des opérations d’urgence (CDOU) auquel on fait appel dans les situations les plus urgentes et qui n’est pas activé pour la grande majorité des incidents critiques. Pour l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon, le rôle principal du CDOU a consisté à trouver des ressources pour appuyer la mission du commandant des interventions critiques. Le CDOU de la GRC est un peu comme un centre d’opérations d’urgence que l’on active pour des interventions ne relevant pas de la police (feux de forêt, inondations, etc.). Le CDOU en tant que tel n’est pas une fonction de commandement désignée.
Cela dit, durant l’incident dans la NCJS, le CDOU est devenu l’espace où les membres de la haute direction se sont réunis pour s’acquitter de leurs fonctions (faire rapport à un niveau supérieur, communiquer et assurer la liaison avec les gouvernements provinciaux et municipaux et la Fédération des nations autochtones souveraines, organiser des séances d’information au plus haut niveau, etc.). Le CDOU a aussi été le lieu où l’on recevait parfois l’information la plus à jour, car il disposait d’une voie de communication directe avec la Station de communications opérationnelles (explications à venir) et, en outre, toutes les ressources déployées relevaient du commandant du CDOU (l’inspecteur Chamberlin) et de l’OREC (le surintendant principal Munro), qui étaient tous deux au CDOU. On pourrait affirmer que les personnes qui se trouvaient au CDOU ont été celles qui ont eu, en tout temps, le plus haut niveau de connaissance globale de la situation, et c’est pourquoi l’orientation tactique a parfois été relayée par le CDOU. Pour essayer de prévenir une telle situation, l’inspecteur Chamberlin a tenu, au départ, des discussions ciblées avec le chef d’équipe du Groupe des crimes majeurs et le commandant des interventions critiques, dans le but d’affirmer clairement le rôle de soutien du CDOU. Malgré cela, cependant, les lignes de démarcation entre le soutien et le commandement sont parfois devenues floues, et c’est la raison pour laquelle on a décidé d’inclure le CDOU dans la section Commandement du présent rapport.
Organisation du CDOU
La structure organisationnelle du CDOU ressemble à celle du Système de commandement en cas d’incident (SCI). Lorsqu’il fonctionne au maximum de sa capacité, le CDOU comprend des volets Opérations, Planification, Logistique et Finances/ administration. Les volets Logistique, Planification et Finances sont constitués du haut vers le bas, sous la responsabilité de leur chef respectif, pour gérer l’intervention. En revanche, le volet Opérations est constitué du bas vers le haut à mesure que les ressources opérationnelles arrivent sur les lieux de l’incident. Lorsque le nombre de ressources opérationnelles augmente, il faut parfois accroître le nombre de superviseurs et élargir la section en conséquence.
En ce qui concerne l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon, ce ne sont pas tous les volets du CDOU qui ont été utilisés ou même nécessaires. Étant donné le besoin urgent de ressources, la section Logistique a été dotée en personnel presque immédiatement (comme on le verra plus loin).
Après l’activation du CDOU, le sergent Conrad Logan (sergent Logan) a été désigné comme responsable de la logistique, et il a tenu des séances d’information avec les membres du Détachement de Melfort dans le but de se renseigner sur la situation et de se faire une idée du nombre de ressources requises. Le CDOU a demandé à la Division D (Manitoba) et à la Division K (Alberta) l’envoi de 60 ressources sur les divers lieux touchés dans la NCJS, à mesure qu’on les découvrait. Le processus utilisé pour obtenir ces ressources a été efficace, ce qui s’explique en partie par l’ancienneté du sergent Logan et par le fait qu’il avait des partenaires d’autres divisions dans sa liste de personnes-ressources. On a ainsi pu répondre aux besoins en matière de ressources de manière efficace : il a été possible de demander directement l’envoi de ressources additionnelles, et les divisions ont répondu rapidement.
Les groupes de soutien comme le Service de l’identité judiciaire, le Groupe des crimes majeurs et le Groupe tactique d’intervention ont eux aussi un calendrier d’employés « en disponibilité » pour servir de renforts. Lorsqu’un détachement ou un groupe a besoin d’un soutien spécialisé, il peut faire activer ces groupes qui lui apporteront alors une expertise additionnelle pour la résolution d’un incident ou d’une situation. Durant l’intervention dans la NCJS/à Weldon, tous les groupes de soutien requis ont été avisés et dépêchés comme il se doit, conformément aux procédures d’appel normales communes à tous les groupes en disponibilité dans la Division. En tout, 549 ressources de la GRC ont été déployées dans la NCJS/à Weldon depuis une diversité de divisions, secteurs d’activités et autres groupes à l’échelle du pays.
Bien que les services municipaux locaux n’aient pas participé à l’intervention initiale, on a fini par fait appel à eux, et le CDOU les a tenus informés en conséquence tout au long de l’intervention. Le Service de police de Regina (SPR), en particulier, a été en communication constante avec le CDOU et avait au sein de celui-ci un agent de liaison chargé d’évaluer tout renseignement reçu du SPR. Ce processus a permis de garantir que seule l’information viable était transmise au commandant des interventions critiques au moment où l’on croyait que le suspect se trouvait à Regina (explications à venir).
Avant l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon, un gestionnaire du CDOU de la Division F travaillait à mettre à jour la procédure du CDOU, un projet qui n’est pas encore terminé. Cette activité a compris la tenue d’« exercices sur table » destinés à mettre en pratique l’activation du CDOU. Ainsi, trois semaines avant l’incident, une cinquantaine de membres de l’Équipe de gestion supérieure (EGS) de la Division F avaient participé à un exercice d’activation du CDOU en réponse à un événement majeur. Il est clair que cet exercice a été d’une très grande utilité au moment d’activer le CDOU lors de l’incident en cause. Aussi, l’expérience acquise lors d’incidents majeurs antérieurs survenus sur le territoire de la Division F a aidé l’équipe à reconnaître rapidement l’ampleur de la situation dans ce cas-ci.
Comme on l’explique dans la section Communications opérationnelles du présent rapport, les opérateurs de la STO (répartiteurs et téléphonistes) gagneraient à prendre part aux exercices sur table ou aux scénarios de formation organisés par le CDOU ou autre.
FPendant la majeure partie de l’intervention dans la NCJS/à Weldon, les personnes qui se trouvaient au CDOU ont bien rempli leur fonction principale de soutien.
Évolution de l’intervention
Une fois que le CDOU a été activé, la coordination des mesures et la consultation des divers organismes, groupes et commandants ont été menées à partir de cet endroit pendant toute la durée de l’intervention. Dès 13 h le 4 septembre, la haute direction avait tenu sa première séance d’information exhaustive au CDOU.
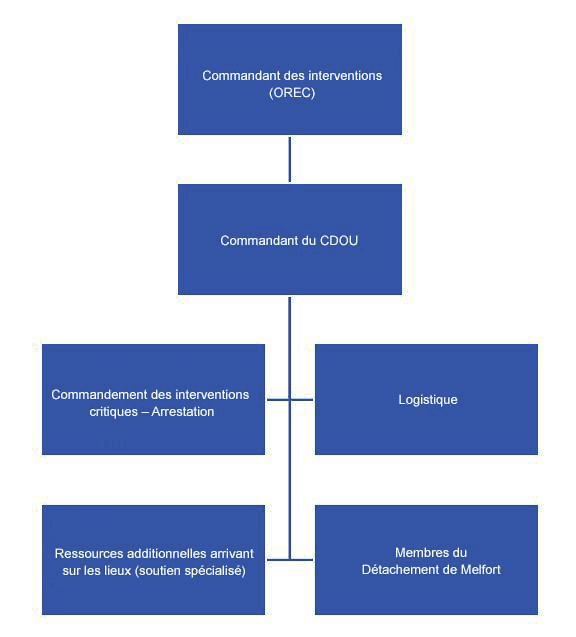
Description de l'image
Une boîte blanche avec six boîtes bleues avec du texte à l’intérieur qui sont disposées hiérarchiquement pour démontrer l’expansion de l’organigramme avec l’activation du CDOU. Le niveau de commandement le plus élevé figurant dans la case en haut de l’organigramme est le commandant des interventions (OREC). Au-dessous se trouve le commandant du CDOU. Le troisième niveau est divisé en deux parties : le commandement des interventions critiques – Arrestation et la Logistique. Le commandant du CDOU est ensuite subdivisé en deux rangées, qui correspondent aux ressources additionnelles arrivant sur les lieux (soutien spécialisé) et aux membres du Détachement de Melfort.
Entre-temps, un commandant des interventions critiques était arrivé sur les lieux et avait pris le commandement de la composante tactique (arrestation) de l’intervention. Le Groupe des crimes majeurs était en train de coordonner la gestion des lieux, l’enquête criminelle, l’arrestation du suspect et la gestion des victimes. L’arrivée de tous ces groupes et de toutes ces ressources presque en même temps a évidemment entraîné une certaine confusion dans les voies hiérarchiques.
Évolution du poste de commandement d’incident – CDOU
Comme on l’explique dans la section Commandement des interventions critiques, il est largement reconnu que le poste de commandement d’incident (PCI) est l’endroit à partir duquel le commandant des interventions critiques (CIC) supervise toutes les opérations liées à l’incident. Cette notion s’avère exacte dans la majorité des situations policières où un CIC dirige tous les aspects d’un incident critique sur les lieux. Cependant, ce n’est pas ainsi que les choses se sont passées pour l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon : en effet, lorsque la capacité du CIC de gérer l’incident dans son ensemble a atteint sa limite, le poste de commandement du GTI (explications à venir) a été remplacé par le CDOU en tant que poste de commandement d’incident pour la majeure partie de l’intervention.
Étant donné que la plupart des membres de la haute direction de la Division F travaillent au quartier général à Regina, le CDOU est logiquement devenu le lieu à partir duquel ils ont exercé leurs fonctions liées à l’intervention dans la NCJS/à Weldon. Cela dit, une fois que le CDOU a été activé et que les membres de la haute direction assumaient certaines responsabilités de commandement à partir de ce lieu, ils savaient quand même que le CIC demeurait responsable du volet tactique (arrestation) de l’opération. La question de savoir qui était le commandant était claire au niveau de la haute direction : l’enquête criminelle était menée par le Groupe des crimes majeurs tandis que toutes les décisions tactiques sur le terrain étaient prises par le CIC. Entre-temps, le CDOU continuait d’acquérir des ressources, qui étaient déployées depuis les locaux de la direction du district, à Prince Albert. Le CDOU et le CIC en sont venus à relever de l’OREC, qui était à ce moment-là, en fait, le commandant des interventions et qui dirigeait le volet stratégique de l’intervention policière. Bien qu’aucun rapport n’ait fait état de cette désignation pour l’OREC, si l’on tient compte des philosophies de commandement expliquées précédemment, il s’agit de la bonne désignation par rapport à ce qui s’est passé.
Commandement des interventions critiques
Contexte et politique
Un commandement des interventions critiques (CIC) est un officier breveté ou un sous-officier supérieur qui a suivi et réussi le cours Commandants en situation de crise offert par le Collège canadien de police. Son rôle est de diriger, de coordonner et de gérer toutes les ressources qui interviennent lors d’un incident critique. Un incident critique est un événement ou une série d’événements qui, en raison de leur portée et de leur nature, nécessitent une intervention tactique spécialisée et coordonnée.
Lors de son déploiement dans le cadre d’un incident critique, le CIC est responsable de ce qui suit :
- Gérer et contrôler l’incident et toutes les ressources connexes;
- Veiller à ce que la liaison soit établie et à ce que les renseignements soient communiqués aux groupes de soutien;
- Évaluer la situation, demander les ressources requises, assumer le commandement global et, sauf en cas de situation d’urgence, se rendre sur les lieux;
- Évaluer les efforts de confinement et d’évacuation;
- Établir un poste de commandement;
- S’assurer que les décisions sont consignées par un préposé au registre des communications;
- Autoriser les négociations;
- Approuver les plans opérationnels;
- Tenir des séances d’information et des comptes rendus appropriés;
- Approuver la diffusion de l’information aux médias;
- Assurer une transition efficace du commandement;
- Veiller à la relève en temps opportun du personnel chargé d’intervenir.
L’officier responsable des Services de soutien provinciaux (l’inspecteur Devin Pugh) est responsable du Programme des incidents critiques (PIC) à la Division F. Le PIC lui-même est un groupe de services de soutien formé pour intervenir lors d’incidents critiques. Le PIC peut être composé d’un nombre de groupes/sections de soutien provinciaux et fédéraux, y compris les suivants (la liste n’est pas exhaustive) :
- Services de l’air;
- Commandement des interventions critiques;
- Équipe d’endiguement;
- Affaires spéciales I;
- Préposés au registre des communications;
- Équipe de négociation en situation de crise (ENSC);
- Personnel du Poste de commandement;
- Opérateurs radio;
- Groupe tactique d’intervention (GTI).
Comme le prévoit le PIC, le commandant des interventions critiques (CIC) est formé pour assumer le commandement global et le contrôle de l’intervention lors d’un incident critique, un rôle qu’il tient jusqu’à ce que l’incident ne soit plus considéré comme critique ou qu’il (le CIC) soit remplacé par un autre commandant des incidents critiques. Cette procédure s’applique à la plupart des incidents critiques, dont la majeure partie est gérée avec les ressources existantes du PIC (p. ex. un GTI ou une ENSC). Lors d’un déploiement de ce genre, seuls les groupes jugés nécessaires interviennent, et la plupart des incidents sont résolus au moyen de ces ressources spécialisées, au plus bas niveau.
Cela dit, tandis que la GRC est désormais confrontée à un plus grand nombre d’incidents de ce type qui se transforment en incidents majeurs et qui exigent l’intervention d’un grand nombre de ressources (locales, divisionnaires et nationales), on reconnaît que le commandant des interventions critiques peut ne plus avoir la capacité de conserver le « commandement global » de l’intervention. C’est ce qui s’est passé dans la NCJS/à Weldon, principalement en raison de la portée et de l’envergure de l’incident, ainsi que de la rapidité avec laquelle celui-ci est devenu un incident d’envergure provinciale. L’intervention a nécessité la participation de l’effectif complet du Programme des incidents critiques, et la pression additionnelle exercée sur le commandant des interventions critiques a été très grande, dépassant ce qui est normalement attendu lors d’un déploiement « normal ». Lorsqu’une telle chose se produit, il faut que les volets stratégiques et opérationnels du commandement soient transmis à un niveau supérieur, laissant au commandant des interventions critiques la responsabilité du commandement tactique (l’arrestation du suspect, dans ce cas-ci).
Rôle du commandant des interventions critiques et intervention dans la NCJS/à Weldon
Comme il a été expliqué précédemment, le commandant des interventions critiques (CIC) initial, le sergent d’état-major Bergerman, a été avisé à 6 h 47 de ce qui se passait dans la NCJS. Après avoir reçu cet avis, le sergent d’état-major Bergerman a quitté Prince Albert à destination de la NCJS; il avait été en communication avec les Services de soutien opérationnel aux membres (SSOM) avant son départ et recevait de l’information et des mises à jour durant le trajet. Grâce à ces communications, il savait à quoi s’attendre en arrivant dans la NCJS. En outre, à son arrivée, le sergent d’état-major Simons et d’autres premiers intervenants l’ont mis au courant des derniers développements. À son arrivée, vers 9 h, le sergent d’état-major Bergerman a pris le commandement de l’intervention et y est resté pendant onze heures et demie, avant de céder la place à l’inspecteur Pugh.
L’inspecteur Pugh n’était pas en disponibilité lors de l’appel initial, le 4 septembre, mais il avait été informé de la situation lors de l’appel connexe lancé au GTI. L’inspecteur Pugh avait sa radio et son ordinateur portable chez lui et il a été en mesure de suivre la situation de près avant de remplacer le sergent d’état-major Bergerman.
En outre, les deux CIC sont restés en communication téléphonique, ce qui leur a permis d’échanger de l’information à mesure que la situation évoluait. L’inspecteur Pugh avait pris part aux séances d’information exhaustives tenues au CDOU à Regina et avait ainsi reçu de l’information complémentaire à ce qu’on lui a transmis lorsqu’il a pris la relève. La transition entre les deux CIC s’est ainsi faite de façon très harmonieuse; le rôle du CIC est resté constant pendant toute la durée de l’incident, des CIC dûment formés et informés l’ayant occupé du début à la fin.
Le CIC, à son arrivée dans la NCJS, a remplacé l’orientation de commandement et de contrôle qui avait été établie par les premiers membres intervenant (comme il a été décrit précédemment), ce qui a donné lieu à une structure de commandement plus formelle. La mission du CIC était d’« appréhender les suspects de façon sécuritaire tout en assurant la sécurité des membres du public, des policiers et des suspects ». Au même moment, le CDOU était en train d’être activé et pourvu en personnel (explications à venir), et le Groupe des crimes majeurs (GCM) avait également été déployé puisqu’il était déjà clair que l’étendue et la nature de l’incident allaient nécessiter le plus haut niveau d’enquête dans plusieurs domaines différents. (La participation du GCM sera expliquée plus en détail un peu plus loin dans le présent rapport.)
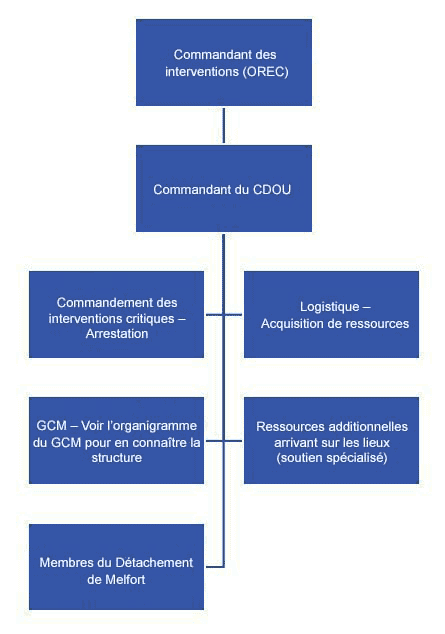
Description de l'image
Structure en évolution représentant la hiérarchie de la structure de commandement avec l’arrivée du CIC. Description longue de l’organigramme : Une boîte blanche contenant sept boîtes bleues avec du texte à l’intérieur qui sont disposées hiérarchiquement pour démontrer l’évolution de l’organigramme avec l’arrivée du CIC. Le niveau de commandement le plus élevé figurant dans la case en haut de l’organigramme est le commandant des interventions (OREC). Au-dessous se trouve le commandant du CDOU. Le troisième niveau est composé du commandement des interventions critiques – Arrestation et de la Logistique – Acquisition des ressources. Le quatrième niveau comprend le GCM (voir l’organigramme du GCM pour en connaitre la structure) et les membres du Détachement de Melfort. Le commandant du CDOU est ensuite subdivisé en une cinquième ligne qui comprend les ressources additionnelles arrivant sur les lieux (soutien spécialisé).
Mise sur pied du poste de commandement d’incident
Le poste de commandement d’incident (PCI) est, par définition, l’endroit sur les lieux d’un incident à partir duquel l’intervention est dirigée. L’une des premières responsabilités du commandant des interventions est d’établir le commandement en mettant sur pied un PCI pour assurer la clarté des voies hiérarchiques et des communications relativement à l’incident. Idéalement, un seul poste de commandement devrait être établi, et ce le plus près possible de la zone où l’incident se produit. D’autres groupes peuvent avoir des postes de commandement chargés de certains aspects d’une opération; toutefois, il ne devrait y avoir qu’un seul PCI à partir duquel est géré l’ensemble de l’opération.
Un PCI peut prendre différentes formes; par exemple, il peut s’agir du poste de commandement mobile du Programme des incidents critiques, ou simplement du véhicule du commandant des interventions critiques. On appelle normalement un tel PCI poste de commandement du GTI (PC du GTI), et il sera désigné dans la suite du présent rapport comme le poste de commandement à partir duquel travaillait le CIC, sur les lieux, durant l’intervention dans la NCJS/à Weldon.
PC du GTI (CIC)
CLe CIC a demandé la mise sur pied d’un PC du GTI immédiatement après avoir été avisé de ce qui se passait par le Groupe de soutien en cas d’incident critique, le 4 septembre. L’une des responsabilités de ce groupe, qui relève du commandant des interventions critiques, est la mise en place et l’entretien des quatre postes de commandement mobiles auxquels a accès la Division F.
Cependant, ces groupes se trouvent à Regina et n’étaient pas disponibles à l’arrivée du CIC dans la NCJS. Un poste de commandement avait été établi au bureau du conseil de bande dans la NCJS et était utilisé par des membres de la bande à leurs propres fins, mais le lieu n’étant pas sécurisé, il ne convenait pas pour les besoins du CIC. Par conséquent, le sergent d’état-major Bergerman a travaillé à partir de son propre véhicule jusqu’à midi, environ, le 4 septembre, soit jusqu’à l’arrivée du PC du GTI en provenance de Regina.
Au bout du compte, on a eu recours à trois postes de commandement mobiles pour l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon, mais pour les besoins de la présente section du rapport, on n’examinera que le PC du GTI, puisque les autres ont principalement servi de « bases d’attache » pour les autres groupes participant à l’intervention plutôt que de quartiers généraux pour diriger l’intervention coordonnée.
Le sergent d’état-major Bergerman aurait voulu, idéalement, que le PC du GTI soit établi dans la NCJS; toutefois, il avait cru comprendre que la réception radio sur le territoire était insuffisante, et c’est pourquoi il a d’abord demandé qu’il soit établi à Melfort. Lorsqu’on a réalisé que le PC disposait d’appareils d’amplification des ondes radio, on a décidé de l’amener dans la NCJS le jour suivant, où il est resté jusqu’à la fin de l’intervention. Le commandant des interventions critiques (CIC) était conscient de la manière dont la communauté allait peut-être percevoir cette décision et des barrières que cela pourrait créer. La décision d’établir le PC en dehors de la NCJS a été prise en raison d’un besoin opérationnel perçu, et une fois que tous les problèmes techniques ont été réglés par le Groupe de soutien en cas d’incident critique, le CIC est demeuré dans la région de la NCJS pour toute la durée de l’intervention.
Comme il sera expliqué ci-après, on n’a pas eu recours à un seul poste de commandement d’incident (PCI) pour diriger toute l’intervention dans la NCJS/à Weldon. Le CIC a travaillé à proximité des lieux de l’incident à partir du PC du GTI pendant la majeure partie de l’intervention. Il s’agissait du poste de commandement à partir duquel les décisions tactiques visant à appréhender le suspect étaient prises. Pour la plupart des incidents, toutes les responsabilités liées au « commandement global » d’une intervention seraient gérées à partir de ce seul poste de commandement; toutefois, en raison de l’envergure de ce qui se produisait dans la NCJS/à Weldon, le CDOU est d’abord devenu le poste de commandement d’incident, puisque c’était l’endroit où l’on disposait de l’information la plus à jour et où étaient tenues les séances d’information opérationnelle de haut niveau.
Cette structure a finalement permis au commandant des interventions critiques qui se trouvait sur les lieux, dans le PC du GTI, de poursuivre ses efforts d’arrestation, tout en s’acquittant d’un grand nombre d’autres responsabilités qui, autrement, auraient pu être oubliées. Cependant, comme on l’a déjà dit, cette évolution du CDOU en un poste de commandement d’incident semble avoir contribué à brouiller les voies hiérarchiques par moments.
Emplacement du poste de commandement d’incident
L’endroit à partir duquel les commandants prennent les décisions clés fait toujours l’objet de débats. La question de la distance entre le lieu de commandement par rapport aux lieux de l’incident durant un déploiement de ressources à grande échelle fait invariablement l’objet de longues discussions. Cependant, il ne faut pas oublier que les progrès technologiques ont modifié la nécessité d’être toujours aussi près que possible des lieux d’un incident et qu’il n’est pas rare que le poste de commandement d’incident soit situé au même endroit que la base de coordination de l’intervention. Par exemple, les appareils sans fil peuvent désormais diffuser sur des distances beaucoup plus grandes et de manière plus efficace que par le passé. Il n’est donc pas déraisonnable de dire qu’on peut avoir une bonne connaissance de la situation même à grande distance.
Le commandant des interventions critiques a envisagé de travailler depuis le CDOU, mais a fini par décider de s’installer plus près des lieux de l’incident. Si l’équipement et la technologie au CDOU de la Division F avaient été plus modernes, il aurait été possible de diriger toute l’intervention, y compris les efforts d’arrestation, à partir de ce lieu. Le sujet de la modernisation du CDOU et des efforts déployés à cet égard est examiné plus loin dans la présente section.
Groupe des crimes majeurs
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une structure de commandement traditionnelle, le Groupe des crimes majeurs (GCM) a recours aux principes de la gestion des cas graves (GCG) pour mener ses enquêtes. La gestion des cas graves utilise une hiérarchie de commandement et des rôles fondés sur les principes établis par les « normes de l’industrie » pour la tenue d’enquêtes criminelles. Les circonstances de l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon ont exigé l’élargissement de la structure du GCM à mesure que la situation évoluait. Tandis que la structure s’élargissait, les voies hiérarchiques se sont également développées. Cet « élargissement organisationnel », de même que la gestion des cas graves, sont expliqués plus en détail à la section Groupe des crimes majeurs du présent rapport. On a décidé de mentionner le GCM ici en raison de la façon dont il a interagi avec les autres structures de commandement déployées dans le cadre de l’intervention dans la NCJS/à Weldon.
Incertitude du commandement
Comme il a été mentionné précédemment, les voies de commandement étaient parfois floues, ce qui a créé de l’incertitude quant à savoir qui était chargé d’émettre certaines des directives tactiques. Le moment le plus révélateur de ce problème est peut-être celui qui s’est produit le 7 septembre lorsque le véhicule du suspect a été vu et qu’une poursuite s’est engagée.
Voici un peu de contexte : après qu’il eut été confirmé que le véhicule aperçu était celui du suspect, une poursuite s’est engagée. Le suspect, dans sa fuite, roulait parfois à des vitesses atteignant environ 140 km/h, se dirigeant vers le sud dans la voie de circulation vers le nord, au sud de Rosthern, sur la route 11, vers Saskatoon. La route 11 avait été bloquée à Saskatoon en direction sud; cependant, il y avait encore des voitures circulant entre les deux points, et celles-ci couraient des risques.
Pendant ce temps, l’inspecteur Chamberlin et le surintendant principal Munro étaient au CDOU et recevaient de l’information des SSOM, qui supervisaient la poursuite en temps réel. Le commandant des interventions critiques, à ce moment-là, n’était pas dans la zone géographique où avait lieu la poursuite, et au CDOU on croyait qu’il n’avait pas une connaissance de la situation aussi solide qu’au CDOU.
Le surintendant principal Munro et l’inspecteur Chamberlin ont brièvement discuté entre eux et ont décidé d’ordonner le retrait du véhicule suspect de la circulation. Beaucoup de temps aurait été gaspillé si l’on avait choisi de transmettre au commandant des interventions critiques les mises à jour nécessaires pour qu’il puisse prendre cette décision tactique, étant donné les circonstances. Le surintendant principal Munro a donc dit aux SSOM de transmettre par la radio l’ordre aux membres qui intervenaient d’employer toute la force nécessaire pour stopper le véhicule du suspect. Le membre des SSOM qui se trouvait dans le CDOU a obtempéré, mais il était confus, car on croyait que cette directive tactique aurait dû provenir du commandant des interventions critiques ou encore des SSOM.
Pour atténuer la confusion et l’incertitude entourant les écarts perçus par rapport à la structure de commandement, il aurait été bon de communiquer plus tôt, durant l’intervention, que le CDOU était en fait le poste de commandement d’incident qui détenait l’autorité générale et que le poste de commandement du GTI dirigeait l’aspect « arrestation » de l’opération. Au moment des faits, les personnes qui étaient en position de donner des directives à partir du CDOU auraient gagné à annoncer clairement qu’elles détenaient l’autorité et qu’elles allaient prendre les décisions tactiques nécessaires, à ce moment-là, sans interférence.
Il convient d’ajouter que l’OREC et le commandant du CDOU ont tous les deux une vaste expérience du commandement d’incidents et qu’ils étaient pleinement qualifiés pour donner des directives durant la poursuite. Le commandant des interventions critiques a reconnu qu’il aurait donné la même directive, mais selon lui, cette directive aurait dû venir du commandant des interventions critiques et non des commandants qui se trouvaient au CDOU. Là où la connaissance de la situation n’existe pas, il est indispensable d’établir un lien direct entre le commandant des interventions critiques et le poste de commandement d’incident (PCI), que ce soit en étant en personne au PCI ou par l’intermédiaire de la technologie.
Il ne fait aucun doute que la GRC sera encore appelée à intervenir dans le cadre d’autres incidents de grande envergure. L’élaboration de plans précis permettra de mieux réagir et offrira une orientation claire pour ces situations en apparence inévitables.
Une solution de rechange consisterait à désigner plusieurs commandants des interventions critiques, en fonction de l’envergure de l’incident, avec des rôles clairement définis, afin que les domaines de responsabilité ne se chevauchent pas. Ainsi, lors de l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon, on aurait pu envisager d’avoir un commandant des interventions critiques sur les lieux, responsable des efforts d’arrestation, et un autre au poste de commandement d’incident du CDOU, s’il s’agit de l’emplacement privilégié, pour le reste de la Division.
Au bout du compte, on s’entend pour dire que la décision prise et que toute incertitude entourant la structure de commandement à un moment quelconque n’a pas eu d’incidence négative sur les résultats de l’intervention dans son ensemble. L’incident survenu dans la NCJS/à Weldon symbolise peut être le fait qu’il n’y a pas de mode d’emploi unique ni d’approche universelle pour intervenir lors d’un incident comme celui-ci; dans ce cas-ci, c’est la capacité de collaborer dans l’instant présent qui a permis aux personnes aux divers niveaux du commandement de surmonter toute confusion momentanée entourant le commandement.
Résumé
Intervenir lors d’un incident d’envergure et assurer le commandement de l’opération ne sont pas sans difficulté. Peu importe le niveau de commandement établi à n’importe quel moment de l’intervention, il n’en reste pas moins que la GRC réagissait à une situation instable et en évolution. Le suspect était en fuite, et tant qu’il n’était pas appréhendé, il était impossible de confirmer que la violence était terminée. L’élément « temps » a pesé lourd sur toute l’intervention policière jusqu’à ce que le suspect soit enfin appréhendé, le 7 septembre.
Malgré les défis rencontrés, les niveaux appropriés de commandement ont été activés rapidement et employés efficacement tout au long de l’intervention. Tout défi mentionné dans le présent rapport relativement au commandement a été atténué par les relations de travail positives qui ont prévalu parmi la haute direction de la Division F. Dans l’ensemble, grâce aux structures de commandement utilisées, il a été possible d’apporter une assistance hors du commun aux victimes et de retrouver le suspect.
L’objectif de la présente section n’est pas de comparer les forces et les faiblesses du Système de commandement en cas d’incident (SCI) et de la structure Or-Argent-Bronze (OAB), mais plutôt de mettre l’accent sur la nécessité de souscrire à une structure et de reconnaître que les processus et les méthodologies de ces systèmes favorisent la prise de meilleures décisions. Tant qu’il n’y aura pas de politique nationale ou divisionnaire à cet égard, il sera impossible de déterminer à l’avance à quoi ressemblera la structure de commandement lorsqu’un incident local évolue au-delà des structures de commandement existantes.
Système de commandement en cas d’incident/structure Or-Argent-Bronze
Comme on l’a déjà mentionné, aucun organigramme exhaustif n’a été créé pour le présent incident au moment où il se déroulait, et par conséquent, l’équipe chargée de l’examen n’a pas pu recréer la structure de commandement exactement comme elle était. Au lieu d’un unique organigramme, l’équipe d’examen a établi du mieux qu’elle a pu plusieurs organigrammes conceptuels en se fondant sur toutes les entrevues tenues avec les participants. Lorsque le Service divisionnaire des enquêtes criminelles et le Service national de la police criminelle chercheront à déterminer quel pourrait être le meilleur modèle de commandement à employer à l’avenir pour les incidents majeurs, il serait peut-être utile d’avoir un aperçu de ce que l’organigramme aurait pu avoir l’air, en général, si l’un ou l’autre des deux modèles (Système de commandement en cas d’incident ou structure Or-Argent-Bronze) avait été utilisé de façon plus exclusive.
Les images ci-dessous montrent à quoi auraient pu ressembler les organigrammes organisationnels du niveau supérieur du commandement pour un incident majeur comme celui-ci.
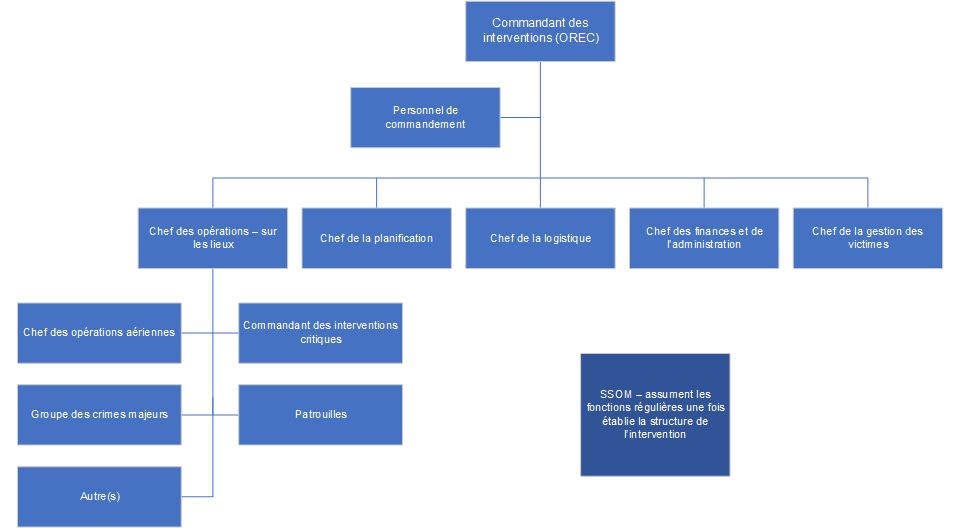
Description de l'image
Une boîte blanche avec douze boîtes bleues avec du texte à l’intérieur qui sont disposées hiérarchiquement pour démontrer l’organigramme conceptuel du SCI pour une intervention du type de celle survenue dans la Nation crie de James Smith et Weldon. Le niveau de commandement le plus élevé figurant dans la case en haut de l’organigramme est le commandant des interventions (OREC). Au-dessous se trouve le personnel de commandement. Le troisième niveau est composé du chef des opérations sur les lieux, du chef de la planification, du chef de la logistique, du chef des finances et de l’administration et du chef de la gestion des victimes. Le chef des opérations sur les lieux est ensuite subdivisé en chef des opérations aériennes, CIC, GCM, patrouilles et autres. Une case grise non incluse dans la hiérarchie contient un texte expliquant que les SSOM assument des fonctions régulières une fois que la structure de l’intervention est établie.
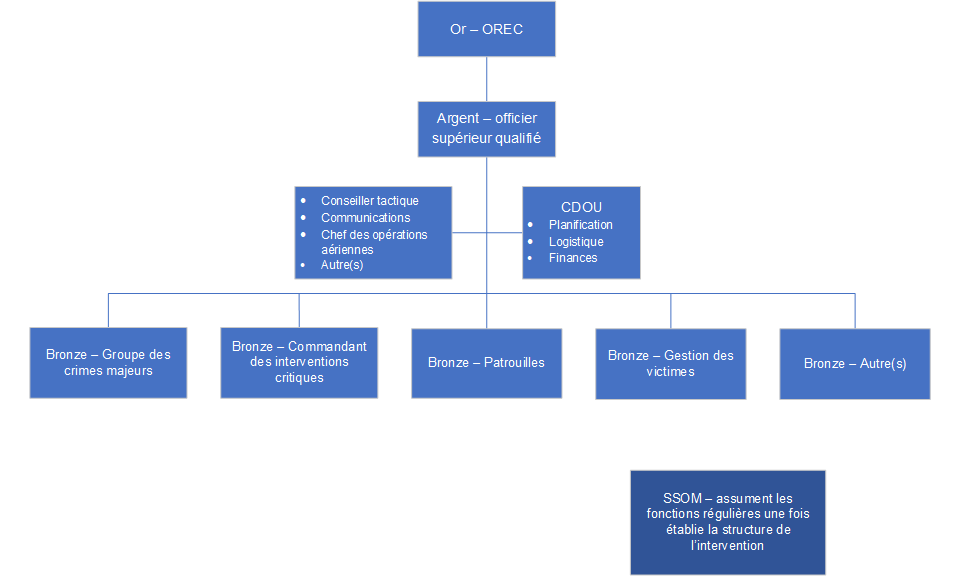
Description de l'image
Une boîte blanche avec neuf boîtes bleues avec du texte à l’intérieur qui sont disposées hiérarchiquement pour démontrer l’organigramme conceptuel OAB pour une intervention du type de celle survenue dans la Nation crie de James Smith et Weldon. Le niveau de commandement le plus élevé figurant dans la case en haut de l’organigramme est celui de l’OREC (Or). En dessous, on trouve l’officier supérieur qualifié (Argent). D’un côté de l’organigramme, sous l’officier supérieur qualifié (Argent), se trouvent le conseiller tactique, les communications, le chef des opérations aériennes et d’autres personnes. De l’autre côté de l’organigramme, sous l’officier supérieur qualifié (Argent), se trouvent le CDOU, la Planification, la Logistique et les Finances. La quatrième rangée est divisée en commandants Bronze, y compris le GCM, le CIC, les Patrouilles, la Gestion des victimes et autres. Une case grise non incluse dans la hiérarchie contient un texte expliquant que les SSOM assument des fonctions régulières une fois que la structure de l’intervention est établie.
On remarque, dans les organigrammes ci dessus, que le CDOU et les SSOM ont été inclus. Au moment d’approuver un modèle final, il faudrait également tenir compte du CDOU et des SSOM (ou du Centre des opérations en temps réel) dans toute politique nationale ou divisionnaire qui en résulterait.
Les organigrammes conceptuels ci-dessus, bien que succincts, ne visent pas à avaliser un modèle plutôt qu’un autre. Pour connaître les avantages et les inconvénients de chacun, ainsi que d’autres modèles, il faudrait réaliser une analyse beaucoup plus exhaustive que celle qui a été fournie dans le présent rapport. La principale raison pour laquelle on a inclus ces organigrammes conceptuels, c’est pour mieux expliquer comment le fait d’avoir une structure de commandement cohérente, dans l’environnement de la GRC, permettrait de rendre plus claire la question du commandement lors d’incidents majeurs futurs.
Autres constatations à propos du commandement
Fonctionnement du Centre divisionnaire des opérations d’urgence
Bien que la structure du Centre divisionnaire des opérations d’urgence (CDOU) ne soit pas spécifiquement liée à l’événement dans son ensemble, on a mentionné plusieurs fois que cette structure est dépassée et inadéquate, tant en ce qui concerne la taille de l’espace que les postes de travail.
Il existe des lacunes technologiques au CDOU. Le CDOU a accès au Système intégré de répartition de l’information (système CIIDS), décrit plus en détail dans la section Communications opérationnelles du présent rapport. En bref, le système CIIDS permet d’établir en temps réel l’image la plus vaste des ressources en jeu et de l’endroit où elles se trouvent (leur position). Le CDOU dispose d’une télévision compatible avec le système CIIDS, mais celle-ci ne fonctionnait pas le premier jour. Bien que les employés de l’Informatique ne soient pas disponibles « sur appel », un employé était disponible à court préavis et a été en mesure de régler le problème. Cette situation a fait ressortir la nécessité d’envisager la mise en disponibilité selon un système de rotation pour les employés de l’Informatique. Cependant, le principal problème persiste, à savoir qu’il a été impossible de faire le suivi des ressources pendant les premières étapes d’une intervention importante comme celle-ci.
Aussi, il a semblé par moments qu’il était trop facile d’accéder au CDOU pendant l’intervention dans la NCJS/à Weldon; en effet, un trop grand nombre de personnes s’y trouvaient en tout temps. Le problème s’est aggravé le 4 septembre, alors que l’inspecteur Devin Pugh (inspecteur Pugh) était commandant des interventions critiques (CIC) au CDOU (explications à venir). En raison des va-et-vient constants dans le CDOU, l’inspecteur Pugh s’est senti obligé de déménager, d’abord à la cafétéria de l’immeuble puis, finalement, au poste de commandement dans la NCJS. Le CIC s’est senti mieux en mesure de diriger l’intervention à partir de cet endroit, car le CDOU était trop achalandé. Bien que la décision de déménager le poste de commandement ait probablement été la meilleure option pour le CIC, cela fait ressortir le problème de l’espace restreint au CDOU et du trop grand nombre de personnes qui y ont accès, plus particulièrement de personnes qui n’ont pas besoin de s’y trouver durant des moments décisifs.
En outre, le 7 septembre, lors de la poursuite et de l’arrestation du suspect, la salle du CDOU était remplie de membres de la haute direction qui donnaient des directives durant l’opération. L’atmosphère était « chaotique » par moments, ce qui limitait la capacité de tous de fonctionner au maximum de leur capacité. Outre l’éventuelle réorganisation du CDOU, il faudrait aussi envisager d’en limiter l’accès strictement aux membres de la haute direction qui ont besoin d’être présents lors d’un incident majeur.
À la fin de 2022, la Division F de la GRC a créé un comité divisionnaire de l’innovation et déterminé que la modernisation du CDOU était l’une de ses priorités. Les derniers incidents majeurs survenus en Saskatchewan avaient fait ressortir le besoin d’améliorer l’équipement et de régler les lacunes technologiques au CDOU. Des travaux ont été entamés pour améliorer la capacité de diffusion de flux vidéo en direct, la connectivité à l’outil ATAK, la vitesse du Wi Fi, l’accès aux amplificateurs de signal cellulaire et l’étendue de la couverture du Réseau provincial de télécommunications de sécurité publique (RPTSC).
Un projet dirigé par le groupe de la gestion des biens et de l’informatique de la Division F vise à rénover le CDOU pour améliorer l’ergonomie et l’espace opérationnel et accroître l’interopérabilité entre la GRC et les organismes provinciaux et municipaux.
Confinement
Durant l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon, comme des suspects ont rapidement été identifiés, l’un des premiers objectifs du commandant des interventions critiques (CIC) a été le confinement. Le contrôle du périmètre et le confinement sont des éléments cruciaux de l’intervention immédiate lors d’un incident critique, et il s’agit d’éléments préalables du commandement des interventions. Naturellement, la tâche la plus importante pour le CIC au départ a consisté à essayer de confiner les suspects.
Le confinement initial a posé problème et a pris plus de temps que prévu, surtout en raison du nombre limité de ressources disponibles à ce moment-là et de la distance à parcourir entre la NCJS et le lieu à partir duquel elles étaient déployées. De plus, une fois que les ressources ont commencé à arriver, il a été difficile d’en faire le suivi (explications à venir). Malgré cela, le CIC est d’avis que les ressources ont été affectées de manière appropriée dans les circonstances. En gros, la STO et les SSOM ont dépêché toutes les ressources disponibles sur les lieux, et le CIC a fait de son mieux avec les ressources qu’il avait. Le CIC était en communication avec le Service de police de Saskatoon, le Service de police de Prince Albert et le Service de police de Regina, et il a chargé la Sécurité routière provinciale et les Services de sécurité routière de la GRC de participer aux efforts de confinement. Dès 9 h 35, des postes de contrôle routier avaient été établis sur la route 3 à Prince Albert, sur la route 6 au sud de Melfort et sur l’autoroute entre Melfort et Kinistino. Les SSOM ont communiqué avec le Service de police de Saskatoon, qui a effectué des contrôles routiers sur la route 11 Nord.
Cela étant dit, le problème du déploiement des ressources qui se posait pour le CIC est le fait qu’on ignorait exactement où se trouvaient les suspects. Comme on l’a déjà expliqué dans la Chronologie de l’incident, la présence du véhicule des suspects, une Nissan Rogue noire, a été confirmée à 7 h 27 à Weldon grâce à des images captées par une caméra de surveillance. Environ une demi-heure plus tard, le périmètre s’est agrandi lorsqu’une personne a signalé la présence possible des suspects à 28 km au sud-est de Weldon, non loin de Beatty (Saskatchewan). Un autre signalement que l’on a cru fiable plaçait les suspects à Regina vers midi, provoquant un détournement de l’attention vers cet endroit jusqu’à ce que l’information soit discréditée plus tard dans la journée. D’autres signalements crédibles n’ont pas été reçus avant une heure avancée de l’après-midi, le 4 septembre, lorsque plusieurs personnes ont signalé avoir aperçu les suspects dans le secteur de Crystal Springs entre 16 h et 20 h. Entre le 4 septembre et le 7 septembre, un grand nombre de personnes ont signalé la présence possible des suspects en Saskatchewan et ailleurs au pays. Il va sans dire que, sans renseignements fiables, le mieux que l’on pouvait faire était d’essayer de déduire où les suspects pouvaient se trouver.
Durant les jours de l’intervention, le CIC a déployé tous les moyens à sa disposition pour délimiter le secteur dans lequel le suspect pouvait se trouver, mais ce n’est qu’après les événements ayant débuté à 14 h 6 le 7 septembre, lorsque le suspect a volé une Chevrolet Avalanche blanche non loin de Wakaw, qu’il a été possible d’établir un quelconque confinement. À 15 h 17, la GRC avait repéré le suspect, qui roulait vers l’ouest en tentant d’atteindre l’autoroute 11.
Soutien du commandant des interventions critiques
Le commandant des interventions critiques (CIC) s’est joint à l’opération au moment où l’on recevait une quantité énorme d’information. Normalement, dans des situations comme celle-ci, un préposé au registre des communications doit consigner en temps réel les processus décisionnels du CIC ainsi que les tâches connexes confiées aux ressources pour répondre aux objectifs. Le préposé peut consigner les discussions stratégiques du CIC ayant mené aux décisions, ce qui permet, une fois l’incident terminé, de répondre aux questions associées au principe de « que savions-nous et quand l’avons-nous su? »
Le CIC a son propre préposé au registre des communications; toutefois, durant l’intervention, cette ressource avait été détournée et on n’a pas demandé son remplacement. Le CIC a donc demandé à un membre régulier de la GRC de l’accompagner à ce titre, ce qui n’était pas idéal puisque le membre en question n’avait pas suivi de formation dans ce domaine. Le CIC a quand même fait de son mieux pour que toute l’information et les décisions soient consignées convenablement. Malgré cela, il aurait été bon d’avoir un préposé au registre officiel pendant toute l’intervention.
Mode opératoire commun
L’inspecteur Pugh a reconnu avoir eu une connaissance limitée de l’endroit où se trouvaient en tout temps les ressources des Services généraux lorsqu’il a pris le commandement des interventions critiques le 4 septembre. Ce problème fait ressortir la nécessité de créer un environnement opérationnel commun, ou mode opératoire commun (MOC).
Un MOC est un outil d’affichage de l’information pertinente permettant aux personnes qui commandent et contrôlent une intervention de prendre des décisions éclairées fondées sur la connaissance de la situation. Lorsqu’il fonctionne comme il se doit, le MOC affiche l’information sur un support visuel (p. ex. la position des ressources), et cette information peut alors être visualisée par toutes les personnes qui occupent des fonctions de commandement.
Pour l’intervention dans la NCJS/à Weldon, un MOC aurait été utile non seulement pour le CIC sur les lieux, mais aussi pour les personnes qui se trouvaient au CDOU à Regina. Lorsque les incidents ont commencé à attirer l’attention à l’échelle nationale, la haute direction à Ottawa a voulu recevoir elle aussi des mises à jour. Les demandes en provenance de la Direction générale (DG) sont vite devenues ingérables puisque tous les intervenants de la Division F étaient déjà lourdement surchargés et qu’il n’y avait personne à qui déléguer cette tâche. La DG a bel et bien envoyé de l’aide, mais lorsque la ressource est arrivée, le 6 septembre, beaucoup de temps s’était déjà écoulé.
Un mode opératoire commun aurait pu atténuer la pression créée par la nécessité de fournir des mises à jour à la DG; néanmoins, la présence d’une ressource de la DG sur les lieux de l’intervention offre plusieurs avantages. Lorsque la DG est tenue au courant de la situation, notamment en temps réel, elle est mieux en mesure d’apporter son aide plutôt que d’être perçue comme une couche hiérarchique supplémentaire.
Par ailleurs, pour les divisions qui disposent d’un Système de gestion des urgences (EPI) performant, il peut y avoir une option permettant de recevoir à distance des rapports réguliers sur la situation et d’avoir accès à l’intervention par voie électronique. Bien que le EPI ne soit pas un élément sur lequel le présent examen se soit penché, il convient quand même de le mentionner rapidement à ce moment-ci.
Lors d’incidents dynamiques comme celui qui s’est produit dans la NCJS/à Weldon, il est essentiel d’avoir un mode opératoire commun (MOC) en temps réel. Une grande partie de l’intervention initiale a consisté à affecter les ressources tandis que le commandement tentait de sécuriser un grand nombre de lieux et de confiner le suspect. Il était essentiel de savoir quelles ressources étaient disponibles et de connaître leur position. Cette question a d’ailleurs été abordée dans d’autres examens comme celui-ci.
Pour atténuer l’absence d’un MOC, des mesures ont été prises pour « improviser » un mode opératoire par l’entremise des membres qui utilisaient le système CIIDS sur leur poste de travail mobile et des membres qui avaient accès à l’application ATAK sur leur cellulaire et au SAMM sur leur poste de travail mobile. Le SAMM (Module de rapport de situation et de messagerie), comme on l’explique à la section Communications opérationnelles, a apporté une certaine solution au problème du manque de connaissance de la position des membres sur le terrain; toutefois, pour que cela fonctionne, il fallait que les membres sachent qu’ils pouvaient mettre leur situation à jour eux-mêmes, comme le demande la politique. Bien que la combinaison de ces fonctions ait accru la capacité des divers commandants de répartir les ressources, cela ne leur a cependant jamais permis d’obtenir un mode opératoire commun.
On mentionne souvent l’application ATAK dans le présent rapport en tant que solution possible aux problèmes de suivi des ressources et aux lacunes dans la communication qui se sont présentés durant l’intervention dans la NCJS/à Weldon. Les prochains paragraphes portent sur l’application ATAK et ses fonctions, en guise de contexte.
ATAK est une application logicielle et un cadre de cartographie pour appareils mobiles qui favorise la circulation de l’information et la communication efficaces depuis le terrain vers les divers postes de commandement (postes mobiles, CDOU). ATAK offre aussi des fonctions comme la messagerie texte, la mesure de distances, l’imagerie satellitaire, l’analyse du terrain, le clavardage et la communication vidéo, ainsi que des outils d’échange d’information qui favorisent la sécurité et la collaboration. ATAK peut fournir une image en temps réel des opérations en affichant la position des membres sur une multitude d’appareils, comme les téléphones Android et les téléviseurs grand écran. L’information ainsi obtenue peut être transmise à l’échelle locale, régionale et nationale.
L’intérêt de la GRC envers l’application ATAK en tant qu’outil favorisant un mode opératoire commun (MOC) ne découle pas seulement de l’avantage tactique qu’elle offre; en effet, il s’agit également de recommandations formulées dans le rapport MacNeil.
[CAVIARDÉ]
[CAVIARDÉ]
[CAVIARDÉ]
Service de l’air de la GRC
Le Service de l’air de la GRC offre un soutien opérationnel direct dans des domaines techniques et spécialisés de la surveillance policière aérienne, ce qui permet aux membres de première ligne de préserver la paix, de faire respecter la loi, de prévenir le crime et de mener des enquêtes. Le Service de l’air peut mobiliser le personnel et l’équipement nécessaires pour répondre aux diverses demandes de la GRC et fournir un soutien à la GRC dans les régions très peuplées et dans les régions éloignées du Canada.
Le parc aérien de la GRC, qui comprend des avions et des hélicoptères aux fins de missions précises, a des bases à des endroits stratégiques au pays82. Le Service de l’air de la Division F a deux bases aériennes, à savoir une à Regina et une à Prince Albert, et dispose normalement de trois aéronefs. Toutefois, lors des incidents survenus dans la NCJS/à Weldon, seulement deux aéronefs étaient opérationnels.
La base aérienne de Regina se sert du Pilatus PC-12 NG [CAVIARDÉ] à voilure fixe (C-GMPW) et du Cessna T206H à voilure fixe (C-FSWC).
- Le GMPW se distingue [CAVIARDÉ] et sert généralement au transport de passagers.
- Le Cessna FSWC n’était pas opérationnel au moment des incidents survenus dans la NCJS/à Weldon (explications à venir).
La base aérienne de Prince Albert a un Pilatus PC 12/NG à voilure fixe (C-GMPA). Il s’agit d’un appareil Pilatus PC 12 typique, presque identique au C-GMPW, sauf qu’il sert uniquement au transport d’employés et de marchandises. [CAVIARDÉ].
Le Service de l’air de la Division F a accès à d’autres aéronefs de la GRC et au personnel ou à l’équipement d’autres divisions en cas d’urgence, sous réserve de l’approbation de la haute direction de la Division et de la Sous-direction du service de l’air à Ottawa.
Durant l’intervention menée dans la NCJS/à Weldon, les ressources aériennes suivantes ont été demandées ou utilisées :
- Aéronef à voilure fixe PC12-47 [CAVIARDÉ] (C-GMPW) de la Division F;
- Hélicoptère AS350/H125 (C-FMPP) de la Division K;
- Aéronef du Service de police de Saskatoon (SPS);
- Aéronef à voilure fixe PC12-47 Spectre (C-GMPB) de la Division O;
- [CAVIARDÉ]
Disponibilité opérationnelle
En recevant l’avis de ce qui se passait dans la NCJS le matin du 4 septembre, le commandant des interventions critiques (CIC) a immédiatement décidé de faire appel au Service de l’air. Comme on ignorait où se trouvaient les suspects et qu’on disait qu’ils se déplaçaient en véhicule, il était clair qu’on devait les retrouver et les empêcher d’aller plus loin. L’utilisation d’aéronefs pour ce faire a été considérée comme une option viable.
Le matin du 4 septembre, les Services de soutien opérationnel aux membres (SSOM) ont communiqué avec le Service de l’air de la Division F, mais on leur a dit que le Cessna n’était pas opérationnel à ce moment-là. On a donc communiqué avec le Service de police de Saskatoon, et l’aéronef du Service de police de Saskatoon (SPS) a pris son envol vers 8 h. Le Cessna est l’appareil auquel le Programme des incidents critiques fait le plus souvent appel [CAVIARDÉ]. L’aéronef du SPS a les mêmes capacités et on l’utilise souvent à la place de l’aéronef de la GRC. [CAVIARDÉ], mais celui-ci est désuet et a besoin d’une mise à niveau majeure. Le produit [CAVIARDÉ] est de qualité médiocre et n’aurait pas été efficace durant l’intervention dans la NCJS/à Weldon. La Division O et la Division C ont des appareils de même type (GMPB et C-GMPQ, respectivement), qui sont dotés d’équipement plus moderne et qui auraient été mieux en mesure d’aider s’il avait fallu obtenir des photos ou des vidéos aériennes de qualité.
Cette incapacité du Service de l’air de la GRC à participer aux opérations dans l’immédiat a mené les intervenants à conclure qu’il est difficile et fastidieux de faire appel à lui. Or, lorsqu’on présume d’emblée qu’il est difficile d’avoir accès aux appareils de la GRC ou que ceux-ci ne seront pas disponibles, on se tourne généralement vers d’autres organisations pour les situations d’urgence, comme ce fut le cas ici lorsqu’on a fait appel au SPS.
Gestion des ressources aériennes
Lorsqu’on examine la propriété des ressources aérienne de la Division F, l’inaccessibilité des appareils n’est pas nécessairement le problème. En effet, à la Division F, les aéronefs n’appartiennent pas au gouvernement fédéral, mais plutôt au gouvernement provincial, qui les loue. En ce qui concerne le Pilatus MPW, par exemple, toute demande de mise à niveau, [CAVIARDÉ], doit être soumise au gouvernement de la Saskatchewan. Le Cessna, pour sa part, qui appartient au gouvernement fédéral, avait été immobilisé au sol pour des problèmes ergonomiques et techniques. Même si l’on sait qu’il faut moderniser le matériel de mission et régler les problèmes empêchant l’utilisation de certains biens par les groupes policiers de première ligne, le gouvernement provincial semble réticent à fournir les fonds. Le Service de l’air de la Division F a déjà soumis un grand nombre d’analyses de rentabilisation au gouvernement provincial et maintenant, à la suite de plusieurs incidents très médiatisés, on espère que des progrès seront enfin accomplis à cet égard. Mais en attendant, le Service de l’air de la Division F se trouve dans l’impossibilité de prêter une assistance efficace lors des opérations.
Après avoir obtenu l’aéronef du SPS, on a fait appel à l’hélicoptère FMPP de la Division K, qui est arrivé dans la région de Rosetown vers 14 h 6 le 4 septembre. Pendant ce temps, quelqu’un avait signalé que les deux suspects se trouvaient à Regina et qu’ils envisageaient de se rendre à la police. Le Service de police de Regina avait reçu un renseignement du public selon lequel la Nissan Rogue noire mentionnée dans les alertes publiques avait été vue. Un numéro de plaque d’immatriculation n’avait pas été fourni à l’opérateur, mais celui-ci a présumé que le numéro était celui du véhicule des suspects et a inséré cette information dans le renseignement. La présence du numéro d’immatriculation a donné de la crédibilité au renseignement, et c’est ce qui a provoqué, d’abord, le demi-tour de l’hélicoptère vers Regina et, ensuite, la diffusion d’une deuxième alerte publique, à 12 h 7, avisant la population qu’un suspect avait été vu sur l’avenue Arcola à Regina.
Au bout du compte, il n’y a eu aucune confirmation par la suite selon laquelle les suspects ou le véhicule avaient été vus à Regina. Le faux renseignement a provoqué un détournement momentané de l’attention d’un nombre limité de ressources à Regina, mais cela n’a pas freiné les efforts déployés au même moment dans la NCJS/à Weldon.
Au même moment, cependant, on obtenait d’autres ressources aériennes de partout au pays, et on a décidé de les rassembler à Regina. Cette décision a fini par devenir un obstacle, car le vol en direction nord vers la NCJS nécessitait 40 minutes additionnelles. Pour atténuer ce problème, il a été décidé de stationner l’hélicoptère directement dans la NCJS, puisque c’était le plus lent de tous les aéronefs.
Enjeux relatifs aux horaires
La plupart des problèmes survenus entre le Service de l’air de la Division F et le CIC ont tourné autour des horaires et de la coordination des aéronefs. À un moment donné, on a reçu six demandes de différentes personnes en même temps. Le CIC, le CDOU et la STO étaient tous en mesure de communiquer directement avec l’officier de vol tactique (OVT), les pilotes, les gestionnaires de la base ou l’officier responsable du Service de l’air. En raison de la crise en cours, le protocole a été ignoré.
Il convient tout particulièrement de souligner la situation qui s’est produite le 7 septembre, après que le suspect eut été identifié à une résidence à Wakaw; à ce moment-là, les trois aéronefs étaient à terre en train d’être ravitaillés à Prince Albert (explications à venir). Le CIC croyait que l’hélicoptère FMPP était disponible pour la surveillance aérienne, mais il ne savait pas que le Groupe des crimes majeurs (GCM) s’en était servi plus tôt et que l’appareil avait maintenant besoin de carburant. Cette situation a causé des retards à un moment crucial, ce qui fait ressortir l’un des principaux problèmes survenus lors de l’intervention : un trop grand nombre d’entités (à savoir le gestionnaire de la base aérienne de Regina, l’officier hiérarchique du Service de l’air de la Division F, le CIC, le GCM et l’officier de vol tactique) avaient accès au Service de l’air. Un point de contact unique, comme un chef des opérations aériennes ou un coordonnateur des vols (explications à venir), aurait pu diriger toutes les demandes de services, mais un tel rôle n’avait pas été attribué ou a été sous-utilisé.
Cette situation a entraîné un manque de clarté dans les différents rôles et, en fin de compte, de la confusion de la part du personnel navigant quant à savoir auprès de qui il devait recevoir ses instructions. Par exemple, le Pilatus GMPW était utilisé [CAVIARDÉ], mais aussi pour le transport. À un moment donné, le pilote a reçu du gestionnaire de la base aérienne de Regina et de l’officier hiérarchique l’instruction de faire le plein de carburant au cas où on aurait besoin de l’appareil pour une longue période [CAVIARDÉ], mais on lui a ensuite demandé de transporter une pleine charge de passagers hors de Melfort. L’appareil ayant une masse maximale au décollage, le pilote n’a pas pu embarquer tous les passagers parce que le réservoir de carburant était plein et que l’appareil était alors trop lourd.
Ces décisions n’ont pas été prises par un chef des opérations aériennes, mais plutôt par les pilotes eux-mêmes, qui étaient en communication directe avec divers commandants qui leur donnaient des instructions. Durant une crise, les pilotes suivent les instructions qu’ils reçoivent, et parce que les commandants communiquaient directement avec eux, il leur est parfois arrivé, en gros, de voler sans but précis. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles les trois appareils se sont retrouvés au sol en même temps à Prince Albert pour être ravitaillés tout juste avant la poursuite finale le 7 septembre. Cette situation, on le répète, a causé un bref retard, mais tous les appareils ont fini par être déployés, ce qui n’était pas idéal non plus. En effet, une situation durant laquelle quatre aéronefs se retrouvent dans les airs au même endroit et au même moment mérite d’être gérée par un chef des opérations aériennes ou, mieux encore, devrait être entièrement évitée pour des raisons de sécurité.
De plus, pour la Sous-direction nationale du service de l’air (SDSA), il a été difficile d’obtenir de l’information au moment de déterminer quelles étaient les ressources requises dans la Division F tout en essayant de déployer ces ressources. Un coordonnateur des vols aurait dû tenir le rôle de premier point de contact, mais ce rôle n’a pas été utilisé. Par conséquent, il a fallu se fier au personnel navigant déjà déployé pour obtenir l’information requise afin d’appuyer adéquatement le Service de l’air de la Division F. Si on avait pu communiquer directement avec un coordonnateur des vols, ou si un chef des opérations aériennes avait été désigné dans le cadre de cette intervention, on aurait pu éviter un tel scénario.
Distinction entre chef des opérations aériennes et coordonnateur des vols
Le coordonnateur des vols et le chef des opérations aériennes ont des rôles distincts. Le chef des opérations aériennes est normalement un expert du Service de l’air qui a de l’expérience dans les domaines de l’aviation et de la gestion d’événements majeurs ou d’incidents critiques. Le chef des opérations aériennes travaille habituellement à partir du poste de commandement d’incident.
Chaque division de la GRC a un coordonnateur des vols qui, essentiellement, s’occupe de tout ce qui concerne l’attribution des ressources aériennes. Le coordonnateur des vols voit les diverses demandes et en détermine la priorité, évalue la capacité des aéronefs, évalue l’environnement opérationnel, applique les techniques de répartition, attribue les tâches aux équipages, désigne les membres des équipages et gère les horaires. Les aéronefs figurent parmi les biens les plus importants dans toute division, et la seule façon de les employer efficacement est par l’intermédiaire du coordonnateur des vols. Le coordonnateur des vols travaille à partir de la base des opérations et dirige les opérations au niveau de la base, en fonction des demandes opérationnelles et des directives qu’il reçoit du chef des opérations aériennes. À tout le moins, le coordonnateur des vols de la Division F aurait pu servir d’intermédiaire entre le Service de l’air et les diverses entités qui présentaient des demandes de services, mais il a apparemment été exclu de toute conversation quand il a été question des ressources aériennes.
La principale lacune de l’intervention du Service de l’air dans le cadre des incidents survenus dans la NCJS/à Weldon a été la combinaison du fait que le commandement local n’a pas fait appel à un coordonnateur des vols et n’a pas désigné un chef des opérations aériennes durant l’intervention.
La recommandation suivante du rapport MacNeil s’applique à cet égard :
L’obligation de faire appel à une personne d’expérience qui connaît bien les rouages du Service de l’air et de la placer directement au CDOU ou au poste de commandement est un élément crucial qui a été négligé. Par conséquent, il n’a pas été possible de mobiliser correctement le Service de l’air et de l’employer au maximum de sa capacité.
On semble ne pas savoir exactement à qui incombait la tâche de désigner le chef des opérations aériennes. Bien que l’officier hiérarchique du Service de l’air ait été dépêché au quartier général de la Division F le 4 septembre au matin dans le cadre de l’appel de service initial, il n’a pas été désigné chef des opérations aériennes à ce moment-là. Durant les premières étapes de la planification, on n’a ni discuté du rôle du chef des opérations aériennes ni suggéré qu’il devait y en avoir un, et l’officier hiérarchique du Service de l’air n’a pas assumé ce rôle de manière spontanée. Même si l’officier hiérarchique du Service de l’air a pris part aux séances d’information du CDOU, aucun chef des opérations aériennes n’a été officiellement désigné pour participer en temps réel à la prise de décisions tactiques. Cette fonction aurait permis de combler un grand nombre des lacunes relevées dans les communications. En réalité, le Service de l’air de la Division F travaille très peu avec le CIC, il semble y avoir un manque de communication entre les deux entités puisque le CIC a eu très peu de succès pour ce qui est d’obtenir des ressources aériennes de la GRC, et le Service de l’air partage cette frustration.
Peu importe à qui incombait la responsabilité de désigner un chef des opérations aériennes, le fait est que tous les intervenants désiraient obtenir l’aide du Service de l’air, mais que la désignation d’un point de contact unique n’a pas été envisagée pour rendre le processus plus efficace. Il en a résulté une structure floue dans laquelle on a fait appel au Service de l’air par tous les moyens jugés nécessaires, à n’importe quel moment.
[CAVIARDÉ]
[CAVIARDÉ]
[CAVIARDÉ]
[CAVIARDÉ]
Ce qui suit est une recommandation découlant du rapport MacNeil :
Malgré la recommandation qui précède, il semble que le Service de l’air de la Division F et le Programme des incidents critiques (et, par extension, le GTI) ne se sont pas entraînés ensemble et n’ont pas participé ensemble à des exercices dans le but de mieux comprendre l’interopérabilité de leurs compétences et de leurs tactiques. Par conséquent, chaque programme ne comprenait pas pleinement les capacités de l’autre durant l’intervention dans la NCJS/à Weldon, ce qui a forcé tous les intervenants à apprendre sur-le-champ.
[CAVIARDÉ]
Que ce soit en raison de problèmes de communication, de lacunes technologiques ou du manque d’interopérabilité avec le Service de l’air, la capacité d’intervention du CIC a été réduite.
[CAVIARDÉ]
[CAVIARDÉ]
[CAVIARDÉ]
[CAVIARDÉ]
Depuis l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon
Depuis l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon, la Sous-direction du service de l’air a relevé des lacunes dans la disponibilité des capacités de surveillance aérienne à l’échelle du pays et s’affaire à mettre sur pied des groupes de travail auxquels siègent des OREC et qui seraient chargés de cerner et de confirmer les exigences générales et des solutions possibles. En raison d’incidents récents à grand retentissement (notamment l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon), la demande de soutien du Service de l’air s’est accrue. Afin de mieux fournir une aide en cas d’incidents critiques, le Service de l’air est en train de revoir son modèle de service actuel afin d’être en mesure d’offrir un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année.
Intervention du Groupe des crimes majeurs
Le Groupe des crimes majeurs (GCM) de la Division F compte plus d’une trentaine d’enquêteurs de la GRC et plusieurs employés civils qui fournissent un soutien en matière d’analyse, de divulgation et d’administration.
Le GCM offre des services à toutes les collectivités où la GRC assure l’application de la loi en Saskatchewan, y compris dans la NCJS et à Weldon. De plus, il prête son assistance à des services de police indépendants lors d’enquêtes sur des homicides et des morts suspectes survenus sur leur territoire de compétence.
En Saskatchewan, le GCM compte trois équipes (deux à Saskatoon et une à Regina). La structure de commandement comprend un surintendant et un inspecteur (poste vacant en ce moment). Chaque équipe est dirigée par un sergent d’état-major et compte des sergents, des caporaux et des gendarmes. Les membres du groupe sont hautement qualifiés, expérimentés et dévoués. Les enquêteurs du GCM suivent diverses formations au Collège canadien de police de même qu’une multitude de cours dans des domaines comme les enquêtes sur les décès, les techniques d’entrevue, la divulgation, la preuve médico-légale et numérique, la gestion de cas graves et la rédaction d’autorisations judiciaires en tous genres, comme des mandats de perquisition.
Le GCM intervient et enquête principalement lors d’homicides, mais il peut également apporter son soutien dans les cas suivants :
- Décès d’une personne par suite de l’intervention de la police ou pendant sa détention;
- Personne disparue dans des circonstances suspectes;
- Incident susceptible d’attirer une grande attention politique, nationale ou médiatique;
- Situation de tireur actif, de prise d’otages, de personne barricadée, de détournement d’avion ou d’enlèvement;
- Blessures graves ou décès d’un membre de la GRC en service;
- Découverte de restes humains dans des circonstances suspectes;
- Fusillade mettant en cause un membre de la GRC;
- Tout incident ou enquête, à la discrétion de l’officier responsable ou de son représentant.
Durant une intervention faisant suite à un homicide, le GCM est responsable de coordonner les divers groupes qui prêtent leur aide et de gérer les lieux du crime.
Intervention initiale du Groupe des crimes majeurs et attribution des tâches
Le sergent d’état-major Rob Zentner, qui était en disponibilité pour le GCM le 4 septembre, a été informé de ce qui se passait dans la NCJS vers 7 h. Il a reçu à ce moment-là de l’information selon laquelle il y avait au moins un mort et deux suspects. Les appels aux membres de l’équipe ont commencé immédiatement selon le processus normal.
À l’arrivée de l’équipe au bureau de Saskatoon et avant son départ pour Melfort, on a passé en revue plusieurs plaintes liées à l’incident dans le SIRP et il est devenu évident que le nombre de victimes augmentait rapidement. Par conséquent, on a pris des dispositions pour obtenir des ressources supplémentaires, en plus de celles du GCM qui intervenaient déjà. Au moment où l’équipe du GCM quittait Saskatoon en direction de Melfort, le nombre de décès était déjà passé à sept. Toute l’équipe du GCM en disponibilité (onze membres) a été dépêchée ainsi que les ressources suivantes :
- Dix membres qui étaient en disponibilité opérationnelle;
- Des membres sollicités qui n’étaient pas en disponibilité opérationnelle;
- Des équipes additionnelles du GCM de Saskatoon;
- Deux tiers des membres de l’équipe du GCM de Regina;
- Des membres du Groupe des homicides non résolus;
- Des ressources de la Section des enquêtes générales de la Division F;
- Des ressources du GCM de la Division K;
- La GCM de la Division K a pris en charge la disponibilité du GCM de la Division F.
Un membre du GCM de Saskatoon qui n’était pas en mesure de participer au déploiement le 4 septembre a été chargé de recueillir de l’information par téléphone directement auprès des membres de la GRC de Melfort qui intervenaient tandis que les autres se préparaient à partir. Il a ainsi été possible d’organiser une séance d’information avec les ressources du GCM de Saskatoon à 8 h 45, avant leur départ, durant laquelle les renseignements suivants ont été fournis :
- La GRC de Melfort avait reçu une première plainte signalant l’incident;
- Une vingtaine d’autres plaintes avaient été reçues par la suite;
- On avait signalé que deux personnes s’introduisaient par effraction dans des résidences de la NCJS;
- Le GTI et les Services cynophiles avaient été déployés dans le secteur pour tenter de retrouver et d’arrêter les suspects;
- Les suspects avaient été identifiés et on avait une description d’eux et du véhicule qu’ils avaient en leur possession (Nissan Rogue noire);
- Le bureau de la bande de la NCJS était utilisé pour accueillir les victimes, et l’ambulance aérienne du STARS avait déjà commencé à transporter les victimes hors de la collectivité;
- Le décès de sept personnes avait été confirmé et le nombre exact de blessés n’était pas connu à ce moment-là;
- La police avait également reçu une plainte à Weldon au sujet d’un jeune homme coupé au visage qui demandait à être transporté à l’hôpital; on ne savait pas si cette plainte était liée à l’incident à ce moment-là.
FÀ la suite de la séance d’information initiale, une nouvelle mise à jour a été reçue du sergent d’état-major Simons indiquant que le nombre de morts était passé à huit, le nombre de blessés, à quinze, et le nombre de lieux touchés, à seize. Le déploiement sur les lieux de cet incident tragique était sans précédent et, par conséquent, la portée de l’intervention du GCM n’était plus celle d’un appel de service « ordinaire ». Par exemple, l’off. resp. du GCM, le surintendant Josh Graham (surintendant Graham), est allé en personne dans la région de Melfort/Prince Albert pour travailler directement avec son équipe. Dans des circonstances normales, l’off. resp. du GCM serait avisé que son équipe a été appelée à participer à une intervention, mais il n’irait pas lui-même sur lieux pour lui donner son appui. Le surintendant Graham, qui était en vacances le jour de l’incident, s’est rapidement présenté au travail et a fourni un soutien supplémentaire en matière d’enquête à l’équipe du GCM et s’est occupé de bon nombre des tâches bureaucratiques, ce qui a permis à l’équipe de fonctionner plus efficacement.
Comme on l’a mentionné à la section Structure de commandement, en raison de la gravité et de l’ampleur de l’incident, le Centre divisionnaire des opérations d’urgence (CDOU) est devenu le poste de commandement d’incident et le lieu à partir duquel de nombreuses décisions, dont certaines qui touchaient le GCM, allaient être prises. Pour cette raison, il aurait peut-être été préférable que le surintendant se rende à Regina et soit présent au CDOU au lieu de remplir son rôle près des lieux de l’incident. Cela dit, le surintendant Graham a assuré une liaison régulière avec le CDOU, a participé aux séances d’information du CDOU, et le GCM était représenté au sein du CDOU durant les trois jours de l’intervention. Malgré cela, il est arrivé que des renseignements clés ne soient pas communiqués par la voie appropriée aux ressources du GCM, mais cela a été surtout attribuable à l’absence d’un flux de travail établi; cette question est approfondie un peu plus loin dans la présente section.
Le GCM fonctionne selon le cadre de gestion des cas graves, une méthodologie de gestion des enquêtes majeures qui assure la reddition de comptes, l’établissement de buts et d’objectifs clairs, la planification, la répartition des ressources et la détermination du rythme, du déroulement et de l’orientation de l’enquête grâce aux neuf éléments essentiels suivants :
- Le triangle de commandement;
- La communication;
- Le leadership et le travail d’équipe;
- Les considérations de gestion;
- Les stratégies d’enquête;
- Les considérations d’ordre éthique;
- Les mécanismes de reddition de comptes/de responsabilisation;
- Les considérations d’ordre juridique;
- Les partenariats.
L’un des premiers éléments du cadre de gestion des cas graves est l’obligation de créer un triangle de commandement composé d’un chef d’équipe, d’un enquêteur principal et d’un coordonnateur des dossiers. Lors d’une enquête « normale », toutes les ressources du GCM sont au courant des lignes hiérarchiques, et l’information provenant des divers enquêteurs passe par le triangle de commandement, ce qui donne lieu à un processus de prise de décision méthodique.
Pour l’intervention dans la NCJS/à Weldon, on a accordé beaucoup d’importance aux compétences et à l’expérience au moment d’attribuer les rôles du triangle de commandement. L’un des enquêteurs sur les homicides les plus expérimentés de la province a été nommé chef d’équipe. Le rôle d’enquêteur principal n’a pas été confié au prochain membre qui devait tenir ce rôle, mais à un membre ayant de l’ancienneté et beaucoup d’expérience en matière d’enquêtes sur les homicides. En outre, un membre reconnu pour ses compétences organisationnelles a été chargé de remplir le rôle de coordonnateur des dossiers.
Des membres sont ainsi passés du rôle « d’enquêteur sur le terrain » à divers autres rôles : certains sont devenus « coordonnateurs d’entrevues », car on prévoyait à ce moment-là qu’on allait devoir former des équipes pour mener des entrevues clés auprès des témoins et des suspects; on a désigné un chef de l’équipe de gestion des lieux de crime, étant donné qu’il y avait beaucoup de lieux à sécuriser et à traiter; on a désigné un chef de l’équipe des autorisations judiciaires, puisque la situation était fluide et qu’on ne savait pas si on allait devoir obtenir des mandats quelconques dans de brefs délais; on a aussi créé un rôle de responsable de l’arrestation des cibles pour coordonner les efforts visant à trouver et à arrêter les suspects, étant donné que ceux-ci étaient encore en liberté. Même si certaines des « sous-équipes » avaient leur propre structure hiérarchique interne, toutes ont fini par relever du chef d’équipe, ce qui a créé une sorte de commandement hybride. Cela n’a pas diminué l’efficacité de la structure hiérarchique, mais a plutôt rationalisé les processus de communication avec le GCM.
Compte tenu du grand nombre de victimes (blessées et décédées), on s’est vite rendu compte qu’un travail important allait être nécessaire concernant le rôle d’agent de liaison avec les familles. On a rapidement communiqué avec la sergente Ashley St. Germaine (sergente St. Germaine) de la Section des enquêtes générales (SEG) de Prince Albert pour lui confier le rôle d’agente de liaison avec les victimes et les familles. Ce rôle a été attribué alors que les membres du GCM en étaient aux premières étapes du traitement des divers lieux de crime et tentaient encore d’appréhender les suspects. Les mesures prises par les équipes de soutien aux victimes sont expliquées plus en détail dans la partie Intervention visant un grand nombre de victimes du présent rapport.
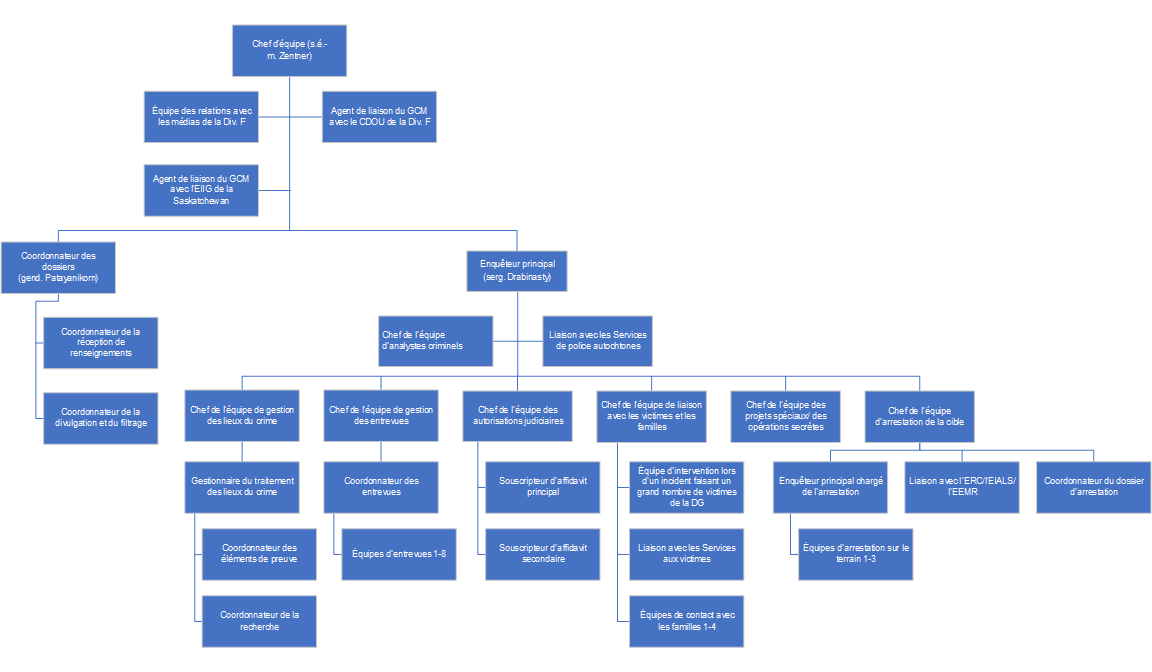
Description de l'image
Une boîte blanche contenant 30 boîtes bleues avec du texte à l’intérieur qui sont disposées hiérarchiquement pour illustrer l’organigramme du GCM a pour l’incident ayant fait un grand nombre de victimes dans la Nation crie James Smith/à Weldon. Le niveau de commandement le plus élevé figurant dans la case en haut de l’organigramme est celui du chef d’équipe (sergent d’état-major Zentner). En dessous, on trouve l’équipe des relations avec les médias de la Division F et l’agent de liaison du GCM avec le CDOU de la Division F. En dessous se trouve l’agent de liaison du GCM avec l’EIIG de la Saskatchewan.
La quatrième rangée est ensuite divisée en deux parties : le coordonnateur des dossiers (gendarme Patayanikorn) et l’enquêteur principal (sergent Drabinasty).
Sous le coordonnateur des dossiers se trouve le coordonnateur de la réception des renseignements, puis le coordonnateur de la divulgation et du filtrage.
Au-dessous de l’enquêteur principal se trouvent le chef de l’équipe d’analystes criminels et le responsable de la liaison avec les Services de police autochtones. La troisième ligne sous l’enquêteur principal est divisée en chef de l’équipe de gestion des lieux du crime, chef de l’équipe de gestion des entrevues, chef de l’équipe des autorisations judiciaires, chef de l’équipe de liaison avec les victimes et les familles, chef de l’équipe des projets spéciaux/des opérations secrètes, et chef de l’équipe d’arrestation de la cible. Chacune de ces catégories est ensuite subdivisée.
Sous le chef de l’équipe de gestion des lieux du crime, la hiérarchie comprend d’abord le gestionnaire du traitement des lieux du crime, puis le coordonnateur des éléments de preuve et enfin le coordonnateur de la recherche.
La hiérarchie sous le chef de l’équipe de gestion des entrevues comprend d’abord le coordonnateur des entrevues, puis les équipes d’entrevue 1 à 8.
La hiérarchie sous le chef de l’équipe des autorisations judiciaires comprend d’abord le souscripteur d’affidavit principal et ensuite le souscripteur d’affidavit secondaire.
Sous la responsabilité du chef de l’équipe de liaison avec les victimes et les familles, la hiérarchie est la suivante : d’abord l’équipe d’intervention lors d’un incident faisant un grand nombre de victimes de la DG, puis la liaison avec les Services aux victimes et enfin les équipes de contact avec les familles (1 à 4).
Sous le chef de l’équipe d’arrestation de la cible se trouvent l’enquêteur principal chargé de l’arrestation, l’agent de liaison avec l’ERC/l’EIALS/l’EEMR et le coordonnateur du dossier d’arrestation. Sous l’enquêteur principal chargé de l’arrestation se trouvent les équipes d’arrestation sur le terrain 1 à 3.
Le chef d’équipe a indiqué qu’avec le recul, il aurait aimé que ces rôles principaux soient attribués plus tôt; mais malgré cela, lorsqu’ils l’ont été, cela a eu l’effet désiré et, au bout du compte, la charge de travail du triangle de commandement s’en est trouvée allégée, ce qui a rendu la circulation de l’information plus efficace.
Il va sans dire que le téléphone du chef d’équipe et de l’enquêteur principal a sonné sans arrêt dès qu’ils ont commencé à remplir leur rôle respectif et pendant les jours qui ont suivi. La capacité de bien documenter les décisions et les directives est cruciale dans de telles circonstances. On a mentionné qu’il aurait été utile qu’un préposé au registre accompagne le chef d’équipe et l’enquêteur principal afin de leur enlever, en leur qualité de responsables des décisions cruciales, le fardeau de se rappeler et de consigner dans le détail les conversations et les réunions qui allaient vraisemblablement faire l’objet d’une divulgation plus tard.
Affectation des ressources
Tandis que la situation dans la NCJS/à Weldon évoluait, on a utilisé à peu près toutes les ressources d’enquête du GCM. L’inspecteur Chamberlin, du CDOU, a communiqué très tôt avec l’équipe du GCM pour lui dire qu’elle obtiendrait toutes les ressources dont elle aurait besoin.
Les enquêteurs fédéraux ont apporté leur aide pour assurer [CAVIARDÉ]; les équipes des opérations tactiques spéciales de l’Alberta et toutes les ressources disponibles de la Division F, de la Division D (Manitoba) et de l’Équipe de protection et d’intervention de la Saskatchewan ont aidé à sécuriser les lieux touchés; [CAVIARDÉ], [CAVIARDÉ]; le Groupe de la polygraphie a été retenu pour mener les entrevues éventuelles avec les suspects; toutes les ressources du Service de l’identité judiciaire, avec l’appui des membres du Groupe de la reconstitution des collisions et des analystes de la morphologie des taches de sang (explications à venir), ont été mobilisées, et l’aide de la Section divisionnaire des analyses criminelles (SDAC) a été demandée presque immédiatement.
Comme les équipes du GCM ne disposent pas d’un soutien analytique intégré, le gestionnaire de la SDAC a communiqué avec le GCM pendant que ses membres se rendaient à Melfort pour déterminer de quel soutien il avait besoin. Le GCM a demandé un soutien analytique, et la SDAC a dépêché deux analystes sur les lieux tandis que d’autres analystes ont travaillé à distance. L’un des analystes a travaillé avec l’équipe d’enquête principale tandis que l’autre a travaillé avec l’équipe d’arrestation de la cible. Ils ont reçu des tâches précises du GCM, et cette façon de faire s’est avérée claire et efficace pour les ressources de la SDAC déployées. Celles-ci ont par ailleurs participé aux séances d’information et transmettaient l’information en temps opportun à leurs gestionnaires à Regina.
Même s’il y a eu un manque inévitable de ressources lors de l’appel initial, les membres du GCM étaient d’avis qu’aucune ressource additionnelle n’aurait pu les aider dans l’exercice de leurs fonctions, même si un système de suivi des ressources déjà déployées avait pu être utile. On a mentionné l’outil ATAK comme solution possible (explications à venir dans les prochaines sections du rapport).
Logistique
Le GCM est arrivé au Détachement de Melfort vers 10 h 45 le 4 septembre et s’est d’abord installé dans la salle à café. On a rapidement établi que ce n’était pas un endroit idéal, car la pièce était trop petite et la bande passante était insuffisante pour permettre l’accès au système ROSS, à Internet et au lecteur partagé. En même temps, il fallait permettre au Détachement de poursuivre ses activités normales sans interférence. Par conséquent, le 5 septembre, l’équipe du GCM a déménagé dans l’immeuble des services d’appui au district, à Prince Albert, où elle est restée jusqu’à la fin de l’intervention. À la suite d’une demande de renforcement de la capacité technologique, l’Informatique (explications à suivre) a fourni des ordinateurs portables, un tableau intelligent à des fins de planification et de cartographie, des radios portatives et une largeur de bande appropriée pour la circulation des données.
En outre, l’un des postes de commandement mobiles (dont on a déjà parlé) a été installé dans la NCJS et utilisé comme lieu de rassemblement pour le GCM, les équipes chargées des lieux touchés et les équipes d’entrevues. La remorque a été installée au bureau du conseil de bande, à côté du poste de commandement du GTI (décrit précédemment), où se trouvait le commandant des interventions critiques. Le troisième poste mobile a servi de base aux groupes chargés de sécuriser les lieux touchés, aux groupes chargés d’assurer la sécurité des membres de la communauté et à d’autres groupes de soutien de la GRC.
À partir de ce moment, le GCM a travaillé depuis Prince Albert. La décision du GCM de déménager sa base d’attache n’a pas nui à sa capacité d’intervention et d’enquête. En fait, le déménagement lui a donné un espace plus grand avec un meilleur accès à la technologie. Cette décision n’a eu aucune incidence sur les enquêteurs sur le terrain, à part rallonger un peu le trajet en voiture pour se rendre à Prince Albert, au besoin.
Le nombre de lieux touchés et d’éléments de preuve que le GCM et le Service de l’identité judiciaire ont dû traiter était inhabituel. Comme on l’explique plus loin, en raison du grand nombre de victimes confirmées, on a décidé d’accorder la priorité aux homicides survenus en plein air. Le Détachement de Melfort avait déjà commencé le porte-à-porte dans le but de chercher d’autres lieux ou victimes et faire rapport au GCM à cet égard. Cette intervention a été menée en collaboration avec l’équipe du GTI. D’autres recherches ont été faites avec des drones en zone ouverte pour tenter de trouver d’autres victimes possibles.
Le GCM a d’abord utilisé les locaux du Détachement de Melfort pour entreposer les pièces à conviction; cependant, la capacité du Détachement a été rapidement dépassée en raison de la grande quantité d’articles saisis. L’entreposage a finalement été transféré à l’immeuble des services d’appui au district à Prince Albert puis, éventuellement, à la Salle d’entreposage des pièces à conviction du GCM, à Saskatoon. Près de 700 pièces à conviction ont été saisies dans le cadre de cette enquête.
Habituellement, les services de police confient la saisie des pièces à conviction au plus petit nombre de personnes possible, dans le but d’alléger le fardeau de la preuve quant à la continuité des pièces clés. En effet, moins il y a de personnes qui touchent à une pièce, moins il est difficile de prouver que la pièce n’a pas été altérée. C’est la raison pour laquelle, durant une enquête typique sur un homicide, un seul membre est désigné comme responsable de la saisie des pièces à conviction.
Cependant, il y avait au-delà de 40 lieux de crime distincts dans la NCJS et à Weldon, notamment des bâtiments et des véhicules. Le nombre de lieux touchés n’est pas directement lié au nombre de victimes; en effet, si des victimes s’étaient déplacées d’un point à un autre après avoir été blessées, le nombre de lieux augmentait alors et le travail devenait plus complexe. Le suspect a également utilisé plusieurs véhicules, ce qui a considérablement augmenté le nombre de lieux. Pour compliquer les choses encore plus, certains lieux étaient très éloignés des autres. Par conséquent, il n’a pas été possible de confier à une seule personne la tâche de saisir toutes les pièces.
Le coordonnateur des pièces à conviction du GCM a fini par décider que, s’il n’y avait pas de gestionnaire des lieux de crime du GCM sur les lieux, le Service de l’identité judiciaire allait devoir saisir toutes les pièces à conviction et les remettre à un gestionnaire des lieux de crime du GCM. Les analystes du Programme d’analyse morphologique des taches de sang, lorsqu’ils se sont joints à l’enquête, ont également dû saisir leurs propres pièces à conviction. Étant donné le grand nombre d’articles saisis, la gestion des pièces à conviction est devenue très fastidieuse.
Services nationaux de laboratoire judiciaire de la GRC
Les Services nationaux de laboratoire judiciaire (SNLJ), qui font partie d’un système unique de laboratoires publics, comptent trois établissements, soit un à Ottawa, un à Edmonton et un à Surrey.
En ce qui concerne l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon, l’équipe du GCM a discuté des pièces à envoyer au laboratoire judiciaire aux fins d’analyse et a pris des décisions en fonction des circonstances. On a décidé de faire appel au laboratoire d’Edmonton dans ce cas-ci. Les enquêteurs ont produit un document énumérant les pièces proposées selon un ordre séquentiel ainsi que l’analyse demandée par l’équipe du GCM. Ce document a été envoyé au laboratoire, mais il a été refusé parce qu’il n’avait pas été présenté dans le format standard (formulaire C 414). L’équipe de gestion des lieux de l’incident a senti que les processus des SNLJ retardaient la soumission de la demande.
Pour comprendre la façon de présenter les pièces au laboratoire, il faut tenir compte du protocole que doivent suivre les SNLJ sur réception d’une demande. Pour les SNLJ, le document C 414 est un formulaire normalisé qui contient tous les champs nécessaires pour le traitement des pièces. Ce formulaire permet de simplifier le processus et d’assurer l’uniformité et le traitement efficace des pièces pour la présentation de dossiers. De plus, plusieurs groupes du laboratoire utilisent ce formulaire à mesure que le dossier progresse, de même que les employés à toutes les étapes du processus. Dans une situation comme celle qui s’est produite dans la NCJS/à Weldon, si les SNLJ avaient accepté un formulaire non standard, il est très possible que le stratège du Centre d’évaluation judiciaire (CEJ) ait été forcé de communiquer après coup avec l’enquêteur pour obtenir des précisions. De plus, lorsque les SNLJ reçoivent un formulaire C 414, le stratège doit saisir l’information qu’il contient dans un autre système, ce qui prend également beaucoup de temps.
Les Services de laboratoire judiciaire ont cru comprendre que, dans ce cas-ci, la tâche consistant à remplir le formulaire C-414 était lourde et fastidieuse, compte tenu du fait que les incidents s’étaient produits dans une collectivité rurale où l’accès à Internet et aux outils numériques qui facilitent normalement cette tâche, était limité. De plus, compte tenu du temps requis pour traiter le grand nombre de lieux touchés et de pièces à conviction, et compte tenu aussi du fait qu’un dossier volumineux contenant les détails de l’incident a été partagé, cette exigence administrative représentait un fardeau supplémentaire de temps et d’énergie. Pour de futurs incidents de cette envergure, le CEJ pourrait convenir de transférer les renseignements dans le formulaire C-414 à partir d’un autre document, pourvu que l’ébauche du formulaire soit examinée et approuvée par l’enquêteur avant que le CEJ puisse l’accepter. Cette communication serait cruciale pour éviter que des renseignements ne soient faussés ou omis.
La pratique actuelle des Services de laboratoire judiciaire est telle qu’à la réception d’une demande d’un enquêteur, le gestionnaire du CEJ réunit les spécialistes compétents pour établir une approche d’équipe. Pour de futurs incidents faisant un grand nombre de victimes, il faut être conscient, aux Services de laboratoire judiciaire, de la nécessité de réunir ce groupe interne de manière plus opportune afin d’assurer une approche efficiente et efficace de la présentation des pièces à conviction. Cela pourrait nécessiter des échanges supplémentaires avec les enquêteurs afin de comprendre le contexte de l’affaire et de s’assurer que les pièces les plus probantes et les échantillons connus sont soumis en premier et le plus rapidement possible.
Bon nombre des malentendus au sujet du processus consistant à envoyer des pièces à conviction dans le cadre d’incidents de grande envergure auraient pu être dissipés si l’équipe d’enquête et le stratège du CEJ avaient discuté plus tôt des capacités des Services de laboratoire judiciaire d’aider les enquêteurs à transférer l’information de leurs dossiers au formulaire C-414. Si cette communication avait eu lieu, l’équipe d’enquête aurait pu poursuivre son travail et les Services de laboratoire judiciaire auraient reçu l’information dans le format requis.
Il convient de mentionner que dans le cadre de leurs initiatives de modernisation, les SNLJ ont l’intention d’élaborer un outil électronique qui sera moins lourd et plus dynamique que le modèle actuel du formulaire C-414. Cet outil n’est cependant pas encore disponible.
Clarté du commandement
On a déjà examiné la structure de commandement dans une section précédente du présent rapport; cependant, il convient de parler de la façon dont les rôles du commandant des interventions critiques (CIC), du Centre divisionnaire des opérations d’urgence (CDOU) et de la Station de transmissions opérationnelles/des Services de soutien opérationnel aux membres (STO/SSOM) étaient perçus du point de vue du Groupe des crimes majeurs (GCM). Toute l’information était transmise par le triangle de commandement du GCM à l’officier responsable du GCM (surintendant Josh Graham), qui la transmettait ensuite aux gestionnaires divisionnaires postés au CDOU puis, enfin, au commandant de la Division F.
Les problèmes constatés entre les différents commandants résultaient davantage d’une communication limitée que d’incertitudes dans le commandement.
Communication
En raison du grand nombre d’équipes qui ont été déployées (voir l’organigramme du GCM) et du fait que plusieurs d’entre elles ne se sont jamais retrouvées dans le même lieu géographique que les autres, l’équipe du GCM n’a pas été en mesure de tenir régulièrement des séances d’information « exhaustives ». Le triangle de commandement a fait ce qu’il a pu pour faire un compte rendu aux sous-équipes, et tous les membres du GCM ont été tenus au courant de l’information pertinente dont ils avaient besoin.
Tous les problèmes de communication qui se sont présentés étaient attribuables à l’absence d’une ressource du GCM intégrée à la STO ou en communication directe avec elle. À titre d’exemple, à la suite de la diffusion des alertes publiques qui contenaient des renseignements au sujet du suspect, la STO a reçu un grand nombre d’appels de personnes qui disaient avoir possiblement aperçu le suspect. À ce moment-là, le coordonnateur de la réception des renseignements du public du GCM se trouvait au CDOU et non pas à la STO. On a découvert plus tard qu’un certain nombre de signalements reçus du public concernant la présence possible du suspect dans la région de Wakaw les 4 et 5 septembre n’avaient jamais été transmis au coordonnateur de la réception des renseignements et, par la suite, aux enquêteurs du GCM de l’équipe d’arrestation. Les enquêteurs du GCM croyaient que le CDOU surveillait et coordonnait toutes les ressources en dehors de l’équipe d’enquête du GCM, de même que toutes les plaintes reçues par la STO. Étant donné que le coordonnateur de la réception des renseignements n’effectuait pas un contrôle des appels reçus par la STO, les enquêteurs ont reçu certains signalements lorsqu’ils n’étaient plus pertinents.
À ce moment-là, le commandant des interventions critiques (CIC) participait pleinement aux efforts d’arrestation aux côtés du membre du GCM qui avait été désigné chef de l’équipe d’arrestation. Le CIC et les membres de l’équipe d’arrestation avaient convenu d’une stratégie de communication et aussi de la nécessité de travailler en étroite collaboration étant donné que leur objectif respectif était manifestement le même (l’arrestation du suspect). L’équipe d’arrestation a fini par changer d’immeuble, ce qui a nui à la rapidité des communications et l’a forcée à utiliser fréquemment le téléphone. Il convient de mentionner qu’une équipe du GTI a été déployée pour un incident sans rapport avec la présente affaire durant cette période, ce qui a peut-être précipité la décision de déménager l’équipe d’arrestation et fait passer au second plan la nécessité de maintenir les deux groupes au même endroit.
Si on avait transmis à l’équipe d’arrestation du GCM les renseignements du public à mesure qu’on les recevait, elle aurait pu réaffecter stratégiquement ses ressources. Si le coordonnateur de la réception des renseignements du public au CDOU avait eu une idée de la façon dont la STO traitait les renseignements reçus, et vice versa, l’échange d’information se serait probablement fait de façon plus harmonieuse. Pour mettre les faits en contexte, la STO et le CDOU ne se trouvent pas dans le même espace de travail, mais ils sont à proximité l’un de l’autre au quartier général de la Division F à Regina. Malgré cela, ils ont très peu interagi l’un avec l’autre.
Le triage des renseignements reçus du public est abordé plus en profondeur dans la section Communications opérationnelles du présent rapport.
En raison de tout ce qui précède, il a été décidé, le 15 septembre, qu’un audit exhaustif de toutes les plaintes reçues en Saskatchewan par la Section divisionnaire des analyses criminelles (DCAS) entre le 4 et le 7 septembre devait avoir lieu. Cet audit est en cours.
Intervention du Service de l’identité judiciaire
Quand un crime est commis ou qu’une catastrophe survient, on fait appel aux membres du Service de l’identité judiciaire (SIJ) pour protéger les lieux, consigner et documenter ce qu’ils y trouvent, et recueillir et emballer les articles/pièces à conviction aux fins d’analyse. Selon le type d’enquête à mener, cela peut comprendre les tâches suivantes : la photographie et les esquisses des lieux; l’examen d’empreintes digitales, de chaussures et de traces de pneus; la recherche d’éléments de preuve sous forme de traces; l’analyse de la morphologie des taches de sang; et la collecte d’échantillons aux fins d’analyse génétique. Les preuves recueillies permettent d’identifier les suspects ou les victimes de crimes, et les membres du SIJ les interprètent et les présentent en cour.
Il y a plus de 70 groupes du SIJ au pays, dont cinq en Saskatchewan (Regina, Saskatoon, North Battleford, Prince Albert et Yorkton), qui offrent des services d’identification judiciaire aux détachements de la GRC et aux services de police du Canada et aident les organisations nationales et internationales à identifier les victimes de catastrophes.
Tous les groupes du SIJ de la Division F ont un membre en disponibilité chaque jour qui est en mesure de répondre aux questions des enquêteurs sur les lieux et d’intervenir, au besoin. De plus, il y a au moins un membre du SIJ au bureau tous les jours de l’année.
En ce qui concerne les incidents survenus dans la NCJS, le membre en disponibilité du SIJ à Prince Albert a compris, dès la réception de l’appel, que la situation dépassait la capacité d’une seule équipe du SIJ à intervenir, et c’est pourquoi il a communiqué avec le gestionnaire divisionnaire du SIJ, qui était chez lui. Le gestionnaire avait toutes les coordonnées sur son téléphone pour faire les appels nécessaires sur-le-champ pour déployer les cinq autres groupes du SIJ en Saskatchewan.
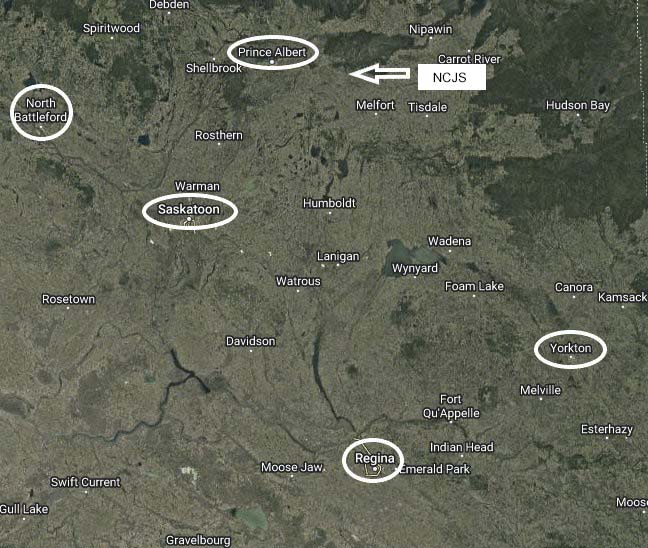
Description de l'image
Carte illustrant les emplacements des cinq groupes du SIJ en Saskatchewan et l’emplacement de la Nation crie de James Smith. Les emplacements et les noms des villes de North Battleford, Saskatoon, Prince Albert, Yorkton et Regina sont encerclés. Une flèche indique l’emplacement de la Nation crie de James Smith.
Les membres du SIJ ne se rendent pas toujours immédiatement sur les lieux d’un incident et n’interviennent pas en personne pour chaque appel reçu. Ils déterminent d’abord la possibilité qu’il y ait des éléments à trouver sur les lieux ainsi que l’urgence de l’intervention d’après l’information reçue des premiers intervenants. Le SIJ a des instructions claires (diagramme) à suivre pour décider s’il doit ou non envoyer une ressource sur les lieux. Il va sans dire qu’il a répondu immédiatement le 4 septembre lorsqu’on a fait appel à lui.
Ressources
Naturellement, au début de l’intervention, les ressources du SIJ sur les lieux étaient limitées tandis que divers groupes étaient encore en route. Lorsque des membres du SIJ de Prince Albert et de Saskatoon sont arrivés dans la NCJS, on leur a immédiatement demandé de commencer à traiter les lieux en plein air où il y avait des défunts. Il s’agissait d’une décision consciente non seulement pour préserver les éléments de preuve, mais aussi pour éviter aux défunts d’être sous les yeux de leurs proches et du public pendant une période prolongée. Tandis que d’autres membres du SIJ arrivaient, on a désigné des chefs d’équipe pour chaque lieu et pour servir de point de contact avec le gestionnaire du SIJ. L’ordre de priorité pour le traitement des lieux a été établi comme suit : personnes décédées dehors, personnes décédées à l’intérieur, grosses effusions de sang et introductions par effraction. Lorsqu’une équipe avait terminé le traitement d’un lieu, le gestionnaire du SIJ lui confiait alors la prochaine tâche par l’intermédiaire du chef d’équipe. En tout, le SIJ a ainsi eu à traiter plus de vingt lieux (huit où il y avait des défunts, dix où les victimes avaient survécu et quatre véhicules). Le SIJ a aussi dû assister à dix autopsies à divers moments.
Du point de vue des ressources disponibles dans la Division, on a jugé que la répartition était adéquate . Compte tenu des circonstances, il est normal qu’on ait souhaité avoir plus de ressources; toutefois, toutes les ressources disponibles du SIJ de la Division ont été mobilisées, et d’autres ont été appelées, selon les besoins, après coup. Le Service de police de Prince Albert a fourni un membre de sa section de l’identité judiciaire, et des spécialistes de l’analyse morphologique des taches de sang ont été dépêchés de l’extérieur de la Division (explications à venir). On n’a pas communiqué avec les ressources du SIJ de Regina pour obtenir de l’aide, car même si ce qui se passait dans la NCJS/à Weldon exigeait une intervention massive, le gestionnaire divisionnaire a voulu garder une équipe disponible au cas où l’on recevait d’autres appels nécessitant une intervention du SIJ. De plus, on s’attendait à ce que les dépouilles mortelles soient amenées à Saskatoon ou à Regina pour l’autopsie, ce qui fut le cas. Le fait d’avoir une équipe disponible a permis aux ressources du SIJ qui traitaient les lieux de faire leur travail sans interruption.
Le CDOU a confié la tâche de sécuriser les divers lieux à des membres de la Patrouille routière de la Saskatchewan, du ministère de l’Environnement et de la Gestion des ressources de la Saskatchewan, de la Division K et de la Division D et à toute ressource de la Division F encore disponible. Ces ressources ont été jugées essentielles pour gérer les lieux, car cela a aidé les membres du SIJ à ne se jamais se sentir pressés de terminer leur travail et à accomplir leurs tâches le mieux possible.
Lorsqu’un incident majeur comme celui-ci se produit, il est tout naturel que les policiers veulent aider. Toutefois, il est impossible d’appeler tous les membres à prêter main-forte. Comme il a été mentionné, on n’a pas pu déployer toutes les ressources du SIJ dans la NCJS/à Weldon. Certaines personnes ont eu l’impression d’avoir été laissées de côté ou se sont demandé pourquoi on n’avait pas fait appel à elles. Le gestionnaire divisionnaire s’est assuré de rester en communication avec les groupes ou les membres qui n’ont pas été amenés à participer à l’intervention et de les inclure dans la planification d’urgence et les séances d’information finales.
Équipement du Service de l’identité judiciaire
Sur bon nombre de lieux touchés dans la NCJS, beaucoup de membres des familles ou de la communauté étaient présents et sont restés pendant que le SIJ faisait son travail. Il y avait de nombreux facteurs culturels en jeu, dont les membres sur place étaient conscients, et ils ont fait de leur mieux pour les respecter. Ces facteurs culturels sont expliqués plus en détail dans la section Intervention visant un grand nombre de victimes du présent rapport.
Étant donné la présence de proches des victimes et de membres de la communauté à chaque lieu touché, les membres du SIJ ont naturellement dû interagir avec eux. Parfois, ils ont dû leur demander de reculer. La plupart du temps, ces personnes ont obtempéré sans problème; cependant, certains membres du SIJ étaient complètement exposés au public, ce qui n’est pas idéal pour faire leur travail. Lorsqu’un problème survenait, un membre de l’équipe de liaison avec les familles était habituellement disponible pour s’entretenir avec les personnes en question de l’intégrité médico-légale et de la nécessité de laisser les membres du SIJ faire leur travail. Dans un cas, une dépouille mortelle se trouvait entre deux véhicules. On a demandé au responsable de la sécurité sur les lieux de déplacer son véhicule afin de bloquer la vue aux proches du défunt avant de retirer la bâche qui couvrait le corps. Durant l’examen à l’origine du présent rapport, des membres de la NCJS ont révélé des préoccupations quant au temps pendant lequel certains lieux sont restés à la vue des spectateurs, ce qui est normal. Au bout du compte, les membres du SIJ ont fait de leur mieux pour dissimuler les défunts et les éléments de preuve susceptibles de perturber les personnes civiles présentes; cependant, il peut y avoir eu des cas où la vue a involontairement causé de la détresse aux personnes présentes.
Bien que des bâches aient été disponibles sur tous les lieux touchés, une enceinte privée quelconque (mur en tissu, tente) aurait aidé à dissimuler les dépouilles mortelles et servi d’abri pour les membres du SIJ, au besoin, lorsqu’ils traitaient les lieux en plein air.
La remorque (poste de commandement mobile) utilisée comme « base d’attache » par d’autres groupes n’était pas une option envisageable pour le SIJ. Une base plus grande, sur place, aurait servi de point de rassemblement pour les membres du SIJ et offert un endroit où afficher un organigramme des membres, des diagrammes des lieux, des photos de toute preuve physique ou d’autres renseignements du SIJ à partager, que ce soit de manière informelle ou lors des séances d’information régulières.
Des incidents de cette ampleur attirent naturellement l’attention non seulement au niveau divisionnaire, mais aussi à l’échelle nationale. Le gestionnaire du SIJ de la Division s’est assuré d’informer quotidiennement son superviseur afin que des renseignements exacts puissent être transmis aux personnes concernées par la question à Ottawa.
Enlèvement des corps
Avant le retrait des dépouilles, les responsables des lieux savaient que certains proches allaient sans doute vouloir tenir des cérémonies culturelles et, lorsqu’ils en ont fait la demande, cela a été autorisé. Il y avait des membres des familles et de la communauté sur la majorité, voire l’ensemble, des lieux touchés; parfois, plus d’une soixantaine de personnes étaient rassemblées et attendaient les directives du SIJ. Les membres du SIJ étaient conscients de l’impact d’une tragédie de cette ampleur sur la communauté et se sont montrés sensibles aux besoins en permettant la tenue de cérémonies même quand cela retardait leur travail. Les membres du SIJ se sont parfois heurtés à des problèmes, car ils étaient parfois en présence de personnes qui auraient préféré qu’ils ne touchent pas aux défunts et qu’ils ne les déplacent pas pendant l’examen des lieux. Ce problème a été atténué lorsque l’équipe de liaison avec les familles a expliqué à ces personnes le besoin d’assurer l’intégrité médico-légale tout en permettant aux familles de tenir des cérémonies culturelles. Après le traitement des lieux, toute personne ayant demandé du temps avec un défunt s’est vue accorder le temps dont elle avait besoin.
L’enlèvement des corps a été effectué aussi rapidement que possible compte tenu des circonstances. Deux coroners se sont rendus sur chaque lieu, et le processus a été long étant donné nombre de lieux touchés. Naturellement, le fait d’avoir plus de coroners aurait permis d’accélérer les choses. Le Bureau du coroner s’est efforcé de simplifier le travail sur les lieux, et a fini par diviser ses ressources dans le but d’accélérer le tout.
Analyse morphologique des taches de sang
Pour demander l’intervention du Programme d’analyse morphologique des taches de sang (PAMTS), il faut d’abord qu’un membre du SIJ se rende sur les lieux de l’incident et décide, en collaboration avec l’enquêteur, si une telle analyse pourrait être utile à l’enquête. Un analyste du PAMTS peut fournir son avis et être consulté relativement à l’examen des lieux et des pièces à conviction, il peut offrir des séances de formation et analyser/examiner les photos d’une affaire.
Lors de l’examen des lieux d’un crime, les analystes se penchent sur l’emplacement, la forme, le motif individuel des taches de sang; les mécanismes à l’origine des taches; la direction de déplacement des gouttes; la zone d’origine (emplacement du coup dans la source de sang); le type d’objet utilisé lors de l’attaque (tranchant, contondant, arme à feu, etc.); le nombre de coups portés; la présence d’un sujet sur les lieux (pour établir un lien entre suspects, victimes et objets); l’emplacement et les déplacements de la victime, du suspect et des objets pendant l’incident; ainsi que la séquence des événements. Durant l’intervention dans la NCJS/à Weldon, on a fait appel au PAMTS en raison des énormes quantités de sang sur les divers lieux touchés.
Le PAMTS a des analystes en Colombie-Britannique (Division E), en Alberta (Division K) et en Nouvelle-Écosse (Division H). Ce sont les analystes d’Edmonton (Division K) qui ont été dépêchés dans la NCJS/à Weldon. La section d’Edmonton a ses locaux dans le laboratoire judiciaire de la GRC en Alberta et fournit des services 24 heures sur 24 aux Divisions K, F, D, G (T.N.-O.), à une partie de la Division V (Nunavut) ainsi qu’à d’autres services de police de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. Les sections du PAMTS relèvent maintenant des divisions, alors qu’elles relevaient auparavant d’Ottawa. C’est la Division K qui a dirigé l’intervention du PAMTS dans la NCJS. En tout, deux analystes de la Division K et un analyste de la Division E ont été dépêchés sur les lieux.
Un membre du SIJ qui intervenait sur les lieux touchés dans la NCJS a communiqué avec le PAMTS de la Division K en début d’après-midi le 4 septembre, comme le veut le processus expliqué précédemment. À ce moment-là, le membre du PAMTS a demandé des photos des lieux afin de déterminer s’il fallait dépêcher quelqu’un sur place. Après avoir établi que cette présence était nécessaire, à 22 h ce soir-là, on a dit à la ressources du PAMTS qu’elle allait devoir traiter cinq lieux, et son départ d’Edmonton a été prévu pour le lendemain matin. Cette ressource avait accès à un stagiaire et croyait qu’il n’était pas impossible de traiter cinq lieux; elle n’a donc pas communiqué avec des ressources additionnelles à ce moment-là. Le lendemain, par contre, à son arrivée dans la NCJS, on lui a dit qu’il fallait maintenant traiter tous les lieux. On a donc décidé qu’une autre ressource du PAMTS allait être nécessaire, et on en a obtenu une auprès de la Division E.
Selon les ressources du PAMTS, la communication et le travail d’équipe lors du traitement des lieux ont été excellents. Le traitement a été réalisé aussi rapidement que possible, en partie parce que les membres du SIJ avaient repéré les taches de sang qui allaient nécessiter une analyse plus approfondie avant même l’arrivée des ressources du PAMTS. Cette faculté est enseignée dans le cours Initiation à la morphologie des traces de sang, qui montre aux membres du SIJ comment déterminer si une analyse est justifiée et leur apprend comment consigner des traces de sang pour les faire analyser à distance, comment évaluer les lieux où il y a beaucoup de sang et comment consulter un analyste du PAMTS.
Cette formation, autrefois obligatoire, est un prérequis pour obtenir la certification d’analyste de la morphologie des traces de sang, un processus offert par le PAMTS qui peut prendre entre 12 et 18 mois
Le recrutement d’analystes de la morphologie des taches de sang pose problème dans l’ensemble du pays. Il n’y a tout simplement pas assez de ressources dans lesquelles puiser si jamais un autre incident d’envergure comme celui-ci devait se produire. Comme on l’a déjà mentionné, beaucoup de divisions n’ont pas de ressources du PAMTS, et même si tous les postes disponibles étaient pourvus, il y aurait quand même une pénurie d’analystes par rapport à la quantité de travail à faire.
Une solution pour atténuer cette pénurie serait d’envisager de permettre à des employés civils qualifiés d’occuper un poste d’analyste de la morphologie des taches de sang. Le Service intégré de l’identité judiciaire (SIIJ) appuie les employés du SIJ et compte des spécialistes de la SIJ ainsi que des membres civils qui sont assistants en identité judiciaire, des experts judiciaires, des décideurs et du personnel administratif. Seuls les membres du SIJ certifiés par le directeur du SIIJ à titre d’analystes de la morphologie des taches de sang peuvent interpréter la preuve relative aux taches de sang et présenter leur point de vue.
Communications stratégiques
Pendant un incident faisant un grand nombre de victimes, comme celui survenu dans la NCJS et à Weldon le 4 septembre, les communications essentielles transmises aux personnes touchées peuvent soit contribuer à une bonne gestion de la situation soit créer une plus grande confusion. Un plan de communication efficace est essentiel lors d’un incident du genre.
Comme le montre la présente section, la GRC a diffusé des renseignements de manière à établir des liens avec le public, sans toutefois compromettre l’enquête qui était en cours. Les communications stratégiques relativement à la NCJS et à Weldon ont été envoyées par l’entremise du Groupe des relations avec les médias de la Division F, à Regina. La possibilité de maintenir la stratégie de communication à l’échelle locale (au Détachement de Melfort) n’a jamais été envisagée, car la situation dans la NCJS et à Weldon a rapidement été désignée comme une préoccupation en matière de sécurité publique qui susciterait une attention à l’échelle provinciale et nationale.
Le Groupe des relations avec les médias a joué un rôle de premier plan dans la diffusion de diverses alertes publiques qui ont grandement contribué (en plus des médias sociaux) à tenir le grand public informé de la situation touchant l’ensemble de la province qui émanait de la NCJS et de Weldon, le 4 septembre et les jours qui ont suivi.
Au sujet du Groupe des relations avec les médias
Le Groupe des relations avec les médias de la Division F compte sept employés qui remplissent diverses fonctions, notamment la gestion des médias sociaux, la rédaction/l’aide à la rédaction de communiqués de presse et de messages internes au personnel et la rédaction/la diffusion de messages d’alertes publiques lors d’incidents importants. Le Groupe des relations avec les médias et son équipe de communications stratégiques relèvent du Service divisionnaire des stratégies opérationnelles (SDSO) de la Division F.
Au sujet du Service divisionnaire des stratégies opérationnelles (SDSO)
Le SDSO appuie les opérations de la GRC en veillant à ce que la Division soit une organisation stratégiquement ciblée, intégrée et axée sur le renseignement. Le rôle de la SDSO est de coordonner le service à la clientèle et les relations stratégiques, de superviser la planification opérationnelle, de coordonner les analyses de rentabilisation, de fournir des recherches et des renseignements opérationnels, de faciliter la gestion intégrée des risques et de gérer les améliorations continues à l’échelle de la Division.
Appel de service initial et diffusion des alertes publiques
Comme le mentionne la section Intervention initiale ci-dessus, l’appel initial au 911 en lien avec la NCJS a été transmis aux membres de la GRC de Melfort à 5 h 43. Des membres ont quitté Melfort à 5 h 52 pour se rendre dans la NCJS, où ils sont arrivés sur les lieux du premier signalement à 6 h 20.
Les agents des relations avec les médias (ARM) ont commencé à recevoir des avis au sujet de la NCJS vers 6 h 30 le 4 septembre et ont immédiatement déterminé qu’une alerte publique de SaskAlert était requise, compte tenu des circonstances à ce moment-là. Dans les 20 minutes qui ont suivi, des appels urgents ont été faits entre les ARM, et des dispositions ont été prises relativement à la technologie à utiliser pour diffuser l’alerte publique et à la formulation du message. Il convient de souligner que tous les ARM (même ceux qui n’étaient pas en disponibilité) avaient leur ordinateur portable à la maison et avaient la capacité d’accéder à distance au Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (décrit ci-dessous), lequel permet de diffuser une alerte publique. Pendant que les préparatifs pour l’alerte publique étaient en cours, les ARM recevaient des renseignements selon lesquels de nombreux appels d’urgence étaient reçus à la STO.
À 7 h, l’agent de service, l’inspecteur Chamberlin, a autorisé la diffusion de l’alerte publique initiale.
À 7 h 12, la première alerte publique a été diffusée dans les secteurs de la NCJS, de Melfort et de Humboldt :
Le Détachement de la GRC de Melfort diffuse une alerte concernant une personne dangereuse après avoir reçu plusieurs appels signalant des attaques au couteau dans la Nation crie de James Smith. La GRC de la Saskatchewan intervient et tente de retrouver deux hommes suspects. Si vous vous trouvez dans le secteur, mettez-vous immédiatement à l’abri. Faites preuve de prudence si vous autorisez d’autres personnes à entrer dans votre domicile. Ne quittez pas un lieu sûr. NE VOUS APPROCHEZ PAS de personnes suspectes. Ne prenez pas d’autostoppeurs. Signalez toute personne suspecte, situation urgente ou information pertinente au 911. Ne divulguez pas les endroits où se trouvent les policiers.
À des fins de clarté, SaskAlert est le programme d’alertes d’urgence au public du gouvernement de la Saskatchewan qui permet de fournir des renseignements essentiels sur les situations urgentes en temps réel, afin que les membres du public puissent prendre des mesures pour se protéger.
Presque immédiatement, le Groupe des relations avec les médias a obtenu l’information requise pour déterminer si le seuil pour la diffusion d’une alerte publique allait être atteint, ce qui a permis une approbation rapide du message destiné au public. Les communications entre l’ARM désigné et le stratège qui avait la capacité de saisir les données dans le Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (système ADNA) ont été rapides et efficaces. L’alerte initiale au public a été diffusée aussi rapidement qu’elle aurait pu l’être.
Le système ADNA procure l’infrastructure technique du Système national d’alertes au public du Canada. Le système ADNA prend en charge les messages d’alertes d’urgence transmis par des organismes gouvernementaux autorisés (SaskAlert). Ces messages sont ensuite mis à la disposition de diffuseurs et d’autres distributeurs de médias, qui transmettent volontairement les alertes au public canadien. Le système ADNA n’est pas convivial, comme l’ont soulevé les personnes qui connaissent le système dans le cadre de l’examen. Le système a été créé pour diffuser des alertes météorologiques, mais a été adapté à d’autres types d’alertes.
La rapidité de diffusion de l’alerte est attribuable au fait que des essais avaient déjà été réalisés pour la diffusion d’alertes publiques. Les Communications stratégiques ont effectué des essais trimestriels avec des commandants des interventions, des chefs de détachement, des commandants des interventions critiques et des officiers responsables des enquêtes criminelles, dans le but de mettre en place une responsabilité partagée et de favoriser la compréhension du système de diffusion d’alertes d’urgence dans la province. Il convient de noter que l’ARM désigné et le stratège en médias qui a saisi les données dans le système ADNA avaient chacun leur ordinateur à leur domicile, ce qui a permis d’accroître encore plus la rapidité de diffusion de l’alerte publique initiale.
Une fois les ressources arrivées sur les lieux de travail, au quartier général de la GRC à Régina, le Groupe des relations avec les médias était mieux en mesure de leur affecter des tâches de façon efficace. Les tâches comprenaient notamment ce qui suit : rédaction de messages destinés aux médias sociaux, rédaction des alertes publiques, rédaction des communiqués de presse et préparation de notes d’allocution pour la commandante divisionnaire. Pour mettre les choses en perspective, au cours des quatre jours de l’intervention (du 4 au 7 septembre), le Groupe des relations avec les médias a reçu plus de 550 demandes de divers médias. On dit que la situation était chaotique, mais gérable.
Il semble y avoir eu des échanges fréquents entre l’équipe d’enquête (Groupe des crimes majeurs – GCM), et l’équipe des Communications stratégiques qui étaient intégrées directement au CDOU, à Regina. Cela a permis d’établir un lien avec l’enquête en ce qui concerne la collecte de renseignements pertinents et opportuns et, selon l’équipe des Communications stratégiques, a réduit le besoin d’intégrer un conseiller en matière de relations avec les médias au sein du poste de commandement, avec le GCM. Du point de vue du GCM, il aurait été utile de mettre en place ce type de communication immédiate avec l’équipe des Communications stratégiques, en travaillant en collaboration, depuis un même emplacement. Étant donné qu’il y avait un flux de communication efficace entre le GCM et les Communications stratégiques, l’emplacement physique des ressources n’a pas eu d’incidence sur les résultats connexes.
Outre l’alerte publique initiale, le GCM a été consulté à fond pour toutes les autres alertes, avant qu’elles ne soient diffusées. Il y a eu énormément d’échanges entre le GCM et les Communications stratégiques tout au long de l’enquête en ce qui concerne les renseignements pouvant être diffusés au public et les répercussions possibles sur l’enquête. Le seul cas où des renseignements diffusés ont eu des répercussions directes sur les ressources du GCM sera examiné dans la section Intervention visant un grand nombre de victimes (l’équipe de liaison avec les familles n’a pas été en mesure d’informer les proches du frère du suspect, retrouvé mort le 5 septembre, du décès de celui-ci avant que cette information soit diffusée dans les médias).
Alertes publiques subséquentes
- 4 septembre, à 7 h 57
-
Mise à jour sur l’alerte concernant une personne dangereuse diffusée par le Détachement de la GRC de Melfort au sujet de nombreuses agressions au couteau survenues dans la Nation crie de James Smith. Les suspects sont Damien Sanderson et Myles Sanderson. Damien Sanderson mesure 5 pi et 7 po et pèse 155 lb. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Myles Sanderson mesure 6 pi et 1 po et pèse 200 lb. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Les suspects pourraient se déplacer à bord d’une Nissan Rogue noire immatriculée en Saskatchewan (119 MPI). Si vous vous trouvez dans le secteur, mettez-vous immédiatement à l’abri. Faites preuve de prudence si vous autorisez d’autres personnes à entrer dans votre domicile. Ne quittez pas un lieu sûr. NE VOUS APPROCHEZ PAS de personnes suspectes. Ne prenez pas d’autostoppeurs. Signalez toute personne suspecte, situation urgente ou information pertinente au 911. Ne divulguez pas les endroits où se trouvent les policiers.
Remarque
L’alerte publique (ci-dessus) diffusée à 7 h 57 comprenait une photo erronée de Myles Sanderson. Lorsque les suspects ont été identifiés, un spécialiste des médias a effectué des vérifications dans les bases de données dans le but d’obtenir une photographie. Il souhaitait joindre une photo au communiqué afin d’aider la population à identifier/retrouver les suspects et à prendre les mesures nécessaires pour se protéger. Dans la base de données, deux sujets de la NCJS portaient le même nom (Myles Sanderson), mais il y avait une différence d’âge de cinq ans entre les deux. Pendant une situation extrêmement dynamique nécessitant des mises à jour fréquentes, le spécialiste des médias n’a initialement pas choisi la bonne photo. Il convient de noter que le sujet dans la photo diffusée initialement était celui qui était visé par les activités les plus récentes signalées dans la NCJS. Après avoir pris connaissance de l’erreur, les Communications stratégiques ont immédiatement remplacé la mauvaise photo par la bonne, et des mesures ont été prises pour retirer la photo initiale du système d’alertes publiques et de toute publication en ligne.
- Le 4 septembre, à 8 h 20
-
Mise à jour sur l’alerte concernant une personne dangereuse diffusée par le Détachement de la GRC de Melfort au sujet de nombreuses agressions au couteau survenues dans la Nation crie de James Smith. Les suspects sont Damien Sanderson et Myles Sanderson. Damien Sanderson mesure 5 pi et 7 po et pèse 155 lb. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Myles Sanderson mesure 6 pi et 1 po et pèse 200 lb. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Les suspects pourraient se déplacer à bord d’une Nissan Rogue noire immatriculée en Saskatchewan (119 MPI).
- Le 4 septembre, à 10 h 1
-
4 mise à jour : Il y a de nombreuses victimes et de nombreux lieux visés, notamment dans la Nation crie de James Smith et à Weldon. Selon les premiers renseignements recueillis, les victimes seraient attaquées au hasard. Les suspects sont Damien Sanderson et Myles Sanderson. Damien Sanderson mesure 5 pi et 7 po et pèse 155 lb. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Myles Sanderson mesure 6 pi et 1 po et pèse 240 lb. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Voir la nouvelle photo ci-jointe. Il s’agit d’une situation qui évolue rapidement. Nous prions la population de prendre les précautions nécessaires. Ne quittez pas un lieu sûr. Faites preuve de prudence si vous autorisez d’autres personnes à entrer dans votre domicile. NE VOUS APPROCHEZ PAS de personnes suspectes. Ne prenez pas d’autostoppeurs. Signalez toute situation urgente ou information pertinente au 911.
- Le 4 septembre, à 12 h 7
-
5 mise à jour : La GRC de la Saskatchewan a été informée que les suspects pourraient s’être déplacés dans le secteur de l’avenue Arcola à Regina (Saskatchewan), vers 11 h 45. Ils se déplaçaient à bord d’une Nissan Rogue noire immatriculée en Saskatchewan (119 MPI).
Si vous vous trouvez dans les environs de Regina, prenez des précautions et songez à vous mettre à l’abri sur place. Ne quittez pas un lieu sûr. Faites preuve de prudence si vous autorisez d’autres personnes à entrer dans votre domicile. NE VOUS APPROCHEZ PAS de personnes suspectes. Ne prenez pas d’autostoppeurs. Signalez toute personne suspecte, situation urgente ou information pertinente au 911. Ne divulguez pas les endroits où se trouvent les policiers.
- Le 4 septembre, à 12 h 19 (Alberta)
-
Une alerte de la GRC est élargie pour comprendre le Manitoba et l’Alberta. Une alerte concernant une personne dangereuse est en vigueur après que de nombreux incidents d’agressions au couteau ont été signalés le 4 septembre à divers endroits, y compris dans la Nation crie de James Smith et à Weldon, en Saskatchewan. Deux hommes suspects pourraient se déplacer à bord d’une Nissan Rogue noire immatriculée en Saskatchewan (119 MPI).
- Le 4 septembre, à 13 h 28 (Manitoba)
-
La GRC de la Saskatchewan a diffusé une alerte concernant une personne dangereuse après que de nombreux incidents d’agressions au couteau ont été signalés le 4 septembre à divers endroits, y compris dans la Nation crie de James Smith et à Weldon, en Saskatchewan. Deux hommes suspects pourraient se déplacer à bord d’une Nissan Rogue noire immatriculée en Saskatchewan (119 MPI). On ignore où ils se trouvent actuellement; l’alerte est élargie pour comprendre l’Alberta et le Manitoba.
La population doit prendre les précautions nécessaires. Ne vous approchez pas de personnes suspectes. Signalez toute information pertinente au service de police local et toute situation urgente au 911.
- Le 5 septembre, à 11 h 39
-
6 mise à jour : L’alerte concernant une personne dangereuse diffusée le 4 septembre par la GRC de la Saskatchewan au sujet de nombreuses agressions mortelles au couteau à divers endroits demeure en vigueur. Les deux hommes suspects sont toujours en liberté et n’ont pas encore été retrouvés. La direction qu’ils auraient prise demeure inconnue. Les suspects se déplaceraient à bord d’une Nissan Rogue noire immatriculée en Saskatchewan (119 MPI).
Demeurez vigilant et prenez les précautions nécessaires. NE VOUS APPROCHEZ PAS de personnes suspectes. Ne prenez pas d’autostoppeurs. Signalez toute personne suspecte, situation urgente ou information pertinente au 911. Ne divulguez pas les endroits où se trouvent les policiers.
- Le 5 septembre, à 16 h 35
-
7e mise à jour : Mise à jour sur l’alerte concernant une personne dangereuse diffusée par le Détachement de la GRC de Melfort au sujet de nombreuses agressions au couteau. Damien Sanderson a été retrouvé mort. La GRC de la Saskatchewan continue ses recherches pour trouver Myles Sanderson. Il mesure 6 pi et 1 po et pèse 240 lb. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Il pourrait être blessé et chercher à obtenir des soins médicaux. Il pourrait se déplacer à bord d’une Nissan Rogue noire immatriculée en Saskatchewan (119 MPI). On ignore s’il se déplace seul ou avec quelqu’un d’autre.
La population doit prendre les précautions nécessaires. Ne vous approchez pas de personnes suspectes. Signalez toute information pertinente au service de police local et toute situation urgente au 911.
- Le 6 septembre, à 11 h 40
-
8e mise à jour : Mise à jour sur l’alerte concernant une personne dangereuse diffusée par le Détachement de la GRC de Melfort au sujet de nombreuses agressions mortelles au couteau. Les enquêteurs ont reçu des renseignements selon lesquels le suspect Myles Sanderson aurait été aperçu dans la Nation crie de James Smith. La GRC est en train d’intervenir. Si vous vous trouvez dans le secteur, mettez-vous immédiatement à l’abri. Faites preuve de prudence si vous autorisez d’autres personnes à entrer dans votre domicile. Ne quittez pas un lieu sûr. NE VOUS APPROCHEZ PAS de personnes suspectes. Ne prenez pas d’autostoppeurs. Signalez toute personne suspecte, situation urgente ou information pertinente au 911. Ne divulguez pas les endroits où se trouvent les policiers.
- Le 6 septembre, à 14 h 56
-
9 Mise à jour sur l’alerte concernant une personne dangereuse diffusée par le Détachement de la GRC de Melfort au sujet de nombreuses agressions mortelles au couteau. Une enquête plus poussée a permis de conclure que Myles Sanderson ne se trouve plus dans la collectivité de la Nation crie de James Smith. La GRC est toujours à sa recherche. Puisque nous ne savons toujours pas où il se trouve, nous prions la population de prendre les précautions nécessaires.
Ne vous approchez pas de personnes suspectes. Signalez toute information pertinente au service de police local et toute situation urgente au 911.
- Le 7 septembre, à 14 h 39
-
Mise à jour sur l’alerte concernant une personne dangereuse diffusée par le Détachement de la GRC de Melfort au sujet de nombreuses agressions mortelles au couteau.
Myles Sanderson est visé par de multiples chefs d’accusation de meurtre au premier degré. Il n’a PAS été retrouvé. Myles mesure 6 pi et 1 po et pèse 240 lb. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Il pourrait être blessé et avoir besoin de soins médicaux. La Nissan Rogue noire immatriculée en Saskatchewan (119 MPI) n’a PAS été localisée. L’alerte d’urgence demeure en vigueur; nous demandons au public de continuer de faire preuve de vigilance. Si un risque élevé pour la sécurité du public est cerné, d’autres alertes d’urgence seront diffusées. Toute mise à jour sur l’enquête sera publiée sur la page Web à l’adresse rcmp-grc.gc.ca/en/sk dès que de nouveaux renseignements seront disponibles.
- Le 7 septembre, à 14 h 49
-
Avis concernant une personne armée d’un couteau qui se déplacerait à bord d’une Chevrolet Avalanche 2008 blanche immatriculée en Saskatchewan (953 LPL) déclarée volée à Wakaw vers 14 h 10 aujourd’hui. Le véhicule a été vu pour la dernière fois sur le chemin Cemetery, à Wakaw. La direction dans laquelle il se déplace est inconnue. On ignore l’identité des personnes impliquées. Nous croyons que l’incident pourrait être lié à l’alerte concernant une personne dangereuse diffusée par la GRC de Melfort le dimanche 4 septembre. Si vous vous trouvez dans le secteur de Wakaw, mettez-vous immédiatement à l’abri. Faites preuve de prudence si vous autorisez d’autres personnes à entrer dans votre domicile. Ne quittez pas un lieu sûr. NE VOUS APPROCHEZ PAS de personnes suspectes. Ne prenez pas d’autostoppeurs. Signalez toute personne suspecte, situation urgente ou information pertinente au 911. Ne divulguez pas les endroits où se trouvent les policiers.
- Le 7 septembre, à 15 h 50
-
ANNULÉE – Alerte concernant une personne dangereuse diffusée par le Détachement de la GRC de Melfort : Myles Sanderson a été retrouvé et placé en détention près de Rosthern, en Saskatchewan, vers 15 h 30 aujourd’hui. Il n’y a plus de risque pour la sécurité du public en lien avec cette enquête. Toute mise à jour sur l’enquête sera publiée sur la page Web de la GRC de la Saskatchewan : www.rcmp-grc.gc.ca/en/sk
Valeur perçue des alertes publiques
D’après les personnes sondées (policiers et membres du public), l’opinion prédominante est que les alertes publiques ont été efficaces, puisqu’elles ont permis de transmettre rapidement au public des renseignements importants en matière de sécurité. Cela étant dit, il a également été signalé que certaines personnes ignoraient les alertes ou ne les avaient tout simplement pas reçues, car elles n’avaient pas de téléphone cellulaire. Par conséquent, chaque alerte a également été diffusée dans un communiqué et publiée sur Facebook, afin de permettre au public d’obtenir l’information de diverses sources. Après l’incident, l’élargissement de certaines alertes pour comprendre l’Alberta et le Manitoba a été remise en question. Toutefois, on considère que cette mesure était justifiée, car les suspects étaient toujours en liberté et que des renseignements avaient été reçus selon lesquels ils se déplaçaient sur la route Transcanadienne dans une direction inconnue.
Il ne fait aucun doute que les alertes publiques diffusées avaient une valeur considérable. La majorité des personnes sondées conviennent que le nombre d’alertes et le contenu de celles-ci étaient adéquats. Néanmoins, le fait d’informer les personnes touchées par un incident si tragique qui continue d’évoluer a pour conséquence naturelle d’entraîner des répercussions négatives potentielles sur les survivants et les familles des victimes. Les nombreuses alertes reçues et le son discordant produit par celles-ci ne peuvent que bouleverser ces gens. Malgré tout, la valeur des alertes publiques a été reconnue dans la collectivité de la NCJS; certaines personnes croient tout de même que les collectivités des Premières Nations devaient avoir leur propre système d’alerte, étant donné leurs besoins et enjeux géographiques et locaux uniques.
Peu importe les circonstances, il faudra toujours trouver un juste équilibre entre le besoin d’informer le public pour des raisons de sécurité et le besoin d’informer le public dans le simple but de fournir une mise à jour. Si le but est uniquement de fournir une mise à jour au public, des dispositions pourraient être prises pour permettre aux équipes de liaison avec les familles/victimes de transmettre l’information aux familles touchées d’abord, avant la diffusion d’une alerte.
Médias sociaux
Dans le monde d’aujourd’hui, de plus en plus de gens comptent sur les médias sociaux comme principale source d’information. Nombreux sont ceux qui s’attendent à trouver les dernières nouvelles sur les médias sociaux en premier. De plus, le contenu des publications sur les médias sociaux a tendance à façonner le récit d’une situation et à influer sur les perceptions des utilisateurs. Cela peut entraîner des répercussions positives et négatives. Peu importe leur valeur perçue, les médias sociaux sont devenus un mode de communication important permettant de diffuser des nouvelles et des mises à jour urgentes avec le public.
Plus précisément en ce qui concerne l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon, le personnel des Communications stratégiques a publié toutes les mises à jour dans les médias sociaux. Initialement, ces publications étaient considérées comme un moyen secondaire d’informer le public au sujet des incidents critiques qui survenaient. Toutefois, les médias sociaux se sont avérés encore plus importants au fil du temps. Dans le cadre de l’enquête, lorsque la communication de renseignements n’avait pour but que de fournir de l’information et des mises à jour au public, les médias sociaux et les communiqués sont devenus les principaux moyens de transmettre l’information. Les conférences de presse sur l’incident étaient diffusées en direct sur Facebook et des liens vers la diffusion en direct étaient également publiés sur Twitter.
Même si la fonction « commentaires » dans Facebook avait été désactivée, les membres du public avaient tout de même la capacité de communiquer des renseignements à la police en envoyant des messages privés, s’ils le souhaitaient. Des ressources de la Division K étaient disposées à participer à la surveillance de la boîte de réception Facebook; toutefois, très peu de messages ont été reçus, donc le tout a pu être surveillé à l’interne.
La collectivité de la NCJS a une page Facebook, sur laquelle étaient rediffusées les diverses mises à jour de la GRC. Cette méthode de transmission de l’information a été jugée comme moyen efficace de transmettre des renseignements exacts à la collectivité. En revanche, des mises à jour hypothétiques et non officielles ont également été publiées sur Facebook par des membres de la collectivité. Ces messages étaient parfois erronés et semaient la confusion. Cet élément a été soulevé lors d’entrevues auprès de certains membres de la collectivité de la NCJS. On a même suggéré qu’il aurait pu y avoir un membre de la collectivité désigné, chargé de fournir des renseignements exacts sur la page Facebook.
Haute direction
La commandante divisionnaire, la commissaire adjointe Rhonda Blackmore (commissaire adjointe Blackmore), était la principale porte-parole de la GRC et est devenue le visage de l’intervention de la GRC lors de l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon. La commissaire adjointe Blackmore a contribué aux efforts dès le début de l’incident et a participé aux séances d’information régulières. Ainsi, elle est demeurée bien au fait de l’information en temps réel qui pouvait être transmise. La commissaire adjointe Blackmore a misé sur la transparence dès le début; chose qui s’est avérée manifeste par sa disponibilité pour les médias. Cette transparence s’est également révélée d’autres façons, par exemple lorsqu’il a été annoncé tôt que le frère du suspect n’était plus considéré comme coauteur des nombreux meurtres, et lorsque des mises à jour sur le nombre de victimes ont été envoyées de façon continue. Habituellement, la GRC ne produit pas des mises à jour aussi rapidement qu’elle l’a fait pendant cet incident. De plus, selon les membres de la GRC et, par extension, le public, les mises à jour étaient opportunes et nécessaires.
L’objectif principal des entrevues avec les médias était d’assurer une disponibilité pour la télévision, la radio et les journaux à l’échelle locale d’abord, puis dans l’intérêt national ensuite . La commissaire adjointe Blackmore a réalisé des entrevues à l’échelle nationale aux émissions « CTV National News » et « The National » de la CBC, et s’est rendue disponible pour des entrevues et pour fournir des mises à jour. Une grande partie de la journée de travail de la commissaire adjointe Blackmore était réservée aux médias, de façon à veiller à ce que le public soit tenu bien informé de la situation.
Communications
Des représentants des Communications stratégiques ont participé à toutes les séances d’information et à toutes les réunions tenues, dès le début de l’incident dans la NCJS/à Weldon, pendant qu’il se produisait et après. Ce niveau de communication a permis au personnel du Groupe des relations avec les médias de fournir au public des messages fondés, clairs, opportuns et transparents.
Les communications avec le gouvernement de la Saskatchewan se sont produites très rapidement. Le 4 septembre, à 7 h 7, le sous-ministre adjoint des Services de police et de sécurité des collectivités a été informé de la situation et a été tenu au courant des faits. D’autres appels ont été faits à la haute direction, aux Services de soutien opérationnel aux membres et à la Fédération des nations autochtones souveraines.
On a également communiqué avec des services de police externes lorsque cela s’avérait nécessaire. Par exemple, des renseignements ont été reçus le 4 septembre selon lesquels on croyait que le véhicule suspect se trouvait à Regina. On a immédiatement informé le Service de police de Regina de la situation et du fait qu’une alerte publique visant Regina précisément allait être diffusée. Bien que ces renseignements n’aient pas été confirmés (explications ci-dessus), la communication entre les services était facile, principalement étant donné la relation préexistante entre le directeur des Relations avec les médias de la GRC et le directeur des Communications au Service de police de Regina. Ces liens ont favorisé davantage les séances de remue-méninges entre stratèges en médias, qui ont permis de renforcer la cohérence de la circulation de l’information depuis les lieux de l’incident à Regina, à mesure que des renseignements étaient reçus.
On a communiqué avec d’autres divisions, notamment la Division D (Manitoba) et la Division K (Alberta), ainsi qu’avec les Services nationaux de communication, afin d’obtenir de l’aide, au besoin. La Division D et les Services nationaux de communication ont chacun envoyé une ressource en communications à des fins d’assistance, et la Division K était disposée à participer à la surveillance des médias sociaux, au besoin.
Résumé
Lorsque la police est aux prises avec une situation où une personne ayant commis des crimes violents est en fuite, et qu’il existe une forte possibilité de préjudices supplémentaires visant d’autres membres du public, une analyse du type et du volume de communications échangées entre la police et le public pendant l’incident sera généralement requise. Dans ce type de situation, la police doit s’acquitter de la tâche difficile de trouver un équilibre entre la nécessité pour le public d’être informé de faits pertinents à des fins de sécurité et le risque de compromettre les efforts d’arrestation et l’enquête criminelle qui s’ensuit.
Chaque situation est unique, et il serait injuste de comparer les détails précis de divers incidents antérieurs. Néanmoins, certains principes généraux doivent être considérés comme étant chose courante dans le cadre de toute intervention, notamment des politiques claires, la planification et la formation.
Outre la communication rapide entre l’agent de service et l’agent des relations avec les médias (ARM), la reconnaissance du besoin de diffuser rapidement l’information au public a servi de fondement pour veiller à ce que le public demeure bien informé, pendant toute la durée de l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon.
Une fois l’autorisation de diffuser l’alerte publique initiale accordée, l’ARM désigné a immédiatement été intégré à la structure de commandement et est devenu une présence permanente au poste de commandement d’incident. À partir de ce moment, les communications publiques ont été entièrement intégrées à l’intervention en cas d’incident critique. Les scénarios de formation réalisés avant l’incident en cause étaient devenus nettement évidents, et cette mise en pratique devrait être considérée comme une preuve d’amélioration par rapport aux incidents ayant fait un grand nombre de victimes survenus par le passé.
Communications opérationnelles
Lorsque survient une situation d’urgence, les stations de transmission opérationnelle (STO) peuvent être submergées d’appels concernant l’urgence, selon le type de situation, l’emplacement et le moment de la journée. Un afflux massif d’appels connexes peut s’avérer accablant, compte tenu du nombre de répartiteurs en service et de leur niveau d’expérience.
Les répartiteurs des STO jouent un rôle essentiel dans la gestion des communications d’urgence concernant un incident, non seulement au moment de la répartition initiale, mais tout au long de l’incident. Un répartiteur d’expérience bien formé devrait être considéré comme une composante essentielle de l’équipe d’intervention globale.
La présente section du rapport porte sur les mesures prises par la STO de la Division F et le rôle de la STO dans le cadre de l’intervention lors de l’incident ayant fait un grand nombre de victimes dans la NCJS et à Weldon.
Au sujet de la STO de la Division F
Située dans le quartier général de la Division F à Régina, la STO reçoit plus de 250 000 appels de service du public par année. La STO travaille en collaboration avec quelque 1 200 policiers dans presque 100 détachements et groupes à l’échelle de la Saskatchewan. Pour chaque quart de travail à la STO, entre six et douze opérateurs apportent un soutien aux trois districts de la Division F .
La STO compte quatre équipes, et chacune comprend douze opérateurs et deux superviseurs. En raison de pénuries de personnel, il arrive qu’il y ait moins d’employés en poste d’un quart à l’autre. En 2022, la STO a perdu 12 employés par attrition, ce qui a porté le nombre de postes vacants à 15, au moment de la réalisation du présent examen. La principale raison soulevée pour le départ des employés qui quittent la STO est le salaire. Les employés de la STO de la GRC sont considérablement moins bien rémunérés que leurs homologues municipaux, par exemple au Service de police de Regina, où un opérateur peut toucher jusqu’à 30 000 $ de plus par année. En outre, la STO compte huit postes bilingues, mais seulement un de ces postes est actuellement occupé. À l’heure actuelle, la STO compte huit employés nommés pour une durée déterminée qui pourraient occuper certains des postes vacants une fois qu’ils auront réussi la formation d’un an.
La STO a pris des mesures pour susciter l’intérêt du public relativement au travail des opérateurs, notamment en participant à des salons de l’emploi et à des campagnes-éclair sur les médias sociaux. Toutefois, il s’agit d’un long processus et il n’y a pas de solution immédiate au problème de pénurie du personnel.
Questions en matière de ressources liées à l’incident
La STO a commencé à recevoir les premiers appels de service en lien avec l’incident dans la NCJS vers 5 h 40, c’est-à-dire vers la fin du quart de nuit, selon l’horaire de la STO. En général, il y a moins d’appels de service la nuit, donc moins de ressources sont présentes pendant ces quarts. Néanmoins, à 6 h, il y avait trois « téléphonistes » et deux « répartiteurs » en poste, ce qui représente un effectif habituel. À 7 h, les ressources du quart de jour sont rentrées et ont été en mesure d’apporter une aide afin de pallier l’augmentation du volume d’appels.
Pendant les 24 heures qui ont suivi l’appel initial visant à signaler l’incident dans la NCJS à la police, la STO a répondu à environ 2 600 appels; en temps normal, le volume d’appels pendant la même période aurait été d’environ 500.
Les cadres supérieurs, le superviseur et le gestionnaire de la STO ont été appelés au travail entre 6 h et 7 h le 4 septembre et aidaient à prendre des appels pour compenser le besoin de répartiteurs supplémentaires. Il ne s’agissait pas d’une solution idéale, car le temps accordé à la répartition empêchait les cadres d’assumer leurs responsabilités de supervision. Toutefois, le besoin immédiat de répondre aux appels était considéré comme prioritaire à ce moment-là. Peu de temps après, d’autres ressources de la STO ont été appelées en renfort.
Les opérateurs de la STO se trouvaient dans une situation où ils devaient gérer de nombreux enjeux en temps réel avec des plaignants au téléphone. Les opérateurs de la STO demandaient aux plaignants de quitter les lieux où ils se trouvaient pour se rendre au bureau du conseil de bande, afin d’assurer leur sécurité. Les plaignants se sont montrés manifestement préoccupés en attendant l’arrivée de la police aux divers lieux, et les opérateurs de la STO ont fait de leur mieux pour informer les appelants qu’il y avait plusieurs scènes de crime et que des membres étaient en train d’intervenir. Les membres ne pouvaient pas, toutefois, se rendre à toutes les scènes de crime en même temps. De plus, la capacité de trouver des adresses dans la NCJS s’est avérée difficile, puisque les noms de rue et les numéros n’étaient pas clairs, ni pour les téléphonistes ni pour les plaignants.
Pendant les jours qui ont suivi l’incident, les répartiteurs sont restés au travail, au-delà des horaires prévus, et ont sacrifié des pauses pour pallier le manque de ressources et pour veiller à ce que tous les renseignements reçus durant les quarts antérieurs soient transmis adéquatement au personnel entrant.
Plus précisément, le 7 septembre, la STO a demandé et a reçu des travailleurs de relève de la STO, car il s’agissait d’une journée extrêmement chargée. Dans le but d’atténuer le manque de personnel, les deux zones (Nord et Sud) ont été combinées et des opérateurs additionnels ont été appelés à faire des heures supplémentaires. Il y avait au total dix opérateurs pour le reste du quart. En plus des ressources de la Division, on pourrait envisager la possibilité de recourir aux opérateurs du Service de police de Regina pendant des incidents majeurs, pour réduire les pressions liées à la pénurie de personnel.
La STO devait également mobiliser des groupes de renfort sur demande, ce qui a détourné l’attention des opérateurs des nombreux appels entrants dont il fallait également s’occuper. Le système Everbridge a été établi comme solution de rechange pour certaines procédures de demandes de service. Everbridge est un système de notification de masse qui permet d’envoyer des alertes aux employés ayant un profil d’utilisateur. Les nouvelles recrues qui arrivent à la Division Dépôt se créent un profil et se servent de ce système en cas d’urgence pendant la formation. Ce système permet aux membres de recevoir les renseignements les plus à jour si une situation d’urgence se produit. À l’avenir, le recours au système Everbridge pour mobiliser divers groupes lors d’un incident majeur pourrait permettre d’alléger en partie les pressions subies par la STO, comme dans le cas de l’incident dans la NCJS/à Weldon.
Triage des appels
Comme il a déjà été mentionné à la section Mesures tactiques et intervention lors de l’appel initial, le processus de répartition des appels au 911 en Saskatchewan commence par la réception d’un appel par l’un des trois Centres téléphoniques de sécurité publique (CTSP) situés à Regina, à Saskatoon et à Prince Albert. Ensuite, l’appel est transféré au service adéquat, à savoir les services de police, les services d’incendie ou les services médicaux d’urgence. Les centres de Regina et de Saskatoon traitent généralement des appels au 911 provenant de leur propre ville, tandis que le centre de Prince Albert traite les appels au 911 provenant de secteurs ruraux (notamment ceux de la NCJS et de Weldon). Il est possible que les centres de répartition de Regina et/ou de Saskatoon aient transmis un petit nombre d’appels à la STO, si un opérateur du 911 était trop longtemps en attente avec le centre de Prince Albert, mais la majorité des appels reçus par la STO ont été transmis par le centre de Prince Albert.
Comme il a déjà été mentionné, les fonctions des opérateurs de STO sont réparties d’un quart à l’autre pour comprendre les tâches de « téléphoniste » et de « répartiteur ». Les opérateurs de STO sont formés à la fois aux fonctions de téléphonistes et aux fonctions de répartiteurs. Les fonctions sont explicites, c’est-à-dire que le téléphoniste reçoit des renseignements pertinents par téléphone d’un appelant, lesquels devront être transmis au répartiteur. Le répartiteur doit ensuite communiquer avec un membre du service de compétence puis transmettre les renseignements, et le membre finit par intervenir.
L’une des lacunes soulevées quant à la formation des opérateurs de STO concerne la portée des renseignements recueillis par les téléphonistes auprès du public et la façon dont ils sont recueillis. À l’heure actuelle, on enseigne aux opérateurs à tâcher d’obtenir le plus de renseignements possible avant de mettre fin à un appel. Toutefois, les opérateurs ne sont pas formés de façon à adapter cette pratique lorsque survient une situation émergente, comme celle qui évoluait dans la NCJS. La formation ne prévoit pas les situations où un opérateur pourrait avoir besoin de mettre en attente un appel ou d’y mettre fin, de façon à prendre des appels potentiellement plus urgents dans la file d’attente. Entre 5 h 40 (heure de réception de l’appel initial concernant la NCJS) et 7 h 12 (heure de diffusion de la première alerte publique), la STO a reçu 36 appels au 911 qui étaient directement liés aux agressions au couteau en cours. Parmi ces appels, les suspects avaient été identifiés à 13 reprises, et un véhicule suspect avait été mentionné deux fois.
À mesure que la STO recevait des appels au 911 concernant la NCJS et Weldon, des membres du Détachement de Melfort étaient envoyés sur les lieux et des dossiers distincts étaient créés pour chaque plainte. Cependant, les appels ne respectaient pas la chronologie réelle des événements survenus dans la NCJS, puisqu’il y avait des retards entre la perpétration des infractions et le moment où les incidents étaient signalés. En raison des enjeux liés à la séquence des incidents, en plus de la possibilité qu’un même incident soit signalé par plusieurs plaignants, il était difficile pour les opérateurs de la STO de déterminer exactement ce qui se passait à ce moment-là. Avec du recul, il est plus facile de se faire une idée de l’ampleur de la situation que les policiers devaient affronter; mais dans le feu de l’action, cela s’est avéré beaucoup plus difficile.
Lorsque les employés de la STO ont constaté la gravité de l’incident pour lequel des membres étaient déployés, des mesures ont été prises « à l’interne » pour faire un triage des appels le plus efficacement possible. L’opérateur de la STO qui avait pris l’appel initial au 911 a été chargé de traiter précisément les appels concernant la NCJS et Weldon.
L’opérateur désigné qui gérait la situation de la NCJS avait une expérience à titre de superviseur et était l’un des opérateurs les plus compétents à la STO à ce moment-là.
Après les premiers appels (au 911 ou autres) le matin du 4 septembre qui concernaient précisément des personnes blessées ou décédées, la nature des appels a changé. Dès que des renseignements ont été reçus au sujet des suspects présumés et de leurs allées et venues, des alertes publiques ont été diffusées. La première alerte publique a été diffusée à 7 h 12, et à partir de ce moment-là, la STO a commencé à recevoir un autre afflux d’appels, cette fois concernant des témoins ayant possiblement vu les suspects. Le volume d’appels est passé d’une moyenne habituelle d’environ 500 appels par jour à quelque 2 600 appels. Cette augmentation s’est également accompagnée d’une hausse marquée de membres du public qui appelaient simplement pour exprimer leurs frustrations ou pour donner leur avis sur ce qui se passait. En outre, une alerte publique non connexe a été diffusée le 5 septembre au sujet d’incidents survenus à Shellbrook et à Onion Lake, ce qui a entraîné une confusion au sein du public et une nouvelle hausse du nombre d’appels pour la STO. Même s’il n’avait pas été possible de prévoir ces incidents et que cela ne diminue en rien l’importance de diffuser toute information pertinente au public, il convient de le mentionner, car les ressources de la STO ont dû composer avec cette situation.
Pendant la « transition » de la nature des appels reçus du public, un certain nombre de décisions en matière de logistique et de commandement ont été prises, lesquelles ont eu une incidence sur la façon dont l’information était traitée. Le Centre divisionnaire des opérations d’urgence (CDOU) a été activé; le commandant des interventions critiques (CIC) a commencé à intervenir; et le Groupe des crimes majeurs (GCM) a été mobilisé. Le GCM a créé une équipe d’arrestation consacrée à trouver et à arrêter les suspects.
Durant l’incident, le GCM croyait que tous les renseignements reçus (tuyaux ou autres) par la STO passaient par le GCM, afin que les ressources désignées (équipe d’arrestation) soient tenues au courant des renseignements les plus récents et pertinents et soient déployées en conséquence. Toutefois, pendant un certain temps, la STO ne semblait pas être au courant qu’une équipe d’arrestation avait été créée et poursuivait la pratique habituelle d’affecter des membres et de créer des dossiers.
Ce manque de familiarité avec des situations du genre a déstabilisé la circulation de l’information au GCM et, en fin de compte, à l’équipe d’arrestation . Plus précisément, des signalements ont été reçus selon lesquels les suspects avaient été aperçus près de la collectivité de Wakaw en après-midi et en soirée le 4 septembre (voir la photo en référence dans la Chronologie de l’incident, route 41), mais ils n’ont pas été transmis au GCM par la STO. Par la suite, ces appels (pour signaler que les suspects avaient été vus) se sont avérés importants, car l’un des appelants connaissait personnellement le suspect. Cela étant dit, l’appelant n’avait pas mentionné à l’opérateur de la STO ce lien personnel entre lui et le suspect au moment de l’appel; ce fait n’a été établi que plus tard, lorsque le GCM a mené une entrevue auprès de l’appelant.
Les superviseurs de la STO pouvaient voir tous les appels connexes au 911 concernant les observations possibles des suspects par l’entremise d’un document Excel qui avait été créé à des fins de suivi. La communication entre ces superviseurs et le GCM (et, en fin de compte, l’équipe d’arrestation) aurait pu servir de lien pour veiller à ce que l’information soit transmise au groupe approprié et aurait pu dissiper la confusion concernant l’information fournie.
Certaines des lacunes en matière de communication susmentionnées auraient pu être atténuées s’il y avait eu un lien plus étroit entre le CDOU et la STO. Bien que les deux groupes aient été à proximité l’un de l’autre, il y a eu un manque manifeste de communication entre eux. Comme il a été mentionné dans l’examen de la Structure de commandement, le CDOU servait de « carrefour de renseignements », à mesure que le quartier général de la GRC à Regina recevait des renseignements. On pourrait soutenir qu’à tout moment, le CDOU disposait des renseignements les plus récents en temps réel concernant l’incident qui survenait dans la NCJS et à Weldon. À titre de bras droit de la STO, les membres des Services de soutien opérationnel aux membres (SSOM) qui étaient intégrés à la STO auraient pu servir d’intermédiaires s’ils avaient été invités à participer aux séances d’information tenues au quotidien.
Les problèmes technologiques et le manque d’interopérabilité entre le CDOU et la STO ont été examinés dans la section Fonctionnement du Centre divisionnaire des opérations d’urgence.
Bien que cela se soit produit moins fréquemment, des renseignements ont été reçus directement à certains détachements, au lieu de passer par la STO. Pour clarifier, lorsqu’un membre du public appelle à un détachement de la GRC, il peut choisir la ligne administrative ou la ligne de réception des plaintes. S’il n’y a personne dans le détachement pour prendre l’appel, le membre du public peut laisser un message sur la ligne administrative ou, s’il a choisi d’appeler la ligne de réception des plaintes, l’appel sera transmis à la STO. Tous les appels à la STO sont enregistrés, et les opérateurs des STO sont formés pour recueillir les renseignements requis. Si un appel est reçu par le personnel administratif d’un détachement, cet appel n’est pas enregistré, et rien ne garantit que l’information reçue sera transmise comme il se doit. Pour remédier à ce problème, les appels aux lignes téléphoniques dans le secteur immédiat d’un incident majeur peuvent être automatiquement transmis à la STO, pour veiller à ce qu’ils soient enregistrés et à ce que tout renseignement pertinent soit transmis. Il convient de noter que cette solution de transfert automatique des appels peut toutefois mener à la réception d’appels non pertinents ou de nature administrative à la STO et augmenter encore le volume d’appels.
Compte tenu du nombre considérable d’appels que devaient gérer les opérateurs de la STO en lien avec la NCJS et Weldon, des appelants ont inévitablement dû être mis en attente ou ont reçu un message automatisé, à certains moments. Le programme de mise en file d’attente des appels qu’utilise actuellement la STO ne permet pas de faire de distinction entre les appels au 911 et les appels moins urgents qui se trouvent dans la file d’attente, ce qui empêche les opérateurs de la STO d’accorder la priorité aux appels au 911. Ce problème sera réglé par la mise en œuvre d’un nouveau système (service 911 de prochaine génération) plus tard cette année.
Problèmes liés à la couverture radio
Pour que les policiers puissent réaliser leurs fonctions de manière efficace et sécuritaire, ils doivent être en mesure de communiquer entre eux et avec la STO. La STO et les membres qui travaillent régulièrement à Melfort savent qu’il existe depuis toujours des zones de « non-couverture » sur le territoire de compétence du Détachement de Melfort, surtout en ce qui concerne les radios portatives. Cette lacune en matière de communication est un problème qui perdure et qui était évident pendant l’intervention du 4 septembre. Au cours de l’examen, il a été déterminé qu’un grand nombre de membres n’étaient pas en mesure de communiquer adéquatement au moyen de leur radio portative ou devaient utiliser un autre mode de communication pour mettre à jour leur état ou pour transmettre de l’information. Par conséquent, la STO devait reconstituer les renseignements obtenus par communications radio et au moyen d’appels par téléphone cellulaire, ce qui n’est pas une situation idéale. L’incapacité des membres à communiquer entre eux constitue une menace tant pour la police que pour la sécurité publique. De nouveaux sites radio pourraient améliorer la couverture, mais il s’agit d’une solution très chère, et pour assurer une couverture dans tous les secteurs, cela coûterait plusieurs millions de dollars.
Bien que la solution à ce problème dépasse le cadre du présent examen, il est important de reconnaître le problème et de cerner des mesures qui pourraient permettre de l’atténuer à court terme. Pour comprendre le processus, il faut d’abord comprendre les divers organismes et groupes touchés ainsi que leurs rôles.
Informatique
De façon générale, lorsque des membres éprouvent un problème technique quelconque, une première tentative de résolution du problème est réalisée « à l’interne » et ensuite par le service de l’Informatique. Le service de l’Informatique est bien connu à l’échelle de la GRC. La plupart des membres savent que lorsqu’ils sont confrontés à un problème technique, c’est avec ce groupe qu’il faut communiquer.
À la Division F, l’Informatique compte trois groupes conçus pour régler les problèmes techniques auxquels les employés de la GRC peuvent être confrontés.
Le groupe de la Technologie de l’information compte sept équipes à l’échelle de la Saskatchewan, qui sont responsables du soutien et de la maintenance de l’ensemble de la technologie voix-données dans leur division. Leur rôle est de fournir une orientation, des solutions techniques, des services d’installation, un soutien et une maintenance continue relativement à tous les systèmes informatiques, les systèmes de voix-données, les systèmes de données mobiles et les systèmes essentiels à la mission en Saskatchewan. Les problèmes liés à l’interopérabilité radio relèvent de cette section.
Le groupe de la Gestion de l’information est responsable de l’ensemble des renseignements organisationnels qui doivent être gérés dans les systèmes actuels de gestion de l’information qui reflètent les activités quotidiennes de l’organisation. L’information doit également être accessible et consultable en tout temps, dans le but de répondre aux demandes relatives à l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels.
Le groupe du Soutien opérationnel est chargé des services d’acquisitions de TI et des services d’applications. Des consultants sont disposés à collaborer avec des groupes ou des détachements à divers projets, par exemple l’acquisition de nouveaux logiciels ou ordinateurs.
En ce qui concerne les problèmes d’interopérabilité radio, la solution n’est pas aussi simple que de demander à l’Informatique de se rendre dans le secteur à faible couverture et d’installer une tour radio. Certains organismes du gouvernement de la Saskatchewan supervisent l’ensemble de la gestion des services d’urgence (explications à venir).
Réseau provincial de télécommunications de sécurité publique
Le RPTSC est l’organisme qui gère le réseau radio par l’entremise d’un partenariat entre SaskPower, l’Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan (ASPS) et la GRC. L’ASPS est l’organisme du gouvernement provincial responsable de la gestion des situations d’urgence, de la sécurité incendie, de la lutte contre les incendies de forêt ainsi que des services de répartition des appels d’urgence au 911 de la Saskatchewan.
Le RPTSC fournit à la GRC un système de radiocommunications interopérable lui permettant de communiquer avec d’autres organismes (services médicaux d’urgence, services d’incendie, etc.) pendant des situations d’urgence.
Le RPTSC dispose de spécialistes des interventions d’urgence qui sont disposés à intervenir en tout temps pour régler des problèmes pouvant toucher l’une ou plusieurs des quelque 250 tours de radiodiffusion dans la province. Les spécialistes sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à toute situation d’urgence dans les plus brefs délais.
Le RPTSC a également accès à des tours de télécommunications mobiles (TTC); il s’agit de remorques de transport d’équipement munies d’une tour télescopique de 100 pieds qui peut renforcer la couverture radio dans le cadre d’interventions lors d’incidents particuliers.
En ce qui concerne l’intervention dans la NCJS/à Weldon, lorsqu’il a été déterminé que la couverture radio posait problème, la STO en a été informée et, en retour, le gestionnaire de l’informatique a approuvé l’utilisation d’une TTC. Un employé de l’Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan en a été informé et a conduit la tour jusqu’au lieu où les responsables de l’informatique devaient mettre en place l’ensemble de la technologie. Une tour de radiodiffusion mobile a été installée à Melfort le 5 septembre, ce qui a permis d’atténuer certains des problèmes liés à la couverture radio.
[CAVIARDÉ]
Système de répéteur numérique pour véhicule
Comme il a déjà été mentionné à la section Mesures tactiques et intervention lors de l’appel initial, une autre façon d’améliorer la couverture des radios portatives dans les zones où la réception est mauvaise est le système de répéteur numérique pour véhicule (DVRS). Le système DVRS est un répéteur qui est « monté » dans un véhicule et qui peut améliorer la portée des radios portatives lorsque la couverture radio du Réseau provincial de télécommunications de sécurité publique (RPTSP) n’est pas fiable.
Essentiellement, le système DVRS donne au policier ayant une vue directe sur son véhicule de police une meilleure réception sur sa radio portative. [CAVIARDÉ].
Il y a des directives claires sur la page Infoweb de la Division F – Informatique sur l’utilisation du système DVRS, ainsi qu’une vidéo didactique pouvant être transmise par courriel aux membres, sur demande.
En raison des coûts trop élevés, seulement [CAVIARDÉ] des véhicules de police de la Division sont équipés d’un système DVRS. En outre, le système de répéteur n’a pas été bien accueilli ni utilisé largement par les membres, car on le considère utile que dans un nombre limité de situations et parce qu’il nécessite des manipulations de la radio qui ne semblent pas réalistes dans un contexte de stress élevé.
Application BeOn
Comme suite aux plaintes en matière de santé et de sécurité déposées par des membres ayant subi les répercussions d’une mauvaise couverture des radios portatives pendant certains incidents, l’Équipe de gestion supérieure de la Division F a réalisé un projet pilote de septembre 2021 à janvier 2022 pour tenter de trouver d’autres modes de communication possibles. Comme il a déjà été mentionné, l’aménagement de nouveaux sites radio entraînerait des dépenses très élevées et prendrait du temps, et le système DVRS, bien qu’il soit disponible, comporte des limites et n’est pas largement accepté ou utilisé par les membres.
Par conséquent, l’Équipe de gestion supérieure a choisi un détachement dans chaque district pour mener un projet pilote au moyen de l’application BeOn. BeOn est une application installée sur un appareil cellulaire qui fournit une fonction Push to Talk (SNLJ), c’est-à-dire une fonction de messagerie instantanée vocale, d’une façon similaire aux radios portatives, en utilisant des réseaux cellulaires commerciaux pour connecter les téléphones cellulaires au Réseau provincial de télécommunications de sécurité publique (RPTSC). La technologie Push-To-Talk sur cellulaire (PTToC) permet aux utilisateurs de communiquer par l’entremise du RPTSC lorsque la couverture radio habituelle n’est pas disponible.
Parmi les avantages de l’application BeOn qui ont été soulevés, mentionnons les suivants : les membres ont apprécié la couverture supplémentaire, [CAVIARDÉ], et étaient favorables à l’idée que les chefs de détachement puissent surveiller les appels depuis la maison ou le bureau. À condition qu’il y ait une couverture cellulaire adéquate, l’application BeOn fonctionne sur réseau WiFi, si le téléphone y est connecté.
Avantages
- Assure une couverture radio dans les zones où le RPTSC n’est pas disponible;
- Les membres ont déjà chacun un téléphone cellulaire;
- Le téléchargement de l’application est gratuit, et les frais de licence sont d’environ 260 $/appareil (frais pour portable, environ 400 $ chacun);
- [CAVIARDÉ]
- BeOn dispose d’une fonction d’ERTT (demande de communication urgente).
Inconvénients
- À l’heure actuelle, n’a pas de capacité de RTT (demande de communication);
- [CAVIARDÉ]
- Exige une connexion internet au RPTSC central qui nécessite des mesures de sécurité supplémentaires (pare-feu);
- Pendant des périodes à forte utilisation de réseaux cellulaires, il est possible que l’application BeOn ne permette pas de recevoir ou de faire des appels;
- Les membres devront suivre une formation;
- L’outil devrait être utilisé comme système de secours;
- Il est possible que les changements liés aux systèmes d’exploitation des téléphones intelligents apportés par SPC aient une incidence sur les fonctions de BeOn;
- La fonction de cartographie n’est pas fiable.
Les considérations évidentes en matière de coûts, de temps et de ressources nécessaires pour l’installation de ce type d’application n’ont pas encore été déterminées. Toutefois, la direction reconnaît qu’il existe des zones où la couverture radio est mauvaise et déploie des efforts pour améliorer la situation.
Mises à jour sur l’état des membres
À tout moment pendant l’intervention dans la NCJS et à Weldon, entre 100 et 130 véhicules nécessitaient un suivi de la STO. En raison du manque de personnel à la STO, les répartiteurs n’étaient toutefois pas en mesure de vérifier l’état de chacun de façon régulière. Les commandants sur place réalisaient eux-mêmes des vérifications ciblées de l’état des membres, mais il n’était pas réaliste de s’attendre à ce que la STO connaisse l’état de chaque membre à tout moment. Il existait des moyens permettant de fournir un compte rendu plus précis de l’état des membres et un mode opératoire commun (MOC) global, qui seront examinés plus tard.
MRSM/système CIIDS
Chaque membre qui était connecté à son poste de travail mobile (PTM) avait la capacité d’accéder à une communication constante entre lui et la STO, par l’entremise du Module de rapport de situation et de messagerie (MRSM), conjointement avec le Système intégré de répartition de l’information (système CIIDS).
Les membres auraient pu contribuer à diminuer une partie du stress exercé sur la STO en mettant à jour eux-mêmes leur état, par l’entremise de leur PTM. Toutefois, comme il est mentionné à la section Structure de commandement du présent rapport, les membres ne se servaient pas tous de cette fonction du PTM.
La communication radio a été maintenue dans la mesure du possible pour établir un mode opératoire commun. Cependant, si les membres se trouvaient à bord de leur véhicule de police, la STO disposait généralement d’une meilleure vue d’ensemble des endroits où ils se trouvaient à tout moment.
Malgré les efforts déployés par les membres qui mettaient à jour leur état par l’entremise du PTM et du système CIIDS, le logiciel de cartographie de la STO fonctionnait mal pendant l’intervention, et pour certaines zones de la carte, un encadré vide s’affichait sur l’écran d’ordinateur. On a eu recours à Google Maps pour tenter de pallier les défaillances de la fonction de cartographie du système CIIDS.
Trousse de connaissance de la situation tactique de l’équipe pour Android (ATAK)
L’outil ATAK, comme il a déjà été mentionné, est une application qui peut être utile pour établir un mode opératoire commun pour les ressources déployées. Le Groupe tactique d’intervention (GTI) se servait de l’outil ATAK pendant l’intervention dans la NCJS. Toutefois, l’outil ne fonctionnait pas adéquatement à la STO à ce moment-là, donc la STO n’était pas en mesure d’assurer un suivi des déplacements du GTI. Comme indiqué précédemment, des mesures ont été prises par la Division F dans le but d’apporter des améliorations à l’outil ATAK, lesquelles devraient régler ces problèmes.
Communications radio – interopérabilité
En plus de nécessiter une intervention de la Division F de la GRC, l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon a exigé la mobilisation d’autres divisions de la GRC, de services de police municipaux et d’autres organismes. La capacité de communication radio immédiate entre divers organismes (interopérabilité) repose sur de nombreux facteurs. Pour communiquer avec un membre d’un autre service de police ou dans une autre province, il ne suffit pas de simplement appuyer sur un bouton.
Un certain nombre d’options d’interopérabilité sont possibles par l’entremise de la STO (Manuel des opérations, Division F, chapitre 46.100.5.8).
Communications entre la GRC de la Saskatchewan et la GRC en Alberta
La passerelle Network First Gateway permettra à toute radio de la Division F sur le Réseau provincial de télécommunications de sécurité publique (RPTSC) de communiquer avec toute radio de la Division K sur le système de radiocommunications des premiers intervenants de l’Alberta (Alberta First Responders Radio Communication System – AFRRCS), en demandant une liaison par l’entremise de la STO. De plus, trois groupes d’appel [CAVIARDÉ] sont programmés dans les radios compatibles des détachements en bordure de l’Alberta.
Communications entre la GRC et les organismes municipaux
TLa STO a la capacité de demander une liaison radio avec d’autres organismes. Cette capacité d’interopérabilité est programmée dans les radios de police et peut être utilisée pour communiquer avec d’autres organismes utilisant le RPTSC, notamment le Service de police de Prince Albert, le Service de police de Weyburn et tous les services d’incendie et les services médicaux d’urgence dans la province. Pour communiquer avec des organismes qui n’utilisent pas le RPTSC, comme les services de police de Regina, de Saskatoon et d’Estevan, la STO peut créer une liaison pour ces organismes externes également.
[CAVIARDÉ]
[CAVIARDÉ]
Communication radio – codes 10 par rapport à langage clair
Les membres de la GRC ont toujours appris à utiliser les codes 10, principalement parce que ces codes rendent les échanges concis et précis. L’inconvénient des codes 10, toutefois, est qu’ils ne sont pas normalisés, et les services de police n’utilisent pas tous les mêmes, ce qui crée des problèmes lorsque de nombreux organismes interviennent dans le cadre d’un même incident. Par conséquent, le recours à un « langage clair » dans certaines situations devrait être accepté, au lieu des échanges codés par radio.
Selon les politiques, lorsque cela est possible sur le plan opérationnel, les membres de la GRC et les opérateurs de la STO doivent utiliser les codes 10 pour les communications radio. Toutefois, lorsque des communications sont requises entre divers organismes ou secteurs de compétence, il convient de recourir à un « langage clair », au lieu des codes 10 (Politique de la GRC, Manuel de l’informatique, chapitre II.2.11).
L’un des problèmes que pose le recours au langage clair est la possibilité de transmettre sur les ondes des renseignements confidentiels qui pourraient tomber en de mauvaises mains. Comme des membres du public suivent régulièrement les appels de la police au moyen de balayeurs de fréquences de police, certaines communications en langage clair pourraient mener à la divulgation de renseignements de nature sensible concernant la police ou les victimes. Dans des situations critiques, pour maintenir une communication radio adéquate, il faut trouver un juste équilibre entre les renseignements qui peuvent être transmis en langage clair et ceux qui ne doivent pas l’être.
Du point de vue des communications opérationnelles, la communication radio dans son ensemble a été jugée appropriée tout au long de l’intervention dans la NCJS. Il y a eu très peu de bavardage inutile sur les radios et très peu de situations où l’utilisation des codes 10 a semé la confusion. De façon générale, les membres communiquaient principalement au moyen d’un « langage clair ».
Supervision
On considère que les superviseurs de la STO ont fait un travail adéquat pour maintenir la communication avec les opérateurs. En outre, le fait qu’un membre des Services de soutien opérationnel aux membres (SSOM) à temps plein était intégré à la STO et associé à chaque équipe était considéré comme un élément essentiel pour une situation telle que celle qui s’est déroulée dans la NCJS et à Weldon. Voir les explications fournies relativement au groupe des SSOM dans la section « Structure de commandement ».
Intervention visant un grand nombre de victimes
Les incidents du 4 septembre ont marqué les collectivités de la NCJS et de Weldon à tout jamais. Aucun doute ne peut être soulevé à ce sujet. Nul soutien ne saurait effacer le souvenir de ce qui s’est passé ces jours-là, mais l’aide et le soutien apportés aux victimes à la suite du drame peuvent toutefois jouer un rôle important en les aidant à composer avec l’impact de l’incident. La présente section du rapport porte sur le rôle que la GRC a joué dans l’intervention auprès des victimes, de leurs familles et de la collectivité dès les premières heures de la tragédie et durant la période qui a suivi.
Intervention initiale de la GRC
Le matin du 4 septembre, la sergente Ashley St. Germaine (sergente St. Germaine) de la Section des enquêtes générales (SEG) de Prince Albert a été avisée par son superviseur que le Groupe des crimes majeurs (GCM) de Saskatoon avait demandé l’aide de son groupe dans la NCJS en raison de ce qui s’y passait. À ce moment-là, le GCM s’était vu confier la responsabilité de l’enquête criminelle et en était aux premières étapes du traitement des divers lieux touchés. Les efforts étaient centrés sur la recherche et l’arrestation du ou des suspects.
La SEG de Prince Albert est un petit groupe formé de six membres, mais l’un des postes était vacant lorsqu’est survenu l’incident dans la NCJS/à Weldon. La sergente St. Germaine a immédiatement mobilisé quatre ressources, soit trois personnes en plus d’elle-même, pour aller rencontrer les membres du GCM à Melfort. À ce moment-là, aucun rôle particulier n’avait encore été attribué à la sergente St. Germaine et à son équipe, tandis que le nombre de victimes (personnes blessées et décédées) et de lieux touchés ne cessait de croître et que tous essayaient encore de comprendre l’ampleur de la tâche qui les attendait.
À leur arrivée à Melfort, la sergente St. Germaine et son équipe ont rencontré le GCM et ont obtenu le nom et le numéro de téléphone du gestionnaire des lieux touchés ainsi que d’un membre du Groupe des services aux victimes. L’équipe a été chargée de se rendre dans la NCJS afin de commencer à établir le contact et d’entamer la communication avec les familles des victimes.
Une pratique courante du GCM dans le cadre d’une enquête sur un homicide consiste à désigner une seule personne au rôle d’agent de liaison avec la famille. Toutefois, en raison du grand nombre de victimes dans ce cas-ci, la sergente St. Germaine et toute son équipe de la SEG ont été mobilisées et chargées de commencer à aviser les proches des défunts.
La sergente St. Germaine a su reconnaître l’importance du rôle de son équipe dans le cadre de cet incident. Elle savait que son équipe devait fournir des mises à jour exactes et rapides sur l’enquête aux familles et aux autres personnes, et qu’elle devait les orienter vers les divers services offerts par la GRC (p. ex. les Services aux victimes), au besoin. Bien qu’aucun terme officiel n’ait été employé pour désigner son rôle, la sergente St. Germaine a fini par devenir la responsable de la liaison avec les familles des victimes.
À son arrivée dans la NCJS, la sergente St. Germaine a rencontré le gestionnaire des lieux touchés du GCM ainsi qu’un chef au bureau du conseil de bande de la NCJS pour commencer à recueillir le nom des personnes décédées. Elle a reçu du chef une première liste de victimes (décédées et blessées), qui a servi de point de départ pour la liste finale qui a été dressée des victimes décédées, des survivants et des personnes avec qui communiquer.
Après avoir obtenu les noms, la sergente St. Germaine et son équipe se sont rendus sur les lieux touchés pour parler aux proches des victimes. Beaucoup de proches étaient déjà présents, donc l’identification de personnes-contact et la transmission des avis aux plus proches parents se sont faites rapidement. La priorité était d’établir un premier contact avec les familles des défunts; cependant, durant les échanges, le nom de plusieurs témoins et autres personnes blessées a été reçu.
La sergente St. Germaine a distribué le nom des proches des personnes décédées et des survivants parmi les membres de son équipe et a désigné ceux-ci comme principaux points de contact pour la GRC. On a pris en considération les membres qui devaient traiter avec la famille du suspect et la famille du frère du suspect, car on savait qu’ils allaient avoir besoin de temps additionnel. Par conséquent, un moins grand nombre de noms leur a été attribué.
Communication avec le Groupe de soutien aux victimes de la violence de masse
En fin de journée le 4 septembre, une fois tous les proches des défunts avisés, la sergente St. Germaine a commencé à recevoir de l’appui pour les prochaines phases du soutien aux victimes. Elle a communiqué avec le Groupe de soutien aux victimes de la violence de masse (explications à venir) pour obtenir le plus d’information possible sur les mesures additionnelles que pouvaient prendre son équipe et elle. À l’issue de la conversation, bon nombre des préoccupations immédiates soulevées semblaient déjà avoir été réglées; toutefois, cette communication s’est quand même avérée précieuse. Durant la semaine qui a suivi l’incident, tandis que le Groupe de soutien aux victimes de la violence de masse était sur les lieux pour offrir son aide, la sergente St. Germaine a examiné tous les conseils prodigués du point de vue des besoins des Autochtones avant toute chose.
Obstacles rencontrés
Suivi des victimes
On a rencontré des difficultés au moment de déterminer l’identité des blessés et de savoir s’ils avaient été transportés à l’hôpital et, le cas échéant, où. Comme le nombre d'autopsies à réaliser était élevé, il a fallu transporter les dépouilles ailleurs une fois la procédure terminée, et il n’était pas clair au départ où on les emmenait. On a finalement pu obtenir de l’information à cet égard auprès de l’autorité sanitaire de la Saskatchewan, qui a fourni des mises à jour régulières sur l’état des patients et sur ceux qui avaient été transférés dans un autre établissement ou qui avaient reçu leur congé. Ces renseignements se sont avérés essentiels pour identifier les familles, communiquer avec elles et leur offrir du soutien.
Diffusion des communiqués dans les médias
On a découvert la dépouille du frère du suspect le 5 septembre et confirmé son identité peu de temps après. Lorsqu’on a appris l’identité du défunt, deux membres de l’équipe de liaison avec les familles ont été chargés d’aviser l’épouse et la mère de la victime. Ces deux personnes se sont rendues dans la NCJS, mais les proches du défunt étaient partis à Melfort. Tandis qu’on tentait encore de communiquer avec eux, l’heure prévue où l’information devait être diffusée dans les médias est arrivée. L’heure du point de presse avait été déterminée d’avance, et les membres de l’équipe de liaison avec les familles n’ont presque pas eu le temps de se rendre à Melfort en personne pour prévenir les proches du défunt et ensuite aviser les membres du conseil de bande de la NCJS; l’information a été communiquée à la famille et au public presque en même temps. L’équipe de liaison aurait aimé avoir le temps de prévenir convenablement les proches du défunt avant que les médias ne diffusent l’information, mais cela n’a pas été possible en raison des contraintes de temps strictes imposées. Ainsi, beaucoup de proches du défunt ont appris le décès aux nouvelles et non pas de la bouche d’un membre de la GRC venu les prévenir en personne.
Communications
Après avoir été chargés par le GCM de communiquer avec les familles et avoir compris l’importance de leur transmettre des renseignements opportuns et exacts, le chef d’équipe, l’enquêteur principal et la sergente St. Germaine ont décidé d’un commun accord de travailler ensemble à Prince Albert. Ce rassemblement a facilité les communications directes entre tous. La transition s’est faite de façon harmonieuse, car la sergente St. Germaine et son équipe avaient une relation de travail préétablie avec le GCM.
En tant que point de contact unique, la sergente St. Germaine a été en mesure d’échanger beaucoup d’information avec les ressources des Services aux victimes ainsi qu’avec le bureau du conseil de bande de la NCJS et son Centre des opérations d’urgence (COU). Le gendarme Christian Stroet (gendarme Stroet) a été chargé d’assurer la liaison avec le COU en tant qu’agent de liaison additionnel entre l’équipe de la SEG de la sergente St. Germaine, le triangle de commandement du GCM et le conseil de bande de la NCJS. Cette démarche a permis à tous de mieux comprendre les diverses ressources de soutien offertes aux familles par les deux parties (Groupe des services aux victimes et conseil de bande de la NCJS). Le rôle du Groupe des services aux victimes sera expliqué plus en détail plus loin dans la présente section.
Le rôle déterminé de l’agent de liaison avec les familles au sein du COU est devenu un lien important entre le conseil de bande de la NCJS et la GRC. Les trois chefs des Nations respectives, un représentant du Grand Conseil de Prince Albert et les Services de police autochtones de la GRC (explications à venir) étaient également représentés au COU. Cet environnement a permis de communiquer les enjeux dans les deux sens et de définir les besoins et les perceptions de la communauté en temps opportun184. Il a été noté que certains membres de la communauté n’étaient pas à l’aise de parler directement avec la police pendant qu’on cherchait encore le suspect, et les chefs ont parfois dû servir d’intermédiaire, ce qui a eu un impact sur la rapidité et l’exactitude des renseignements. Dans l’ensemble, cependant, la communication a été fluide dans les deux sens.
Une autre fonction importante du membre de la GRC intégré au COU a été de gérer les attentes de la collectivité à l’égard des capacités et des limites de la police; par exemple, il a fallu expliquer les processus pour obtenir les services de l’hélicoptère de la GRC et le fait qu’on ne pouvait pas obtenir ces services quelques minutes seulement après l’arrivée d’un renseignement ou durant certaines phases de l’arrestation. Cette communication s’est avérée cruciale pour le maintien de relations saines et fonctionnelles au COU.
Le type de communication avec les proches des victimes a varié selon le type d’information à transmettre. Lorsqu’il y avait des mises à jour au sujet de l’enquête ou des renseignements en temps réel à communiquer, les familles aimaient mieux, la plupart du temps, que cela vienne de la GRC. Pour le reste, cependant, elles préféraient recevoir de l’information du conseil de bande ou des chefs. De plus, une fois que les contacts initiaux ont été établis et que les mises à jour au sujet de l’enquête ont été données, la plupart des familles préféraient que l’on communique avec elles par messagerie texte plutôt que par des visites en personne ou des appels téléphoniques. Certains membres de l’équipe de liaison avec les familles croyaient fermement que la fréquence des communications et les moyens employés devaient être laissés à la discrétion de chaque famille. Les attentes concernant le soutien et la réception d’information variaient d’une famille à l’autre. Par exemple, l’équipe de liaison a été avisée que la famille d’une victime préférait recevoir, à un moment donné, son appui et son information de sources non policières de sa communauté.
Peu importe le niveau de soutien voulu et les moyens de communication privilégiés, l’équipe de liaison avec les familles a toujours essayé de témoigner du respect et de la considération aux proches et aux victimes, par exemple en les prévenant lorsque la GRC s’apprêtait à diffuser des communiqués, pour s’assurer qu’ils n’étaient pas pris au dépourvu.
Le rôle de la liaison avec les familles est aussi devenu utile pour l’enquête dans son ensemble. En raison de leurs contacts prolongés avec les proches des victimes, les agents de liaison recevaient régulièrement de l’information qui pouvait être traitée ou transmise à l’équipe d’enquêteurs en temps opportun. Ainsi, lorsqu’un membre de l’équipe de liaison a appris que des membres de la communauté songeaient à organiser une « chasse à l’homme » pour retrouver les suspects, on a été en mesure de dissuader le groupe et d’éviter ainsi les risques qu’aurait posés une telle initiative spontanée pour la sécurité publique et les efforts d’enquête déployés par la police.
TLa quantité de travail nécessaire pour tenir les familles informées le mieux possible sans compromettre l’enquête s’est avérée plus grande que prévu. On a fait appel aux Services de police autochtones (explications à venir), que l’on a chargés de faire parvenir de l’information à certaines familles, ce qui a allégé un peu la charge pour l’équipe de liaison avec les familles.
En raison de l’accent qui a été mis sur la NCJS tout au long de l’intervention, le fait qu’il y a également eu une victime à Weldon est presque passé sous silence. C’est en grande partie grâce au rôle d’agent de liaison avec les familles que l’on a pu éviter cette omission.
Mesures efficaces
Même s’il n’y avait pas de procédures opérationnelles ni de guides de la GRC pour orienter les fonctions de l’équipe de liaison avec les familles, la sergente St. Germaine et son équipe ont rapidement établi leur rôle et ont demandé l’aide de diverses ressources lorsqu’il le fallait. Elles sont devenues les principaux points de contact direct auprès des familles des victimes blessées ou décédées.
Depuis l’incident ayant fait un grand nombre de victimes dans la NCJS/à Weldon, la sergente St. Germaine a participé à l’atelier de l’Association canadienne des chefs de police sur la mise à l’essai d’un cadre canadien d’intervention auprès des victimes lors d’incidents faisant un grand nombre de victimes. Une réunion a été organisée au début de 2023 pour discuter officiellement avec l’OREC de la Division F (avec l’appui de l’Équipe de gestion du district et du GCM) de la création d’un cadre plus formel pour répondre à certaines préoccupations soulevées quant à l’intervention menée par suite de l’incident ayant fait un grand nombre de victimes dans la NCJS/à Weldon.
Rôle des Services de police autochtones
Avant d’examiner le rôle qu’ont joué les Services de police autochtones (SPA) durant l’intervention dans la NCJS, décrivons les services qu’ils fournissent et les objectifs qu’ils s’efforcent d’atteindre.
Services de police autochtones
Les SPA de la Division F s’efforcent d’offrir à tous les Autochtones de la Saskatchewan qui se trouvent sur le territoire de compétence de la GRC des services de police professionnels et respectueux de la culture. Le groupe compte sept membres, qui vont de l’inspecteur au caporal. Des membres des SPA d’autres divisions ont été déployés dans la NCJS, soit deux de la Division K et un de la Division J.
- Mission des Services de police autochtones
- La mission des SPA consiste à aider les employés à fournir aux Autochtones et aux communautés autochtones de la Saskatchewan des services de police professionnels, proactifs et respectueux de la culture. Grâce à l’orientation, l’éducation et la collaboration, les SPA contribuent à l’avancement de la réconciliation et œuvrent à l’amélioration des relations entre les Autochtones et la GRC.
- Mandat des Services de police autochtones
- Les SPA de la Division F travaillent avec tous les ordres de gouvernement, les dirigeants autochtones et les partenaires clés pour améliorer les relations entre la communauté et la GRC, afin de garantir des services de police adaptés sur le plan culturel.
Les SPA de Prince Albert ont assumé le rôle de liaison entre la GRC et le conseil de bande durant l’intervention dans la NCJS. Les SPA se sont intégrés très tôt au COU, et les membres ont indiqué que leur présence « sur le terrain » dans la NCJS le premier jour avait été essentielle pour fournir à la communauté une base pour le soutien, en particulier à un moment où la peur régnait parce que le suspect était encore en liberté. La présence des SPA a favorisé la communication régulière en personne avec les trois chefs et le Grand Conseil, ce qui a permis de donner des mises à jour sur la situation et de relayer les informations provenant du conseil de bande aux équipes d’enquête.
Les autres organismes représentés au COU étaient la Fédération des nations autochtones souveraines, Services aux Autochtones Canada et Santé publique et Santé mentale. Leurs gestionnaires y étaient pour discuter de l’intervention et des préoccupations en matière de sécurité. Le rôle des SPA dans ce contexte a été d’assurer la liaison entre la GRC et ces organismes et de représenter la GRC lors des séances d’information. La participation à ces séances d’information et la visibilité de la GRC au COU ont été importantes pour l’établissement et le maintien des relations entre la GRC et le conseil de bande. Cela a ouvert la voie à des communications honnêtes qui ont permis aux employés d’établir une relation de confiance tout en fournissant et en diffusant de l’information en temps opportun par l’intermédiaire des canaux appropriés de la GRC. Les membres des SPA ont travaillé directement avec le triangle de commandement du GCM afin d’obtenir toute l’information découlant de l’enquête pouvant être communiquée aux familles.
On a indiqué que le rôle des SPA avait été au centre de la relation qui s’est établie entre la NCJS et la GRC. La reconnaissance, par la direction de la Division F, du besoin de faire appel à des ressources des SPA d’autres divisions a été précieuse. Le rôle des SPA est devenu celui d’agent de liaison informel, ce qui leur a permis de créer de solides relations communautaires. Lors des entretiens avec des membres de la communauté, cette relation « informelle » a été mentionnée, et on a déclaré que « l’autorité de la GRC » n’avait pas été ce qui s’était retrouvé au premier plan dans les communications avec la communauté pendant l’incident, mais plutôt l’empathie. Le volet des SPA est devenu important lorsque la communauté a commencé à lui faire part de ses préoccupations quant à l’absence pressentie de ressources et de soutien de la part de la GRC une fois l’intervention terminée. Les SPA ont transmis ces préoccupations à l’équipe de liaison avec les familles, ce qui lui a permis de transmettre le message selon lequel elle resterait disponible et mobilisée même lorsque les autres membres de la GRC auraient quitté la NCJS.
Comme il a déjà été mentionné, un membre de la GRC de Melfort travaille en étroite collaboration avec la communauté de la NCJS, et il est très apprécié de celle-ci. Cette relation positive préexistante a grandement aidé les SPA à tenir leur rôle au sein du COU.
Cette bonne relation a été mentionnée durant plusieurs des entrevues menées auprès de membres de la collectivité au cours des dernières étapes du présent examen, où il a été souligné que la présence de membres de la GRC aux séances d’information du COU avait été à la fois utile et appréciée.
Les membres des SPA ont été régulièrement mobilisés auprès de la communauté et épaulés par le membre désigné de la GRC de Melfort. Cela dit, plusieurs membres de la communauté ont dit croire que les relations entre la GRC de Melfort et la NCJS pourraient encore être améliorées. Cette question a déjà été abordée dans la section Mesures tactiques et intervention lors de l’appel initial du présent rapport.
Durant toute l’intervention dans la NCJS/à Weldon, les SPA ont joué un rôle inestimable dans l’établissement et le maintien de la communication et l’échange d’information entre les enquêteurs et la NCJS. L’engagement et le soutien de la GRC envers les SPA sont importants pour garantir que les futures interventions en cas d’incident critique et la prestation de services soient aussi sûres et efficaces que possible.
Sensibilisation aux réalités culturelles
Comme la situation évoluait rapidement le matin du 4 septembre, les membres auraient pu négliger l’aspect culturel des répercussions globales de la tragédie sur la collectivité, ce qui aurait contribué à l’instauration de barrières et aurait nui à la confiance de la collectivité envers la police. Or, c’est tout le contraire qui s’est produit. De nombreux exemples ont été soulevés où les membres qui intervenaient ont déployé des efforts pour faire preuve d’empathie et démontrer une compréhension des besoins de la collectivité sur le plan culturel.
Cérémonies en lien avec les défunts
Les membres qui devaient se rendre sur les lieux des nombreux homicides devaient réaliser leurs fonctions de policier et assurer la protection des scènes de crime à des fins de continuité, tout en tenant compte des besoins de la collectivité et en appuyant la tenue de cérémonies culturelles en lien avec les défunts.
L’importance des cérémonies en lien avec les défunts est devenue évidente, et les membres de la GRC ont reconnu ce besoin et l’ont respecté. Comme il a déjà été mentionné, il est arrivé à plusieurs reprises qu’à l’arrivée des membres sur une scène de crime, des membres de la famille étaient rassemblés près du corps. Certains membres des équipes de liaison ne s’attendaient pas à voir cette coutume, mais l’importance de soutenir les pratiques culturelles touchant les personnes décédées a été immédiatement reconnue. Il était essentiel que les familles soient autorisées à réaliser des cérémonies culturelles, sans toutefois nuire à la protection des scènes de crime et des éléments de preuve avant le déplacement des dépouilles. Les familles se sont montrées très reconnaissantes de pouvoir réaliser diverses cérémonies culturelles importantes, y compris des cercles de prière et la purification par la fumée. Dans un cas, les membres de l’Équipe de liaison ont collaboré avec le Bureau du coroner pour interrompre le transport d’une victime décédée jusqu’à ce que la famille puisse voir le corps et réaliser une cérémonie culturelle.
La bande de la NCJS s’est chargée de sous-traiter les services pour le nettoyage des diverses scènes de crime et le processus de remise en état qui était requis avant que les propriétaires puissent retourner à leur demeure. Un agent de protection d’urgence (APU) des Services de protection et d’urgence de la Saskatchewan pour les Premières Nations était responsable de coordonner le processus et connaissait les pratiques culturelles qui étaient requises, comme la purification par la fumée des maisons avant le nettoyage et le brûlement de tout ce qui avait été souillé par du sang. Cette pratique n’était pas recommandée, étant donnée l’ampleur de la contamination par le sang, donc une solution de rechange a été convenue, soit de gratter les objets souillés de sang et de brûler les débris de sang ou de retirer les articles des maisons pour la purification par la fumée.
Un entrepreneur a été embauché pour réparer les dommages causés par le suspect, car de nombreuses portes ont été endommagées lors des attaques. Pendant les rencontres du Centre des opérations d’urgence (COU), l’APU a recommandé que les familles des victimes soient informées de l’état de leur demeure, afin d’éviter tout traumatisme à leur retour, lorsqu’ils verraient des murs et des tapis retirés ou réparés.
À plus grande échelle, pendant les premières journées et les semaines suivantes, divers membres de la GRC ont participé à des événements culturels dans la NCJS, notamment la purification par la fumée de maisons avec des Aînés de la collectivité avant le retour des victimes/familles, des funérailles, des cérémonies du calumet et des cérémonies de suerie. Un membre de la GRC a même amené des pierres durant une cérémonie de suerie, ce qui a été bien apprécié par les dirigeants de la bande. Les Services de police autochtones (SPA) ont organisé une cérémonie de suerie avec les commandants de la GRC, les agents du ministère de l’Environnement et de la Gestion des ressources de la Saskatchewan, les membres du Groupe des crimes majeurs et l’équipe de liaison avec les familles.
Tout au long de l’intervention, les SPA ont participé activement à des activités culturelles régulières et en ont également planifié. Des représentants des SPA ont pris part à des cérémonies du calumet, ce qui a permis un contact en personne avec les dirigeants de la bande et a offert une tribune pour répondre aux questions des membres de la collectivité, de manière quotidienne. Les mesures prises par l’équipe de liaison avec les familles et les SPA dans le but de reconnaître l’importance des cérémonies traditionnelles autochtones, tout en maintenant l’intégrité de l’enquête, ont été bien vues.
Rôle du Groupe des services aux victimes
Le Groupe des services aux victimes (GSV) offre un soutien diversifié, notamment des services immédiats aux victimes, comme un soutien en situation de crise, et des services à plus long terme, comme des conseils visant des procédures judiciaires. En plus de ces services, le Groupe fournit couramment d’autres types d’assistance : aiguiller les clients, fournir des renseignements sur le système de justice pénale, informer les victimes au sujet des déclarations des victimes et accompagner les victimes au tribunal.
Le GSV fournit un soutien, une assistance, des renseignements et des renvois avec compassion, en respectant la dignité et la vie privée des personnes aux prises avec les répercussions de la victimisation.
Les Services aux victimes en Saskatchewan sont financés par le ministère de la Justice de la Saskatchewan et régis par un conseil de la GRC. À la GRC, tous les programmes de services aux victimes sont administrés par un conseil d’administration local à but non lucratif. Ces conseils sont formés de représentants de la GRC et d’intervenants communautaires. Les détachements de la GRC fournissent des locaux qui comprennent un téléphone, un ordinateur et des fournitures de bureau. Les programmes sont pourvus de travailleurs de soutien bénévoles de la collectivité et gérés par des employés civils. Néanmoins, chaque GSV constitue une entité en soi et prend des décisions en fonction de ses propres évaluations. Les membres de la GRC peuvent fournir des renseignements pertinents au GSV, mais la décision de fournir une assistance revient entièrement au groupe.
Le groupe des services aux victimes de la région du Nord-Est (Northeast Regional Victim Services – groupe NERVS) est formé du personnel suivant : un coordonnateur à temps plein, un coordonnateur adjoint à temps plein, deux coordonnateurs adjoints à temps partiel, un adjoint administratif à temps partiel et 18 bénévoles. Le groupe NERVS couvre un grand secteur géographique qui comprend la NCJS et Weldon.
Le groupe NERVS dispose d’employés rémunérés qui sont en disponibilité de manière périodique. Ils ne reçoivent pas de stimulant pécuniaire en retour, mais le personnel peut accumuler les heures de disponibilités selon un taux d’une heure accumulée pour chaque période de 24 heures en disponibilité. En outre, ils accumulent une heure pour chaque heure travaillée lorsqu’ils sont appelés au travail. Cette entente de rémunération constitue la principale difficulté quant à la dotation et au maintien en poste des employés.
Les demandes de renvoi par la GRC au groupe NERVS sont habituellement faites par téléphone par un membre de la GRC qui cherche à obtenir des services aux victimes. Lorsqu’un client est aiguillé vers le groupe, le dossier est d’abord offert à un bénévole. Si aucun bénévole n’est disponible, l’un des employés rémunérés travaille directement au dossier du renvoi. Il a été souligné que le groupe NERVS entretenait déjà une bonne relation avec le Détachement de la GRC de Melfort; le détachement était considéré comme étant très favorable au GSV, et le groupe NERVS ressentait ce soutien.
Remarque
Le groupe NERVS était également intervenu dans le cadre de l’accident d’autobus des Broncos de Humboldt en 2018 et de la fusillade dans une école de La Loche survenue en 2016. Compte tenu de ses interventions antérieures, l’équipe disposait pleinement des compétences requises pour une intervention lors d’un incident faisant un grand nombre de victimes.
Intervention du groupe NERVS
Le 4 septembre, la coordonnatrice en disponibilité a été informée pour la première fois de ce qui se passait dans la NCJS lorsque l’hôpital de Melfort a communiqué avec elle au sujet de l’arrivée d’un certain nombre de victimes de la NCJS à l’hôpital. L’hôpital de Melfort ne compte aucun travailleur social médical au sein de son effectif, donc il demandait la présence du groupe NERVS pour combler cette lacune. À ce moment-là, la GRC n’avait pas encore communiqué avec le groupe NERVS.
La coordonnatrice a alors commencé à trouver des bénévoles au moyen d’un groupe de discussion, en demandant qu’ils se rendent à l’hôpital pour commencer à rencontrer les victimes qui avaient besoin de services. À ce moment-là, les efforts du GSV étaient concentrés sur les victimes à l’hôpital de Melfort, et les tâches principales étaient de déterminer qui avait besoin de soutien à cet endroit. On a communiqué avec des travailleurs sociaux médicaux à d’autres endroits (Saskatoon et Prince Albert) lorsque les patients ont été transférés hors de Melfort, afin d’assurer un soutien à leur arrivée.
Les communications avec les dirigeants de la NCJS et de Weldon ont commencé le premier jour. Pendant ces échanges, une liste des services de soutien et des ressources offerts par le groupe NERVS a été examinée et a fini par être acceptée. Le premier jour de l’incident, les membres de la NCJS qui habitaient dans les maisons maintenant considérées comme des scènes de crime avaient besoin d’être hébergés ailleurs, et d’autres membres ne voulaient tout simplement pas demeurer dans la collectivité. Le groupe NERVS a collaboré avec la NCJS, la Fédération des nations autochtones souveraines, le Grand conseil de Prince Albert et la Croix Rouge pour payer les frais d’hôtel pour les familles des victimes.
Le sergent d’état-major Simons de la GRC de Melfort a communiqué avec le groupe NERVS environ deux heures après avoir été informé de la situation par le personnel de l’hôpital. À ce moment-là, des bénévoles du groupe NERVS se trouvaient déjà à l’hôpital de Melfort pour offrir un soutien; leur rôle n’a pas changé après la conversation avec le sergent d’état-major Simons. Bien que la coordonnatrice ne détenait pas toute l’information quant à l’état d’avancement de l’enquête, il a été déterminé que les travailleurs du groupe NERVS n’allaient pas se rendre dans la NCJS, principalement en raison de préoccupations liées à la sécurité.
Le 5 septembre, le groupe NERVS s’est réuni en personne avec la sergente St. Germaine. Il y avait encore très peu d’information sur les victimes qui allaient avoir besoin de soutien. La liste des victimes qui leur a été transmise était incomplète et encore en train d’être compilée. Même s’il était évident pour les travailleurs du groupe NERVS que les personnes sur la liste étaient décédées, bien des renseignements n’étaient pas encore connus ou n’avaient pas été fournis aux Services aux victimes. De plus, il manquait de l’information pertinente dans certains dossiers de renvoi aux services aux victimes, y compris des numéros de téléphone valides. Le groupe NERVS a compris que la situation continuait d’évoluer et que d’autres renseignements pourraient être fournis. Toutefois, l’incapacité à aider la GRC à compiler l’information pertinente (explications à venir) a peut-être été le plus grand obstacle à la prestation d’une assistance.
Plus tard, la sergente St. Germaine a créé un document Excel contenant les coordonnées des victimes et des familles dans le but d’assurer un suivi des communications avec les familles et les membres désignés. Conjointement avec le Groupe de soutien aux victimes de la violence de masse (voir ci-dessous), le document a été développé et mis à jour et continue d’être une ressource inestimable pour les personnes faisant partie de l’équipe de soutien aux victimes.
Le GSV en Saskatchewan n’a pas accès à la base de données du SIRP, ce qui entraîne un écart considérable entre la GRC et les Services aux victimes quant à la capacité d’obtenir de l’information. L’incapacité de réaliser des recherches dans les bases de données dans le but d’obtenir des renseignements généraux, comme des coordonnées, a eu un effet paralysant pour le groupe, qui accorde une grande valeur à la capacité de communiquer rapidement avec les victimes. Le groupe NERVS est d’avis que la capacité de réaliser ces recherches aurait été avantageuse tant pour la GRC que pour le GSV local : la charge de travail de la GRC aurait pu être considérablement réduite, et le GSV local aurait pu avoir accès à l’information la plus à jour et opportune pour réaliser son travail.
Il semble que la limitation de l’accès au SIRP ne soit pas une politique mise en œuvre uniquement en Saskatchewan, mais qu’elle s’applique plutôt à l’échelle nationale. Depuis la mise en œuvre du SIRP à titre de Système de gestion des dossiers (SGD) privilégié à la GRC, l’accès des groupes des Services aux victimes a été retiré. Comparativement aux autres SGD utilisés par la GRC par le passé, notamment le Système de récupération de renseignements judiciaires (SRRJ), le SIRP comprend plusieurs champs d’information détaillés ainsi qu’un accès à divers rapports, dont certains qui contiennent des renseignements de nature sensible. Par conséquent, l’accès au SIRP a été limité, et a uniquement été accordé aux employés de la GRC. Pour des raisons évidentes, cela a été considéré comme un obstacle par les employés du GSV.
Le groupe NERVS a fini par recevoir des noms cernés par l’équipe de liaison avec les familles à des fins de suivi. Les travailleurs du groupe NERVS se sont rendus dans la NCJS pour rencontrer les victimes en personne. Toutefois, il ne restait plus beaucoup de membres dans la collectivité à ce moment-là, car le suspect était toujours en liberté et bien des gens avaient quitté leur demeure. Les visites à domicile ont donc été mises en suspens. Le groupe NERVS a fourni aux équipes de liaison de la GRC une liste des ressources disponibles que les membres pouvaient remettre aux victimes pendant la période où le groupe NERVS n’avait pas la permission de se rendre dans la NCJS. La GRC a fini par envoyer une liste plus complète des noms, et les travailleurs du groupe NERVS ont commencé à communiquer avec les victimes par téléphone pendant la soirée du 5 septembre.
Les appels se sont poursuivis, et à la fin de la journée du 6 septembre, le groupe NERVS avait reçu une liste des témoins (toute personne ayant été un témoin direct d’un incident ou ayant subi un traumatisme) de l’Équipe de liaison de la GRC. La liste des témoins a été répartie parmi les membres du personnel, qui ont appelé les témoins les 7 et 8 septembre.
En plus de communiquer avec les clients, le groupe NERVS a collaboré avec l’Équipe d’intervention en cas de crise de la NCJS pour faire appel à des services de counseling et obtenir de l’information sur les frais funéraires. À ce moment-ci, le groupe NERVS commençait à être surchargé. Les membres de ce petit groupe avaient travaillé pendant de longues heures, dans des situations exigeantes sur le plan émotif. Les dossiers des témoins qui ont été ouverts ont été répartis entre le groupe NERVS, le GSV de Prince Albert et le GSV de Saskatchewan Nord. Si des personnes ayant besoin de soutien étaient déplacées à d’autres endroits, par exemple à Saskatoon, on communiquait avec le GSV du nouvel emplacement pour assurer un soutien continu.
Le groupe NERVS a reconnu l’importance de fournir un soutien aux membres de la collectivité de Weldon et s’inquiétait de la possibilité que les organismes offrant du soutien à la NCJS ignorent que les mêmes besoins étaient présents à Weldon. Pour soutenir les amis et les familles des personnes décédées, des travailleurs du groupe NERVS se sont rendus à Weldon dans le cadre d’une séance d’information organisée pour la collectivité le 8 septembre. Ils ont recommandé que les maisons des victimes de Weldon soient nettoyées, et en fin de compte, le gouvernement fédéral a fourni un financement à cet effet. Une équipe de relève s’est rendue à Weldon à nouveau du 11 au 14 octobre.
Après que le suspect a été arrêté, le 7 septembre, le GSV a recommencé les visites à domicile dans la NCJS, à partir du 15 septembre. Ces visites étaient orientées en fonction des souhaits des clients. Pendant la semaine du 19 septembre, une équipe de relève est arrivée et a participé aux visites à domicile dans les collectivités de NCJS et de Weldon afin de distribuer une trousse de ressources concernant l’indemnisation des victimes. Dans la NCJS précisément, un membre de la collectivité locale a été désigné pour accompagner l’équipe de relève lors du porte-à-porte pour fournir ces ressources. Peu de temps après le début des efforts, le membre de la collectivité a mentionné qu’il estimait que tous les services et le soutien devraient provenir de la NCJS et non d’un organisme externe (comme le ministère de la Justice). En outre, selon certains membres de la collectivité, il y avait une certaine ambiguïté dans l’information fournie aux victimes concernant l’indemnisation, ce qui était susceptible de semer la confusion chez elles. Par conséquent, le 23 septembre, on a mis fin aux efforts de porte-à-porte et le GSV n’est pas retourné dans la NCJS. Les dirigeants de la NCJS n’avaient pas été mis au courant des préoccupations et ont communiqué avec le groupe NERVS pour discuter du malentendu. La relation entre le groupe NERVS et les dirigeants de la NCJS est demeurée intacte après cet échange, et le groupe NERVS continue d’intervenir auprès des victimes dans la NCJS sur demande.
Tout au long de l’intervention, le groupe NERVS était en communication avec le ministère de la Justice. Plus précisément, au fil des jours et à mesure que le nombre de renvois augmentait, les travailleurs du groupe NERVS devenaient surchargés et épuisés. En plus de fournir un soutien aux clients pour lesquels un dossier avait été créé, les travailleurs du groupe NERVS ont assisté à des funérailles, ont réalisé des visites à domicile et ont fourni du soutien au personnel et aux élèves d’une école, entre autres tâches. La coordonnatrice du groupe NERVS a communiqué avec le ministère de la Justice afin que des dispositions soient prises pour qu’une équipe de relève de travailleurs du GSV soutienne les efforts de ses équipes. Le ministère de la Justice a indiqué qu’une équipe de relève allait être créée, mais que l’ensemble de la coordination et de la logistique relèverait du groupe NERVS, ce qui n’a fait qu’augmenter leur charge de travail. Le ministère de la Justice aurait pu être un meilleur point de contact pour les dirigeants de la NCJS afin de clarifier le rôle de l’équipe de relève et d’atténuer le conflit. De plus, bien que le ministère ait dirigé la création de l’équipe de relève, le fait d’imposer la coordination et l’organisation au groupe principale des services aux victimes a augmenté considérablement sa charge de travail et son niveau de stress.
Certains membres de la GRC ont déclaré, durant leur entrevue, que pendant l’intervention, ils estimaient que les rôles fonctionnels des Services aux victimes de la GRC étaient limités. Des membres ne savaient pas s’il existait une base de données électronique ou un site Web des Services aux victimes qu’ils pouvaient fournir aux familles. Avant l’intervention, certains membres n’avaient aucune connaissance du soutien qui pouvait être fourni par les Services aux victimes, et ne faisaient qu’associer le GSV à la possibilité de fournir des services de counseling ou d’aiguillage. Depuis l’incident dans la NCJS, les membres en ont beaucoup appris au sujet des services offerts par le GSV.
Malgré la structure organisationnelle du groupe NERVS et le nombre de ressources qui devraient être assignées, dans les faits, environ cinq membres du groupe NERVS ont participé à l’intervention dans la NCJS. Lorsqu’on tient compte des familles des victimes décédées, des personnes blessées, des témoins et des membres de la collectivité, le nombre de dossiers s’élève à bien au-delà de 100. La charge de travail est devenue impossible à gérer, et les membres du groupe ne se portent pas bien. Les membres du groupe NERVS n’ont pas encore fait l’objet d’un compte rendu de l’incident et n’ont reçu aucune indemnisation pour des services de counseling, le cas échéant. L’intervention en cause a dépassé les capacités du groupe bien au-delà de ses limites.
Groupe de soutien aux victimes de la violence de masse (DG)
L’Association canadienne des chefs de police (ACCP) est composée de membres actifs et de membres honoraires de partout au Canada. Par l’entremise des chefs de police des organismes membres et d’autres cadres supérieurs de corps policiers, l’ACCP représente plus de 90 % de la communauté policière du Canada. L’ACCP s’emploie à soutenir et à promouvoir l’application efficace des lois et la protection de la population canadienne. L’ACCP exécute son mandat par les activités et projets spéciaux de divers comités et sous-comités. L’un de ces comités est le Comité sur le contre-terrorisme et la sécurité nationale, présidé par le commissaire adjoint Mark Flynn (commissaire adjoint Flynn). Le Groupe de travail national sur le soutien aux victimes du terrorisme et de la violence de masse (Groupe de soutien aux victimes de la violence de masse), dirigé par Susheel Gupta (M. Gupta), conseiller principal en matière d’opérations stratégiques à la Sécurité nationale de la GRC, est l’un des sous-comités associés à ce comité.
Étant donné les similitudes entre ce qui s’est déroulé dans la NCJS et le mandat du sous-comité susmentionné, le commissaire adjoint Flynn a communiqué avec M. Gupta pour obtenir du soutien pour les membres de la GRC sur le terrain en Saskatchewan.
M. Gupta a communiqué avec des collègues à la Division F le 4 septembre et a fini par être présenté à la sergente St. Germaine. De l’information concernant des pratiques exemplaires sur la liaison avec les familles et la gestion des cas graves a été transmise.
Une assistance de membres du sous-comité se trouvant en Alberta, en Colombie Britannique et en Ontario a été offerte. Ces membres se sont alors rendus en Saskatchewan pour prêter main-forte, par tous les moyens possibles. Lorsque la décision a été prise qu’une équipe du Groupe de soutien aux victimes de la violence de masse se rendrait en Saskatchewan, il a été convenu que les membres de l’équipe allaient assumer un rôle de consultation et qu’ils n’allaient pas diriger l’intervention. Lorsque les membres de l’équipe sont arrivés en Saskatchewan, leur mandat n’était initialement pas clair, mais l’est devenu peu de temps après. Cette courte période d’ambiguïté était attendue, car il s’agissait essentiellement d’une équipe ad hoc formée pour fournir tout soutien nécessaire, en fonction de l’expérience des membres.
Sur le terrain, certains membres étaient initialement sceptiques quant au rôle que jouait le Groupe de soutien aux victimes de la violence de masse, mais ils ont fini par estimer que cette équipe était utile. Des membres du Groupe se sont jumelés à des équipes de liaison avec les familles et se sont efforcés de répondre à tout besoin requis, par exemple, de contribuer au suivi des échanges avec les victimes et de l’attribution des dossiers. Comme susmentionné, le document Excel comprenait des précisions complexes qui n’auraient pas pu faire l’objet d’un suivi autrement et qui rendaient l’organisation des dossiers des victimes beaucoup plus efficace. Des membres du Groupe de soutien aux victimes de la violence de masse ont créé un document de planification à envoyer à l’équipe de liaison avec les familles qui contribuera également à la planification du soutien aux victimes à long terme.
M. Gupta et son équipe sont en train d’élaborer une proposition en matière de « déploiement rapide » propre aux modèles de soutien aux familles, aux victimes et aux agents de liaison avec les familles.
Renseignement disponible avant l’incident
Le présent rapport contient beaucoup d’information au sujet des antécédents criminels du suspect, de son comportement violent et des gestes qu’il a commis avant l’incident tragique du 4 septembre. En outre, il est bien connu que pendant l’incident du 4 septembre et les jours qui ont suivi, le suspect était en libération conditionnelle, en liberté et visé par un mandat d’arrestation non exécuté. Si l’on considère les faits tels qu’ils sont compilés dans le présent rapport, on pourrait être porté à croire que les incidents survenus dans la NCJS et à Weldon étaient plus prévisibles qu’ils ne l’étaient réellement. Si l’on cherche à comprendre ce qui est arrivé le 4 septembre, et même à comprendre pourquoi c’est arrivé, il faut néanmoins tenir compte de la complexité globale de la situation.
Le présent objectif vise à déterminer s’il existait du renseignement à l’égard du suspect et/ou des crimes commis le 4 septembre avant l’incident en cause et si ce renseignement était connu par la GRC. Dans le contexte de cet objectif, deux questions sous-jacentes ont été cernées à des fins d’examen :
- Avant l’incident, y a-t-il eu des occasions raisonnables où les forces de l’ordre auraient pu intervenir à l’égard du suspect?
- Y aurait-il eu un moyen de détecter des signes précurseurs?
Bien qu’il ait été déterminé qu’un compte rendu factuel du renseignement (sur le suspect et l’incident) disponible avant l’incident pourrait permettre de répondre à la première question, la portée de l’examen ne permet pas de répondre pleinement à la deuxième question. Pour répondre à la deuxième question, il serait nécessaire de réaliser une étude et une analyse exhaustives de l’ensemble des antécédents du suspect, ce qui nécessiterait potentiellement la participation de nombreux experts de divers domaines, à savoir les sciences du comportement, l’analyse prédictive, la criminologie, la psychiatrie, la santé mentale, la toxicomanie et les dépendances.
De plus, deux examens distincts sont en cours de réalisation et pourraient fournir des renseignements supplémentaires sur la question de savoir si l’incident aurait pu être prédit ou évité de quelque manière que ce soit. L’un des examens sera réalisé par le Service correctionnel du Canada (mentionné ci-dessus) et porte sur la libération d’office, la surveillance communautaire du suspect, ainsi que les décisions connexes de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
L’autre examen sera réalisé par le Groupe des sciences du comportement, Direction générale (GSCDG) de la GRC, qui a été chargé par le Groupe des crimes majeurs (GCM) de la Division F de réaliser une autopsie psychologique du suspect, qui comprend une analyse exhaustive de l’incident et des antécédents du suspect, en partie dans le but de répondre aux trois questions suivantes en lien avec l’incident du 4 septembre :
- Pourquoi l’incident s’est-il produit au moment où il s’est produit?
- Pourquoi ces victimes ont-elles été ciblées?
- Pourquoi le délinquant a-t-il commis les crimes de la manière dont il les a commis?
La date d’achèvement de l’autopsie psychologique et du rapport demeure inconnue.
Comme des enquêtes/examens supplémentaires seront réalisés, la portée de l’objectif a été limitée de façon à éviter le dédoublement du travail. Une fois terminés, les rapports du Service correctionnel du Canada et du GSCDG pourraient fournir des constatations et des recommandations supplémentaires en lien avec cet objectif et les deux questions sous-jacentes.
Antécédents criminels du suspect
De 1996 à 2022, le suspect a fait l’objet de plus de 160 incidents consignés découlant de dossiers de la GRC, du Service de police de Prince Albert, du Service de police de Saskatoon, du Service de police de Regina, du Détachement de la GRC de Kamloops, du Détachement de la GRC de Prince George et du Service de police de Delta. Bon nombre des incidents étaient liés à la violence.
Le suspect avait également un lourd dossier criminel qui comprenait des condamnations pour voies de fait (10 chefs), méfait de moins de 5 000 $ (6 chefs), défaut de se conformer à une décision, omission de comparaître (4 chefs), être illégalement en liberté (2 chefs), conduite dangereuse d’un véhicule à moteur, défaut de se conformer à un engagement (10 chefs), résistance à une arrestation (3 chefs), voies de fait contre un policier (2 chefs), manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis, agression armée (3 chefs), vol avec effraction, possession d’une substance inscrite à l’annexe II, défaut de se conformer à une ordonnance de probation (7 chefs), entrave au travail d’un agent de police, omission ou refus de se soumettre au prélèvement d’un échantillon, conduite avec facultés affaiblies, omission de se conformer à un engagement (3 chefs), voies de fait graves, profération de menaces (2 chefs) et vol qualifié.
Les condamnations les plus récentes étaient liées à trois dates distinctes de détermination de la peine, à savoir le 24 septembre 2018, le 23 janvier 2019 et le 13 mai 2019. Le total des peines combinées s’élevait à 4 ans, 4 mois et 19 jours. Les condamnations visaient les accusations suivantes : agression armée (3 chefs), vol qualifié, méfait (2 chefs), voies de fait contre un agent de police, menaces de destruction de bien, menaces de mort/lésions corporelles et voies de fait.
Il va sans dire que le suspect avait de lourds antécédents criminels et avait fait l’objet de nombreuses enquêtes policières, accusations et condamnations.
Dossiers du Service correctionnel du Canada et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada
Comme il a déjà été mentionné, le suspect était en libération d’office d’un établissement pénitentiaire, mais illégalement en liberté pour non-respect des conditions de sa libération lorsqu’il a commis les nombreux meurtres et les nombreuses agressions dans la NCJS et à Weldon le 4 septembre. À des fins de clarté, une définition du concept de libération d’office est fournie ci-dessous, ainsi qu’une explication de la façon dont un délinquant réintègre généralement la société.
Définition
Au Canada, la loi exige que les délinquants sous responsabilité fédérale condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée soient mis en liberté, sous surveillance, quand ils ont purgé les deux tiers de leur peine. C’est ce qu’on appelle la « libération d’office » .
La libération d’office est un type de libération conditionnelle puisque les délinquants sont surveillés dans la collectivité. La libération d’office ne met pas fin à la peine des délinquants. Elle permet plutôt aux délinquants de purger le reste de leur peine dans la collectivité. Ils doivent se présenter régulièrement à un agent de libération conditionnelle du Service correctionnel du Canada (SCC) et respecter des conditions particulières. La période de libération d’office permet aux délinquants de passer un certain temps sous surveillance dans la collectivité avant la fin de leur peine pour préparer leur retour dans la société à titre de citoyens respectueux des lois.
La Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) joue un rôle dans la libération d’office seulement si le SCC lui transmet un dossier à des fins d’examen. Son rôle se limite à ce qui suit :
- imposer des conditions à la mise en liberté;
- annuler une suspension de la mise en liberté d’office qui avait été ordonnée par le SCC, de sorte que le délinquant soit remis en liberté d’office;
- révoquer la libération d’office, de sorte que le délinquant soit réincarcéré;
- dans certaines circonstances, ordonner que le délinquant demeure sous la garde du SCC jusqu’à la fin de sa peine.
Conditions
Si un délinquant en liberté d’office ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées, il se peut que le SCC juge nécessaire de suspendre sa liberté et de le réincarcérer pour être en mesure de contrôler le risque qu’il présente. Le SCC examine alors le dossier et peut le soumettre à la CLCC. Celle-ci détermine s’il convient de laisser le délinquant en liberté d’office – en le soumettant aux mêmes conditions ou en lui en imposant de nouvelles – ou de révoquer la libération d’office. Il s’agit du processus par l’entremise duquel le suspect a reçu une libération d’office (explications à venir). Si la CLCC décide de révoquer une libération d’office, le délinquant demeure sous la garde du SCC jusqu’à ce qu’il ait purgé les deux tiers du reste de sa peine, à moins que la CLCC n’ordonne qu’il demeure incarcéré.
Processus d’examen
Le SCC peut renvoyer un dossier à la CLCC et recommander d’interdire la libération d’office du délinquant et l’incarcération jusqu’à la fin de la peine, si certains critères juridiques sont respectés. La CLCC peut ordonner qu’un délinquant soit maintenu en incarcération si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il commettra, avant l’expiration de sa peine, l’une des infractions suivantes :
- une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne;
- une infraction sexuelle à l’égard d’un enfant;
- une infraction grave en matière de drogue.
La CLCC réexamine annuellement les dossiers visés par une ordonnance de maintien en incarcération, jusqu’à la fin de la peine du délinquant ou jusqu’à ce qu’elle juge raisonnable d’annuler l’ordonnance et de permettre la libération d’office. Pour que l’ordonnance soit levée, la CLCC doit être convaincue que le délinquant ne répond plus aux critères applicables au maintien en incarcération. Dans toutes ses décisions, la CLCC tient compte d’abord et avant tout de la protection de la société.
Le SCC et la CLCC ont fourni des dossiers au Groupe des crimes majeurs dans le cadre de l’enquête criminelle sur l’incident du 4 septembre. Ces dossiers ont été examinés aux fins de l’objectif. L’ensemble des antécédents criminels du suspect n’est pas répété ci-dessous, mais les dates et les incidents liés aux condamnations les plus récentes qui ont mené à son incarcération; les décisions ayant mené à sa libération d’office; et les incidents ayant mené à la délivrance d’un mandat d’arrestation à son endroit pour manquement aux conditions de mise en liberté sont mis en lumière. Voici un résumé des incidents et des constatations pertinents pour l’objectif examiné :
January 25, 2015
Le suspect a poignardé [CAVIARDÉ] au moyen d’un couteau [CAVIARDÉ]. [CAVIARDÉ]. Le suspect a continué de les attaquer jusqu’à ce qu’il entende des sirènes. Il s’est alors enfui. Le suspect a été retrouvé peu de temps après et a plus tard été condamné d’une infraction moindre. Il a reçu une peine de deux ans.
[CAVIARDÉ]
27 juillet 2017
Alors qu’il était à un magasin dans la NCJS, le suspect a eu une dispute avec un employé, a tenté de le battre puis a menacé de le tuer et de brûler la maison de ses parents. La victime est retournée dans le magasin pour se protéger. La police n’a pas été en mesure de retrouver le suspect, donc des accusations ont été portées contre lui, et les enquêteurs ont obtenu un mandat d’arrestation.
30 novembre 2017
Le suspect et un complice ont cambriolé un restaurant-minute à Regina, armés d’une arme à feu. Le suspect aurait forcé le complice à participer à l’infraction en le frappant à la tête avec l’arme à feu utilisée pendant l’infraction et en lui piétinant la tête.
15 avril 2018
Pendant qu’il buvait de l’alcool dans une résidence dans la NCJS, le suspect s’est mis en colère et a commencé à attaquer des gens dans la résidence. Il a fini par poignarder deux hommes au moyen d’une fourchette. Après avoir agressé les deux hommes à l’intérieur de la maison, le suspect est sorti dehors et a attaqué une autre personne qui marchait dans le secteur. Il a battu cette personne jusqu’à ce qu’elle perde connaissance, dans un fossé. Le suspect est retourné à la résidence et a défoncé la porte à coups de pied. Le propriétaire de la maison a réussi à calmer le suspect; le suspect est parti avant l’arrivée de la police.
3 juin 2018
Des policiers du Détachement de la GRC de Melfort se sont rendus à la résidence de [CAVIARDÉ] dans la NCJS : ils cherchaient le suspect. [CAVIARDÉ] a indiqué qu’il n’était pas dans la résidence et qu’elle ne l’avait pas vu. On a ensuite vu le suspect s’échapper par une fenêtre à l’arrière de la résidence. Les policiers de la GRC l’ont mis en état d’arrestation, mais le suspect est retourné dans la maison. Les policiers de la GRC ont tenté d’inciter le suspect à sortir, mais ce dernier a refusé et ne cessait de répéter aux policiers qu’ils allaient devoir l’abattre. Le suspect a fini par sortir de la résidence et a été mis sous garde. Cependant, alors qu’il était menotté, il s’est jeté sur un policier et a dû être maîtrisé. Pendant la fouille du suspect, ce dernier est redevenu hostile et a tenté de s’éloigner des policiers. Au moment où les policiers tentaient de placer le suspect à l’arrière du véhicule de police, le suspect a donné plusieurs coups de pied à la tête d’un policier, jusqu’à ce que les policiers soient en mesure de le placer dans le véhicule.
24 septembre 2018
En ce qui concerne les incidents ci-dessus, le suspect a été reconnu coupable des accusations suivantes : agression armée (3 chefs), vol qualifié, méfait (2 chefs), voies de fait contre un agent de police, menace de destruction de biens, menace de mort/lésions corporelles et voies de fait. Il a reçu une peine de 4 ans, 4 mois et 19 jours. La date d’expiration de la mise en liberté sous condition était le 12 février 2023.
Février 2021
Pendant l’incarcération du suspect, sa cote de sécurité a été réduite au niveau minimum, et il a été transféré au Pavillon de ressourcement Willow Cree, située dans la Première Nation Okemasis, en Saskatchewan, à quelque 90 km au nord de Saskatoon.
11 février 2021
Une audience de la CLCC a été tenue à l’égard d’une décision d’accorder au suspect une semi-liberté et une libération conditionnelle totale. La décision était fondée sur la question de savoir si le suspect présentait un risque excessif pour la société avant l’expiration de sa peine. On s’est demandé si la mise en liberté contribuerait à la protection de la société, en facilitant la réinsertion sociale du délinquant à titre de citoyen respectueux des lois.
Selon la décision, le suspect représentait un risque élevé de récidive avec violence et la libération conditionnelle a été refusée à ce moment-là.
26 août 2021
Le suspect a reçu une libération d’office du Pavillon de ressourcement Willow Cree assortie de conditions de se présenter au Bureau de libération conditionnelle de Saskatoon et d’habiter avec son père, à Saskatoon.
3 novembre 2021
[CAVIARDÉ] a communiqué avec l’agent de libération conditionnelle du suspect et lui a dit [CAVIARDÉ] demeurait avec le suspect depuis octobre (2021). L’agent de libération conditionnelle a communiqué avec le suspect pour confirmer les dires de [CAVIARDÉ] et lui rappeler qu’il ne respectait pas la condition de signaler toute [CAVIARDÉ]. Un mandat d’arrestation et de suspension de la mise en liberté a été lancé. Le suspect s’est livré au Service de police de Saskatoon le même jour. Aucune nouvelle accusation n’a été portée.
17 novembre 2021
Comme suite à l’arrestation du suspect, l’agent de libération conditionnelle à Saskatoon a rempli une Évaluation en vue d’une décision dans laquelle il recommandait que la cote de sécurité du suspect passe d’un niveau faible à un niveau modéré. Le rapport comprenait diverses justifications pour le changement de la cote de sécurité, mais la plus grande préoccupation soulevée concernait [CAVIARDÉ].
29 novembre 2021
Le Bureau de libération conditionnelle de Saskatoon a rempli une autre Évaluation en vue d’une décision au sujet d’une recommandation de révocation de la libération d’office du suspect.
Compte tenu des circonstances énoncées dans le document, le risque dans la collectivité associé au suspect n’était plus gérable, et la révocation de sa libération a été recommandée. Si la libération d’office du suspect avait été révoquée à ce moment-là, la prochaine date de libération d’office n’aurait pas été avant septembre 2022, environ.
Des conditions spéciales ont été recommandées, au cas où la CLCC décidait de lever la suspension de la libération d’office du suspect.
1 février 2022
La CLCC a levé la suspension de la libération d’office du suspect avec un avertissement pour avoir omis de signaler sa [CAVIARDÉ] et ses conditions de logement. Il convient de noter que le SCC n’a pas recommandé la libération du suspect. Voici quelques extraits importants de la Décision de la CLCC, qui comptait 10 pages :
- Le risque de récidive du suspect a été évalué à l’aide d’outils actuariels (statistiques). Pour l’une des échelles, le suspect a obtenu une cote de risque moyen/élevé, et pour l’autre, il a été déterminé que le suspect présentait un risque élevé de récidive.
- On indique que pendant son incarcération, le suspect a participé aux programmes et aux activités culturelles et a échangé avec les Aînés. Il a obtenu des certificats d’emploi et a suivi des cours d’auto-assistance.
La CLCC en est arrivée aux conclusions suivantes :
[TRADUCTION]
La Commission (CLCC) est d’avis que le risque que vous représentez peut être géré dans la collectivité, si vous habitez avec votre père, arrêtez de consommer, conservez un emploi et continuez à mettre en place des mesures de soutien, notamment suivre une thérapie.
La Commission annule la suspension de votre libération d’office avec un avertissement : vous avez omis de communiquer ouvertement avec votre surveillant de liberté conditionnelle, ce qui a mené à la suspension de la libération d’office. Dorénavant, vous devez être honnête et ouvert avec votre surveillant de liberté conditionnelle.
La Commission estime que vous ne présentez pas un risque inacceptable pour la société si vous êtes libéré d’office et que votre libération contribuera à la protection de la société, car elle facilitera votre réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.
2 février 2022
Le suspect a été libéré du Pénitencier de la Saskatchewan. Il a communiqué avec le Centre national de surveillance pour confirmer qu’il était arrivé à la résidence approuvée, à Saskatoon. Le suspect devait rencontrer son agent de libération conditionnelle le jour suivant.
3 février 2022
Le suspect a rencontré son agent de libération conditionnelle. Ils ont discuté des circonstances entourant la suspension antérieure. Le suspect a nié tout manquement aux conditions qui avait mené à la suspension. Le suspect a parlé des difficultés qu’il avait eues, lors de son retour en prison. Il a également mentionné qu’il a fait une dépression nerveuse pendant l’incarcération, mais qu’il avait appris à se détacher de ses pensées d’automutilation et qu’il aspirait à une meilleure vie dans la collectivité.
11 février 2022
Le suspect a rencontré un agent de programmes correctionnels du Bureau des libérations conditionnelles de Saskatoon et a demandé que la restriction qui l’empêchait de communiquer avec sa famille soit levée. Le suspect estimait qu’il avait suivi suffisamment de programmes et qu’il avait appris à gérer ses émotions sans violence ou substance intoxicante. Il a mentionné que ses gestes l’ont amené dans le système correctionnel, mais qu’il avait appris sa leçon. Le suspect croyait que l’incident entre lui et [CAVIARDÉ], qui avait mené à la suspension, n’était qu’un différend ordinaire qui avait été exagéré. La condition n’a pas été levée à cette date.
21 février 2022
L’agent de libération conditionnelle du suspect a reçu des renseignements selon lesquels le suspect avait manqué à une ordonnance de non-communication avec son fils. Une conférence de cas a eu lieu et il a été décidé de maintenir la libération du suspect, au moyen d’une entrevue disciplinaire.
24 mai 2022
L’agent de libération conditionnelle a déterminé que le suspect se rendait, à nouveau, [CAVIARDÉ], en violation de ses conditions. La libération du suspect a été suspendue par le Bureau de libération conditionnelle et un mandat a été lancé par le Service de police de Saskatoon.
Remarque
Les dossiers des Services de police de Saskatoon n’ont pas été consultés, car ils dépassent la portée de l’examen. Une vérification dans la base de données du SIRP de la GRC a été réalisée, et il a été déterminé qu’aucun incident ou mise en garde/indicateur n’a été saisi dans le champ « sujet » du profil du suspect. Par ailleurs, aucun dossier n’a été trouvé pendant l’examen montrant que le Détachement de la GRC de Melfort avait reçu des avis concernant le mandat d’arrestation du suspect (parce qu’il se trouvait illégalement en liberté) avant la consignation au registre des interventions du 22 juillet 2022 (ci-dessous), saisie par un autre agent de libération conditionnelle.
26 mai 2022
Le suspect a été informé qu’un mandat d’arrestation contre lui avait été lancé et qu’il devait de rendre au service de police local.
1 juin 2022
Dans un échange avec son agent de libération conditionnelle, le suspect a fait part de ses difficultés à faire face, sur le plan émotionnel, au fait de se rendre à la police. Le suspect a dit qu’il tentait de trouver le courage pour se rendre et qu’il voulait appeler pour s’exprimer et dire à son agent de libération conditionnelle qu’il avait peur, mais qu’il n’était pas combatif. Le suspect a nié avoir pris des substances intoxicantes et a demandé à être incarcéré soit au Pavillon de ressourcement, soit dans un établissement à sécurité minimale.
22 juillet 2022
L’agent de libération conditionnelle du suspect a discuté avec le Détachement de la GRC de Melfort (aucun membre n’est précisé) au sujet du statut du délinquant illégalement en liberté. L’agent de libération conditionnelle a été informé que la dernière fois que la GRC de Melfort avait consigné un échange avec le suspect était avant son incarcération. On a informé l’agent de libération conditionnelle que des membres du quart de nuit du détachement iraient vérifier les résidences où l’on savait qu’il se rendait par le passé.
Aucun rapport connexe du Détachement de la GRC de Melfort lié à cet échange avec l’agent de libération du suspect n’a été trouvé dans le SIRP ni dans les dossiers d’enquête examinés jusqu’à présent.
Équipe d’exécution des mandats et de répression
La Division F dispose d’une Équipe d’exécution des mandats et de répression (EEMR) depuis avril 2022. Ce groupe réalise des activités d’application de la loi et des fonctions liées au renseignement dans le but de retrouver des fugitifs qui s’évadent d’un lieu de détention ou qui se trouvent illégalement en liberté en raison d’un manquement à des conditions de caution, de libération conditionnelle ou de peine discontinue, y compris les personnes visées par un mandat d’arrestation.
L’EEMR cible des délinquants notoires qui sont visés par des mandats non exécutés et qui représentent une menace importante pour la sécurité publique. L’équipe mise sur l’exécution de mandats à l’échelle de la province et est établie à Saskatoon et à Meadow Lake. L’EEMR de Saskatoon/Meadow Lake est formée de six employés (un sergent, un caporal et quatre gendarmes) qui ont tous été déployés dans le cadre de l’intervention dans la NCJS/à Weldon.
Rôle de l’EEMR dans le cadre de l’intervention dans la NCJS/à Weldon
Dès leur déploiement et leur arrivée dans la NCJS, les membres de l’EEMR ont initialement été chargés d’aider le Groupe des crimes majeurs (GCM) à obtenir des déclarations auprès des nombreuses personnes ayant été témoins des 11 homicides. Bien que ce type de fonction ne cadre pas avec la mission de l’équipe, une foule d’information devait encore être recueillie au sujet de l’incident et, jusqu’à ce qu’ils soient chargés de tâches liées à l’arrestation du suspect, les membres de l’EEMR ont fourni tout type d’aide requise.
Le jour suivant (le 5 septembre), l’EEMR a repris sa mission prioritaire et a entamé des efforts pour procéder à l’arrestation du suspect; ces efforts ont été maintenus jusqu’à la fin de l’intervention. L’EEMR était établie au poste de commandement du GCM à Prince Albert, avec l’équipe d’arrestation (décrite ci-dessus). La section de l’équipe d’arrestation incluant l’EEMR au poste de commandement comprenait les membres suivants : le chef d’équipe du GCM, le chef d’équipe de l’EEMR, un analyste de l’Équipe d’intervention en matière d’application de la loi de la Saskatchewan, un souscripteur d’affidavit et un coordonnateur des dossiers. Le chef d’équipe de l’EEMR a assuré la liaison avec le chef d’équipe du GCM pour l’équipe d’arrestation et a coordonné les ressources de l’EEMR et de l’Équipe de réduction de la criminalité (ERC) de North Battleford pour veiller à la coordination des efforts d’arrestation déployés par l’EEMR. L’EEMR et l’ERC travaillaient dans des lieux distincts, et c’est le chef d’équipe de l’EEMR qui les coordonnait et qui leur assignait des tâches en lien avec l’arrestation, sous la direction du chef de l’équipe d’arrestation du GCM (qui travaillait de concert avec le commandant des interventions critiques). Les efforts visant l’arrestation se sont poursuivis de cette manière jusqu’à la fin de l’intervention.
Depuis l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon
Depuis le début de l’examen, on a approuvé la création d’une EEMR supplémentaire à Prince Albert. Comme ce groupe est relativement nouveau, des efforts sont en cours dans le but d’affiner la méthodologie quant à la façon d’établir un ordre de priorité pour la sélection des délinquants et les mesures d’application de la loi. L’EEMR ne comprend pas d’analyste au sein de son effectif, mais elle reçoit un soutien en matière d’analyse des neuf analystes qui relèvent de l’Équipe d’intervention en matière d’application de la loi de la Saskatchewan.
[CAVIARDÉ]
L’établissement de priorités est essentiel, car il a été déterminé qu’en date du 7 octobre 2022, les données relatives aux mandats de la GRC non exécutés sont les suivantes :
Graphique 1 : Types d'infraction - mandats non exécutés de la GRC
| District | Violentes | Non-violentes |
|---|---|---|
| Nord | 600 | 1 480 |
| Centre | 367 | 2 004 |
| Sud | 318 | 1 395 |
| Total | 1 285 | 4 879 |
Le gestionnaire du renseignement à la Division F, Équipe d’intervention en matière d’application de la loi de la Saskatchewan (EIALS), reçoit la liste des délinquants illégalement en liberté qui est diffusée régulièrement par le SCC. Cette liste comprend l’organisme qui a porté les accusations, les adresses connexes et le service de police de compétence. Dans la mesure du possible, le gestionnaire du renseignement tente de déterminer s’il convient de diffuser des renseignements à un certain territoire de compétence de la GRC. Compte tenu du grand nombre de mandats non exécutés/délinquants illégalement en liberté, on ne diffuse pas à tous des renseignements pour chacun de ces délinquants.
Recommandations découlant d’examens d’incidents antérieurs ayant causé un grand nombre de victimes
Après avoir examiné le rapport MacNeil, un objectif similaire a été relevé à la Section 11 : Informations ou renseignements sur le tireur et possibilités de prévention. L’objectif comprenait les mêmes deux questions sous-jacentes (énoncées ci-dessus), ainsi que la recommandation suivante :
Les documents disponibles dans le cadre de l’examen ne mentionnaient aucune initiative propre à la GRC à laquelle le suspect aurait participé ou à laquelle il aurait eu accès.
Il a toutefois été souligné que la Division F avait récemment lancé des initiatives axées sur l’amélioration des services de police en lien avec la maladie mentale. À titre d’exemple, le 8 juin 2021, la GRC de la Saskatchewan a mis en poste deux membres de personnel infirmier psychiatrique à la STO pour aider les membres de la GRC en temps réel lors d’interventions en matière de santé mentale auprès de membres du public.
Bien que le suspect n’ait pas participé à des programmes/initiatives de la GRC, il a participé à plusieurs programmes pendant qu’il était sous la surveillance du SCC, notamment les suivants :
- En 2013, il a participé à un programme de six semaines du Métis Addictions Council of Saskatchewan. Il a également reçu des soins en consultation externe en 2015 et y a été hospitalisé en 2016;
- Pendant son incarcération :
- Le suspect a participé à des programmes et à des activités culturelles, a échangé avec les Aînés, a obtenu des certificats d’emploi et a suivi des cours d’auto-assistance;
- Il a suivi le Programme préparatoire pour Autochtones offert après l’évaluation initiale ainsi que le Programme multicibles d’intensité élevée pour Autochtones;
- Il a suivi le programme Wastew Pimatisiwin : Shining Life (programme sur le deuil).
En octobre 2021, après sa mise en liberté dans la collectivité, le suspect a commencé le Programme communautaire de maintien des acquis sur le Modèle de programme correctionnel intégré (MPCI), mais il n’a pas été en mesure de le terminer, car sa libération a été suspendue en novembre 2021. Selon les rapports au dossier, il a participé à six des séances du programme dans la collectivité, mais a omis de se présenter à quatre séances, avant la suspension.
Santé mentale, sécurité communautaire et initiatives à venir
Depuis le début de l’examen, un financement fédéral a été annoncé qui pourrait donner lieu à des initiatives qui sont conformes à l’esprit de cet objectif et offrir à la GRC des occasions de participation.
Le 28 novembre 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de 62,5 millions de dollars sur six ans pour favoriser la guérison, la santé mentale et le bien-être des membres de la communauté touchés par les événements tragiques du 4 septembre et pour soutenir les approches de sécurité communautaire dirigées par les Autochtones.
Le Communiqué publié par le cabinet du premier ministre comprenait les renseignements suivants :
- 42,5 millions de dollars pour favoriser la guérison et le bien-être mental, notamment grâce à la construction d’un nouveau centre de mieux-être dans la communauté et au réaménagement du pavillon Sakwatamo. Il permettra également à la NCJS d’élaborer et de concevoir des programmes qui répondent mieux aux besoins de ses membres, notamment en améliorant l’accès aux services de santé mentale, de traumatologie et de toxicomanie;
- 20 millions de dollars sur quatre ans pour renforcer l’initiative Voies vers des communautés autochtones sûres, par l’entremise de laquelle la NCJS et d’autres communautés pourront élaborer et mettre en place des projets communautaires axés sur la sécurité et le mieux-être;
- plus de 300 000 $ pour répondre aux besoins en santé mentale particuliers des enfants de l’école de la NCJS;
- Le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Saskatchewan et le Grand conseil de Prince Albert ont annoncé en octobre un partenariat visant à améliorer la sécurité publique et les services de police dans les 12 Premières Nations membres et les 28 communautés. Cette équipe fera progresser les initiatives de sécurité publique dirigées par les Autochtones et adaptées aux besoins de chaque communauté.
Sommaire
Un incident ayant fait un grand nombre de victimes comme celui-ci a des répercussions durables sur la collectivité touchée, peu importe sa taille. Dans le cas de la NCJS et de Weldon, les répercussions sont amplifiées par le fait que les populations sont très petites. L’incident qui s’est produit le 4 septembre a touché des collectivités entières. Tous les membres des collectivités de la NCJS et de Weldon connaissaient les victimes ou avaient des liens avec elles et sont rappelés au quotidien de la tragédie. Le mal qui a été fait perdurera pendant des générations.
Le sentiment de reconnaissance à l’égard des citoyens de la NCJS et de Weldon a été souligné tout au long de l’examen. Les membres des collectivités de la NCJS et de Weldon ont pris des mesures importantes dès le début de l’incident du 4 septembre, ont collaboré avec la GRC pendant les jours qui ont suivi, ont contribué au suivi auprès des victimes et se sont mis à la disposition de la GRC pour des entrevues : leur résilience a été remarquable. L’incident du 4 septembre a mis en lumière les menaces réelles auxquelles les collectivités et les services de police à l’échelle du Canada sont confrontés au quotidien, ainsi que la nécessité de travailler ensemble pour favoriser la sécurité publique.
Nous espérons que par la réalisation de l’examen, la détermination de leçons apprises et la formulation de recommandations pour l’avenir, nous pourrons fournir des renseignements pertinents et favoriser un changement positif à la GRC et dans d’autres services de police municipaux à l’échelle du Canada.
Résumé des recommandations
| Recommandation | Responsabilité |
|---|---|
| Intervention initiale | |
| 1.1 – Envisager la formulation d’une orientation stratégique et/ou d’une formation à l’échelle divisionnaire et/ou nationale sur la question de l’intervention à une ou à deux personnes par véhicule de patrouille. Y inclure une discussion sur les risques que pose la séparation des ressources lorsqu’il n’y a que deux membres pour intervenir. L’orientation stratégique et/ou la formation ne devraient pas être contraignantes, mais plutôt être formulées de manière à aider les membres à mieux soupeser les risques et à prendre les décisions les plus efficaces en conséquence. | Division et DG |
| 1.2 – Le chef du Détachement devrait encourager tous les membres du Détachement à se rendre dans la NCJS, que ce soit pour effectuer des patrouilles ou encore pour participer à des activités, afin de tisser des liens avec la communauté. | Détachement |
| Structure de commandement | |
| 2.1 – Envisager la possibilité de diviser les ressources du poste de commandement mobile afin que de l’équipement soit disponible pour le déploiement dans les régions plus au nord. | Division |
| 2.2 – Lors d’incidents de grande envergure, il est essentiel que le commandant des interventions critiques soit au poste de commandement d’incident en personne ou qu’il y soit connecté au moyen de la technologie pour faire en sorte que tous les commandants aient une pleine connaissance de la situation. | Division et DG |
| 2.3 – À l’avenir, lors d’un incident de grande envergure, envisager d’installer le poste de commandement d’incident près des lieux de l’incident dans le but d’atténuer une partie des lacunes en matière de communication. Par contre, si le commandant décide que le poste de commandement d’incident devrait se trouver au Centre divisionnaire des opérations d’urgence, annoncer cette décision clairement. | Division et DG |
| 2.4 – Envisager de créer, pour la Division, un protocole sur les « crimes en cours » comprenant un organigramme des rôles à remplir obligatoirement lors d’un incident de grande envergure. Un tel protocole favoriserait la mise en place d’une structure organisationnelle dès le début de l’intervention. Cette structure préciserait les rôles et les voies hiérarchiques entre le Centre divisionnaire des opérations d’urgence, le commandant des interventions critiques, le Groupe des crimes majeurs, etc. | Division et DG |
| 2.5 – S’engager à mettre en œuvre un système de commandement d’incidents majeurs pour la Division et donner suite à cet engagement. Communiquer avec des homologues d’autres divisions pour étudier leurs systèmes normalisés. Explorer la possibilité d’offrir une formation appropriée à tous les niveaux de l’organisation. Faire participer le Groupe de la préparation et des interventions opérationnelles national dans le processus pour assurer la plus grande cohérence possible dans la mise en œuvre. | Division et DG |
| 2.6 – Examiner des options pour moderniser le Centre divisionnaire des opérations d’urgence (CDOU). Envisager la réorganisation ou le déménagement du CDOU, y compris l’investissement dans la technologie et l’infrastructure. | Division |
| 2.7 – Dresser une liste des préposés au registre des communications de la Division et de leurs gestionnaires; explorer la possibilité de créer un programme de préposés au registre qui assurerait l’affectation automatique d’un préposé au registre lorsqu’un commandant des interventions critiques est appelé à intervenir. | Division |
| 2.8 – Lors d’une intervention qui pourrait durer longtemps par suite d’un incident majeur, envisager de demander la venue immédiate d’une ressource de la Direction générale (DG) sur les lieux afin d’assumer un rôle de liaison entre la DG et la Division. | Division et DG |
| 2.9 – Continuer à investir dans un logiciel d’établissement d’un mode opératoire commun. Poursuivre les efforts en vue de déployer l’outil ATAK ou tout autre type de système permettant de faire le suivi des ressources et offrir une formation sur son utilisation. S’assurer de tenir compte du Centre divisionnaire des opérations d’urgence lors de toute mise à niveau de la technologie. | Division |
| Service de l’air | |
| 3.1 – Pour tout incident majeur nécessitant des ressources aériennes, dépêcher immédiatement un coordonnateur des vols de la Division ou un chef des opérations aériennes au poste de commandement d’incident pour travailler aux côtés du commandant des interventions. | Division et DG |
| 3.2 – Les membres du Service de l’air de la Division F et du Programme des incidents critiques devraient participer ensemble à au moins deux entraînements par année (un de jour et un de nuit) pour permettre aux membres du Groupe tactique d’intervention de maintenir leurs acquis et veiller à ce que chaque groupe connaisse les forces et les faiblesses de l’autre. | Division et DG |
| 3.3 – Résoudre les problèmes d’interopérabilité des systèmes de communication et de GPS du Service de l’air afin qu’ils puissent fonctionner de manière harmonieuse avec les systèmes de communication et l’équipement du GTI (l’outil ATAK). | Division et DG |
| Intervention du Groupe de crimes majeurs | |
| 4.1 – Explorer la possibilité d’affecter au triangle de commandement un préposé au registre qui consignera les décisions prises et le contenu découlant des séances d’information. | Division |
| 4.2 – Évaluer la faisabilité d’intégrer un soutien analytique aux équipes du Groupe des crimes majeurs comme procédure normalisée lors de tout incident majeur. | Division |
| 4.3 – Envisager la création d’une trousse logistique pour le Groupe des crimes majeurs afin d’accélérer son installation sur les lieux lorsqu’il est appelé à intervenir. | Division |
| 4.4 – Explorer la possibilité d’avoir recours à des ressources civiles pour appuyer le traitement de grandes quantités de pièces à conviction. Désigner une personne qui restera en permanence dans la salle des pièces pour recevoir les pièces à conviction. | Division |
| 4.5 – Explorer la possibilité, pour les Services nationaux de laboratoire judiciaire d’offrir des exposés au Groupe des crimes majeurs portant sur leurs capacités, plus particulièrement en ce qui concerne les incidents faisant un grand nombre de victimes, afin de servir de fondement aux discussions entre les deux groupes. | Division |
| 4.6 – Envisager d’équiper le Service de l’identité judiciaire de tentes gonflables ou de murs en tissu pour protéger les éléments de preuve et la dignité des personnes décédées pendant le traitement des lieux d’un incident. | Division |
| 4.7 – Envisager de rendre le cours Initiation à la morphologie des taches de sang obligatoire pour tous les membres du Service de l’identité judiciaire. | Division et DG |
| 4.8 – Le Service de l’identité judiciaire devrait explorer la possibilité, à l’échelle nationale, de faire évoluer vers le secteur civil certains postes d’analyste de la morphologie des taches de sang, afin d’alléger les contraintes qui pèsent sur les ressources. | DG |
| Communications stratégiques | |
| 5.1 – La Division F devrait soutenir toute mise à jour éventuelle du système qui pourrait en améliorer l’efficacité et continuer à chercher des méthodes pour simplifier le processus de saisie de données dans le système ADNA. | Division |
| Communications opérationnelles | |
| 6.1 – Si la question n’est pas abordée dans le cadre d’une formation officielle, le problème potentiel de rester au téléphone plus longtemps que nécessaire lors d’une situation émergente où la STO reçoit un grand nombre d’appels devrait être soulevé lors de toute séance d’information ou de formation « à l’interne ». | Division et DG |
| 6.2 – Au minimum, dans le cadre d’un incident majeur où la STO reçoit un nombre d’appels accru, affecter un enquêteur du GCM, un analyste et un superviseur de la STO à la supervision et à l’analyse des appels entrants en temps réel, dans le but de dégager les tendances, les habitudes ou les grappes d’appels qui ne pourraient pas autrement être cernés de façon isolée. | Division et DG |
| 6.3 – Continuer à collaborer avec la province de la Saskatchewan et le Conseil de bande de la NCJS pour combler les lacunes en matière de communications radio. | Division |
| 6.4 – Mettre à niveau le système CIIDS de manière à inclure un système de cartographie et une capacité de transmettre des renseignements essentiels, comme le périmètre et des données de localisation. | Division et DG |
| Intervention visant un grand nombre de victimes | |
| 7.1 – Promouvoir la communication directe entre l’agent de liaison avec les familles et l’agent de liaison avec les médias (ou par l’intermédiaire du triangle de commandement du GCM) afin que l’on puisse prendre en considération l’impact des activités médiatiques prévues sur les divers groupes d’enquête, y compris sur les équipes de liaison avec les familles. | Division et DG |
| 7.2 – Envisager d’offrir de la formation additionnelle à des membres choisis et/ou aux superviseurs dans le domaine des incidents faisant un grand nombre de victimes. Cette formation devrait entre autres porter sur les structures de déploiement/structures hiérarchiques recommandées, les processus de documentation et le rôle de liaison avec les familles lors d’incidents de ce type. | Division et DG |
| 7.3 – En tirant parti de l’expérience acquise dans le cadre de l’intervention en cause, songer à créer un document-cadre devant être diffusé à l’échelle divisionnaire qui décrit les considérations culturelles dont il faut tenir compte pour fournir un soutien adéquat aux familles des victimes. | Division et DG |
| 7.4 – Compte tenu de l’expérience acquise comme suite à l’intervention en cause, songer à créer une « trousse de soutien aux victimes » à l’échelle nationale pour les victimes d’incidents faisant un grand nombre de blessés ou de décès. Cette trousse pourrait inclure des documents d’orientation, des dépliants imprimés au sujet des services aux victimes (dans plusieurs langues) et des liens de renvois vers des programmes. Ces trousses pourraient être conservées en format électronique et/ou préparées au préalable par le district ou la division. | Division et DG |
| 7.5 – Les employés des Services aux victimes devraient bénéficier d’un accès aux séances de verbalisation suivant un incident critique et aux programmes de mieux-être, en reconnaissance des principaux rôles fonctionnels qu’ils jouent de manière continue à la suite d’incidents faisant un grand nombre de victimes. | Division et DG |
| 7.6 – Poursuivre les travaux du Comité sur le contre-terrorisme et la sécurité nationale de l’ACCP aux fins de la création d’une politique nationale sur les rôles, les responsabilités et les pratiques exemplaires pour les équipes du Groupe de soutien aux victimes de la violence de masse. Tenir compte du fait que tout plan et processus créé pour des incidents d’origine humaine faisant un grand nombre de victimes s’appliquera, du moins en partie, à tous les types d’incidents (temps violent, incendie, incident de santé publique, etc.). | DG |
| Renseignement disponible avant l’incident | |
| 8.1 – Il est recommandé que les constatations découlant du rapport du Comité mixte d’enquête national (CMEN) du Service correctionnel du Canada et de la CLCC soient examinées par la GRC une fois disponibles. Les constatations du CMEN pourraient fournir des renseignements supplémentaires précieux qui sont pertinents pour le « renseignement disponible avant l’incident ». | Division et DG |
| 8.2 – Il est recommandé que les constatations et le rapport du Groupe des sciences du comportement de la Direction générale soient examinés une fois disponibles et potentiellement intégrés à l’examen du BNPE en lien avec cet objectif ou tout autre objectif pertinent. | Division et DG |
| 8.3 – Il est recommandé que la GRC continue à soutenir les initiatives proposées en matière de sécurité communautaire et de santé mentale et à y participer, dans la mesure du possible, ainsi que toute autre initiative connexe lancée dans la foulée de l’incident survenu dans les collectivités de la NCJS et de Weldon. | Division |
Sommaire des pratiques exemplaires
TLa présente section ne comprend pas une liste exhaustive des pratiques exemplaires démontrées dans le cadre l’intervention de la GRC lors de l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon. Le corps du présent rapport comprend de nombreux exemples où des intervenants (policiers et membres civils) ont réalisé leurs fonctions de manière exemplaire : ces exemples ne sont pas tous énumérés ci-dessous. Le sommaire des pratiques exemplaires n’a pas pour objet de minimiser ces efforts, mais vise plutôt à mettre en lumière des exemples précis qui pourraient être mis en pratique d’une manière plus générale.
- Structure de commandement – Groupe des SSOM
- Disposer d’une liste de numéros d’urgence pour communiquer directement avec les représentants de divers groupes et organismes, notamment tôt le matin lorsque ces personnes ne sont pas encore au travail ou qu’il est difficile de les joindre à leur numéro habituel.
- Structure de commandement – Agent de service et officier responsable des enquêtes criminelles
- La Division F dispose d’un programme d’agents de service en disponibilité dans le cadre duquel des officiers brevetés font l’objet d’une rotation selon un calendrier visant à couvrir tout problème ou incident d’importance. La Division F tient une « matrice de l’agent de service » à l’intention des SSOM qui définit le seuil à partir duquel il faut aviser l’agent de service.
- Structure de commandement – Centre divisionnaire des opérations d’urgence
- Même si tous les rôles du CDOU n’ont pas servi, on a jugé nécessaire de les planifier. En prévision d’incidents futurs, explorer des options de mise en disponibilité, créer une liste d’employés de la Division disponibles sur appel pouvant remplir les divers rôles, et/ou offrir une formation appropriée pour continuer de favoriser l’efficacité de la dotation pour répondre à ce besoin de ressources.
- Structure de commandement – Soutien du CIC
- Même si cela n’était pas obligatoire, les commandants des interventions critiques appelés à intervenir lors du présent incident avaient leurs radios et leurs ordinateurs portables chez eux, ce qui leur a permis d’avoir une connaissance optimale de la situation lorsque le commandement leur a été transféré.
- Pour contribuer au déploiement efficace du PC du GTI, le groupe de soutien en cas d’incident critique de la Division F est en disponibilité par roulement et relève du CIC.
- Intervention du Groupe des crimes majeurs – Intervention initiale du Groupe des crimes majeurs et attribution des tâches
- Étant donné la nature de ce qui se passait dans la NCJS/à Weldon, des postes supplémentaires de « chef d’équipe » ont été créés en temps réel pour déléguer les rôles essentiels en matière d’enquête qui étaient attendus, compte tenu des circonstances.
- Dès que possible, étant donné l’envergure et la portée de l’enquête, on a cerné les rôles de chef/responsable essentiels et désigné des enquêteurs compétents pour les assumer. La création de ces rôles a permis de favoriser la circulation de l’information et de mieux cibler les tâches.
- Intervention du Groupe des crimes majeurs – Intervention du Service de l’identité judiciaire
- Le fait d’avoir une ressource du SIJ au bureau permet une intervention immédiate lorsque survient une situation d’urgence.
- Être conscient de la possibilité de devoir faire un autre déploiement et de la nécessité de garder des ressources en disponibilité pour ce faire.
- Avoir recours à des groupes d’appui et à des ressources provinciales pour sécuriser les lieux.
- Fournir au minimum des mises à jour quotidiennes régulières et impromptues à la Direction générale lors d’incident majeur.
- Communications stratégiques
- La STO a informé les membres de la GRC de l’alerte publique avant sa diffusion, dans l’éventualité où des membres se trouvaient dans une position où leur sécurité pouvait être compromise (p. ex. s’ils se cachaient ou s’ils s’apprêtaient à aborder un suspect).
- Réalisation d’essais réguliers avec des cadres supérieurs chargés de la diffusion d’alertes publiques, conformément aux politiques de la GRC.
- Un employé désigné du Groupe des relations avec les médias a été chargé de répondre aux appels reçus sur la ligne téléphonique destinée aux médias et d’assurer un suivi des appels des médias. Cette pratique a donné aux journalistes la possibilité de parler avec un être humain, pendant toute la durée de l’intervention, au lieu d’avoir à écouter un enregistrement.
- La commandante divisionnaire s’est chargée des fonctions liées aux médias et disposait d’une stratégie en matière de médias bien planifiée.
- Les demandes d’entrevue des médias locaux ont eu préséance sur celles des médias non régionaux ou internationaux.
- Établir des liens avec les responsables des relations avec les médias de divers organismes municipaux, dans l’éventualité où une collaboration s’avérerait nécessaire.
- Assurer une liaison continue avec des homologues municipaux et ceux d’autres divisions afin d’accélérer le recours à des ressources de soutien en cas de besoin critique.
- Communications opérationnelles
- Même lorsqu’il y a eu une augmentation importante du nombre d’appels reçus, et même si la durée des appels aurait pu être réduite dans les circonstances, les téléphonistes et les répartiteurs de la STO ont continué à prendre les plaintes et à transmettre les appels de service aux secteurs de responsabilité appropriés (p. ex. les détachements compétents).
- Un opérateur chargé expressément de gérer les appels concernant la NCJS a rapidement été désigné; les autres opérateurs de la STO étaient chargés des autres appels non connexes dans leur zone de responsabilité géographique.
- Intervention visant un grand nombre de victimes
- Le chef d’équipe devrait veiller à attribuer le plus tôt possible durant une intervention le rôle fonctionnel de liaison avec les familles/les proches des victimes décédées.
- Le nombre de membres de la famille attribués à chaque agent de liaison avec les familles doit être aussi petit que possible, et il faut accorder une attention particulière aux rôles qui nécessitent plus de temps et de délicatesse.
- Les responsables/superviseurs de l’équipe de liaison avec les familles devraient se trouver dans les mêmes locaux que le triangle de commandement ou l’équipe d’enquête pour favoriser la communication entre tous.
- Demander le soutien de ressources des SPA de l’extérieur de la Division pour renforcer la capacité dans le domaine des services de police autochtones et intégrer dans le COU une représentation appropriée sur le plan culturel pour assurer une ligne de communication directe entre le conseil de bande et la GRC.
- La consignation et le suivi numériques des victimes décédées et blessées, des coordonnées des plus proches parents ou des membres de la famille et des liens sont essentiels. Il est recommandé d’utiliser un document numérique pour faciliter la mise à jour et l’échange entre les enquêteurs, les agents de liaison avec les familles et les Services aux victimes.
Annexe A – Lettre de mandat
À : Surint. pr. Kevin Kunetzki,
Officier responsable en second des enquêtes criminelles,
Division K
De : Comm. adj. Rhonda Blackmore,
Commandante,
Division F
Objet : Examen dirigé – Incident ayant fait un grand nombre de victimes dans la Nation crie de James Smith/à Weldon
Le dimanche 4 septembre 2022, à 5 h 40, des membres du Détachement de la GRC de Melfort sont intervenus après avoir reçu de nombreux signalements concernant des agressions au couteau survenues à plusieurs endroits dans la Nation crie de James Smith. Myles Sanderson et Damien Sanderson ont été identifiés comme les suspects dans ces agressions, ce qui a mené à la diffusion de plusieurs alertes d’urgence. Le commandement des interventions critiques (CIC) et le Groupe tactique d’intervention (GTI) ont été activés, et une chasse à l’homme à l’échelle de la province a été déclenchée. L’intervention s’est terminée par la découverte de la dépouille de Damien Sanderson et, plus tard, par l’arrestation de Myles Sanderson, près de Rosthern (Saskatchewan), le 7 septembre. Peu de temps après l’arrestation, Myles Sanderson a éprouvé des problèmes médicaux et en est décédé.
Conformément au chapitre 26.100 du Manuel d’administration de la Division F (Vérification interne), je vous demande de réaliser un examen dirigé portant sur les éléments précisés ci-dessous en lien avec l’intervention et, le cas échéant, de formuler des recommandations à l’échelle divisionnaire et nationale.
Outre les autres éléments que vous souhaitez examiner et pour lesquels il convient de formuler des recommandations, je vous demande expressément de vous pencher sur les éléments ci-dessous dans le cadre de l’examen :
- Mesures tactiques et intervention comme suite à l’appel initial du 4 septembre 2022
- Est-ce que la manière dont les membres ont été dépêchés sur les lieux et coordonnés dans le cadre de l’intervention soulève des améliorations éventuelles à apporter à la formation ou aux politiques de la GRC ou ailleurs?
- Est-ce que la structure du commandement des interventions critiques avait été clairement établie? Le commandant des interventions était-il en mesure de traiter l’information critique en temps opportun tout au long de l’incident? Y a-t-il eu suffisamment de séances d’information/comptes rendus entre les commandants des interventions entrant et sortant?
- Supervision pendant toute la durée de l’incident. Est-ce que la façon dont l’incident a été supervisé soulève des améliorations éventuelles à apporter, notamment en ce qui concerne les aspects suivants?
- supervision locale;
- agent de service;
- haute direction.
- Groupe tactique d’intervention (GTI)
- Comment l’intervention coordonnée/du GTI en évolution a-t-elle été gérée?
- Examen du Rapport après action du GTI :
- Est-ce qu’un rapport du GTI plus détaillé serait requis pour les incidents majeurs, au lieu du formulaire 1225 (bilan du GTI), qui constitue un modèle simple de phrases à compléter? Y a-t-il une occasion à saisir ici pour l’élaboration d’un cadre pour les incidents majeurs et les incidents faisant un grand nombre de victimes qui nécessitent des renseignements plus détaillés que ce qui peut être consigné dans le formulaire 1225?
- Équipement et armes
- Quel était l’état de disponibilité de l’équipement et des options de recours à la force approuvés par la Gendarmerie qui ont été utilisés?
- Quel autre équipement ou quelles autres armes auraient été utiles?
- Disponibilité de l’équipement spécialisé et de groupes spécialisés
- Examiner la disponibilité des ressources spécialisées de la Division F.
- Examiner la capacité d’acquérir des services supplémentaires d’autres divisions, par exemple le Service de l’air, le Groupe des applications spécialisées, le Groupe tactique d’intervention, les Opérations tactiques spéciales, les Services aux victimes et les Services généraux.
- Outre la disponibilité, les groupes spécialisés disposaient-ils d’une technologie adéquate/à jour?
- Gestion des scènes de crime
- Est-ce que les ressources du Service de l’identité judiciaire (SIJ) étaient adéquates?
- Comment les ressources du SIJ ont-elles été coordonnées pour veiller à ce que toutes les scènes de crime puissent être examinées de manière opportune et exhaustive?
- Quels efforts ont été déployés pour protéger tous les éléments de preuve des scènes de crime extérieures, pour éviter toute perte attribuable aux conditions météorologiques?
- Est-ce que les corps ont été retirés des lieux le plus rapidement possible, de manière à ce qu’ils ne demeurent pas sur les scènes de crime, surtout les scènes extérieures?
- Quels efforts ont été déployés pour veiller à ce que chaque scène de crime et victime soit retrouvée le plus rapidement possible?
- Communications opérationnelles
- Comment la communication entre les membres, les superviseurs, le GTI et d’autres équipes d’intervention coordonnées s’est-elle déroulée?
- Le fonctionnement des radios était-il adéquat? Est-ce que les radios ont fonctionné comme prévu? Y a-t-il eu des problèmes qui ont empêché des membres de communiquer sur-le-champ des renseignements critiques par radio?
- Comment la STO a-t-elle géré les nombreux appels de service ainsi que la coordination de l’intervention?
- Est-ce que d’autres moyens de communication, outre le téléphone cellulaire et la radio, auraient été utiles?
- La couverture radio et cellulaire était-elle adéquate dans le secteur, tout au long de l’intervention, y compris lors de l’arrestation du suspect?
- Communications et médias
- Comment s’est déroulée la communication avec les médias? Est-ce que des conférences de presse ont été tenues régulièrement?
- Un conseiller en communications stratégiques avait-il été intégré au poste de commandement?
- Un conseiller en communications stratégiques avait-il été intégré au poste de commandement?
- Alertes d’urgence
- En quoi les alertes d’urgence ont-elles été efficaces?
- Est-ce que des alertes publiques ont été diffusées en temps opportun, et comprenaient-elles suffisamment d’information pour informer la population de la gravité de la situation?
- Doit-on apporter des améliorations?
- Centre divisionnaire des opérations d’urgence (CDOU)
- Examiner le fonctionnement du CDOU lors de l’intervention pour déterminer si des améliorations sont nécessaires.
- Renseignement/information sur l’auteur des crimes
- Y a-t-il eu des occasions raisonnables pour les forces de l’ordre d’intervenir auprès de l’accusé avant la commission des crimes du 4 septembre?
- Y a-t-il une façon de détecter des signes précurseurs auprès d’autres délinquants comme l’accusé?
- Procédure d’enquête
- Examiner l’intervention et la coordination du Groupe des crimes graves et les principes de gestion des cas graves; le Bureau national des normes et des pratiques d’enquête réalisera une évaluation indépendante du dossier.
- Soutien aux victimes
- Examiner l’intervention, le niveau d’acceptation et l’efficacité du Groupe de soutien aux victimes de la violence de masse (DG), des Services aux victimes à l’échelle locale, de l’équipe de liaison avec les familles et des Services de police autochtones.
- L’intervention et les mesures d’enquête étaient-elles sensibles à la culture et empreintes de respect pour les familles et la collectivité?
- Est-ce que les scènes de crime ont été protégées jusqu’à ce que des dispositions soient prises pour le nettoyage? Est-ce que la protection a seulement été levée une fois les scènes nettoyées?
- Examen stratégique élargi
- Y a-t-il des moments où les politiques, les procédures ou les mesures tactiques n’ont pas été suivies? Est-ce que des modifications doivent être apportées?
- Interopérabilité et échange d’information avec des services de police partenaires externes
- Est-ce que d’autres services de police ont été mobilisés de manière opportune et efficace dans le but d’optimiser les ressources tout au long de l’intervention lors de l’incident ayant fait un grand nombre de victimes?
Vous pouvez vous rendre sur les lieux de l’incident, si cela s’avère pertinent pour l’examen. Vous pouvez également passer en revue l’enquête et d’autres documents et mener des entrevues auprès de membres et de témoins, à condition de ne pas faire obstacle à l’enquête criminelle.
La commandante de la Division F assumera tous les coûts accessoires et les coûts salariaux engagés pour la réalisation de l’examen. Veuillez facturer tous les coûts au numéro de compte F0367, IO 751780.
Je vous demande d’achever le rapport dans les 90 jours, à moins de circonstances atténuantes. Dans le cadre de l’examen, si vous décelez des pratiques ou des incidents qui ne répondent pas aux normes attendues de l’organisation, vous devez les inclure dans l’examen. Le surintendant Grant St. Germaine sera votre agent de liaison avec la Division F. N’hésitez pas à communiquer avec lui si vous avez besoin d’aide pour recueillir les renseignements requis pour l’examen.
La commissaire adjointe Rhonda Blackmore,
Commandante divisionnaire,
Division F
Annexe B – Lettre de réponse du BNPE
Incident ayant fait un grand nombre de victimes dans la Division F le 4 septembre 2022
Évaluation indépendante des pratiques d’enquête
Lettre de déclaration
Date : Le 28 septembre 2022
Comm. adj. Rhonda Blackmore
Commandante divisionnaire
Division F
OBJET : Évaluation des pratiques d’enquête – Incident ayant fait un grand nombre de victimes dans la Nation crie de James Smith
La présente lettre de déclaration vise à vous informer que j’ai reçu votre lettre nous demandant de réaliser un examen de l’incident tragique ayant fait un grand nombre de victimes dans la Nation crie de James Smith en septembre 2022. J’ai chargé le Bureau des normes et des pratiques d’enquête (BNPE) de la Division K d’organiser et de structurer l’examen, sous ma direction et mes conseils. L’objectif général, selon mon interprétation de votre lettre de mandat datée du 22 septembre 2022, est de déterminer ce qui a bien fonctionné, de relever les éléments à améliorer, de faire ressortir des pratiques exemplaires et de formuler des recommandations, tout cela dans le but d’orienter les interventions futures à l’échelle divisionnaire et nationale.
J’ai transmis à l’équipe d’enquête votre lettre de mandat dans laquelle vous soulignez 15 éléments distincts à examiner. Après avoir étudié attentivement votre demande, le BNPE a cerné neuf objectifs globaux. Nous nous pencherons sur chacun des objectifs et sur d’autres éléments par l’entremise d’une évaluation des pratiques d’enquête. Les objectifs examinés sont les suivants :
- Intervention initiale
- Intervention du Commandement des interventions critiques
- Intervention du Service divisionnaire des crimes graves
- groupes spécialisés
- gestion des scènes de crime
- Communications stratégiques
- partenaires contractuels (gouvernement de la Saskatchewan, dirigeants communautaires)
- médias
- communications avec les membres
- Communications opérationnelles
- alertes
- communication interdivisionnaire
- services de police externes
- Intervention visant un grand nombre de victimes (y compris la liaison avec les familles)
- Structure de commandement mise en œuvre (y compris le Centre divisionnaire des opérations d’urgence)
- Renseignement disponible avant l’incident (délinquant/autre)
- Politiques et analyse d’incidents antérieurs
L’objectif 9, Politiques et analyse d’incidents antérieurs, sera intégré à chacun des objectifs distincts de l’examen. Il est essentiel que l’équipe d’examen chargée de l’évaluation tienne compte des recommandations formulées dans le cadre d’analyses réalisées par le passé comme suite à d’autres incidents tragiques. Cet objectif permettra de déterminer dans quelle mesure l’organisation s’est améliorée, les recommandations pertinentes qui ont été mises en œuvre, le cas échéant, compte tenu de la portée de l’incident en cause, et/ou si des recommandations peuvent être formulées à titre de pratiques exemplaires à des fins d’avancement organisationnel. Exemples de situations récentes à prendre en considération : homicides par McLeod/Schmegelsky en Colombie Britannique (et chasse à l’homme subséquente); fusillade à Moncton lors duquel des membres de la GRC ont été tués; et incident ayant fait un grand nombre de victimes survenu récemment en Nouvelle Écosse (lorsque l’information est disponible).
L’évaluation des pratiques d’enquête sera réalisée en fonction de plusieurs principes directeurs :
- Évaluer les objectifs précis susmentionnés et évaluer l’efficacité des structures établies; évaluer les processus et les stratégies afin de faire avancer l’enquête et de réaliser les objectifs/buts souhaités; examiner la gestion de l’incident et les mécanismes de responsabilisation.
- Un cadre pluridisciplinaire s’appliquant à divers organismes sera utilisé pour examiner les objectifs.
- Le triangle de commandement sera formé de membres du BNPE de la Division K. L’un des principaux mandats du BNPE est d’assurer une surveillance indépendante des enquêtes sur des cas/projets majeurs.
- L’examen comprendra le recours à un observateur indépendant, afin d’assurer la transparence des renseignements recueillis et examinés et de renforcer la confiance des intervenants par rapport aux constatations de l’évaluation des pratiques d’enquête.
L’observateur indépendant sera autorisé à observer tous les aspects de l’examen. Il sera notamment invité à participer à tous les comptes rendus et à toutes les séances d’information et à consulter tous les documents recueillis dans le cadre de l’examen ainsi que la lettre de mandat et le rapport final. L’observateur indépendant pourra également faire part de ses commentaires au triangle de commandement ou me les transmettre directement. Nous tenterons de recourir à la personne la plus compétente qu’il soit, et ainsi, nous chercherons à faire appel à un observateur indépendant qui peut assurer une sensibilisation et une perspective culturelles et qui possède des connaissances en matière d’opérations policières. Pour veiller à la protection des renseignements confidentiels et privés, il a été déterminé, en consultation avec la Sécurité ministérielle, qu’une entente de non-divulgation pour l’observateur indépendant serait requise. Le Service divisionnaire de la stratégie opérationnelle de la Division F a été mobilisé; il nous aidera à mener à bien cette exigence par rapport à l’examen. L’observateur indépendant sera désigné en consultation avec l’officier responsable des enquêtes criminelles de la Division F et l’officier responsable des Services de police autochtones de la Division F.
L’examen de l’incident sera structuré selon les principes de la gestion des cas graves, et un triangle de commandement sera établi par le BNPE et relèvera directement de moi. Comme la transparence est essentielle lors d’un examen de ce genre, en plus du recours à un observateur indépendant, l’examen prévoira la consultation de ressources de services de police municipaux pour compléter le nombre d’enquêteurs requis. Pour chaque objectif, une petite équipe d’enquêteurs sera établie pour assurer un examen complet des documents/renseignements. L’organigramme suivant illustre les ressources requises pour mener à bien l’examen dans le délai imposé. Le chef d’équipe, le sergent d’état-major Ryan Breitkreuz (BNPE), communiquera avec les représentants désignés de la Division F pour coordonner le début de l’évaluation des pratiques d’enquête.
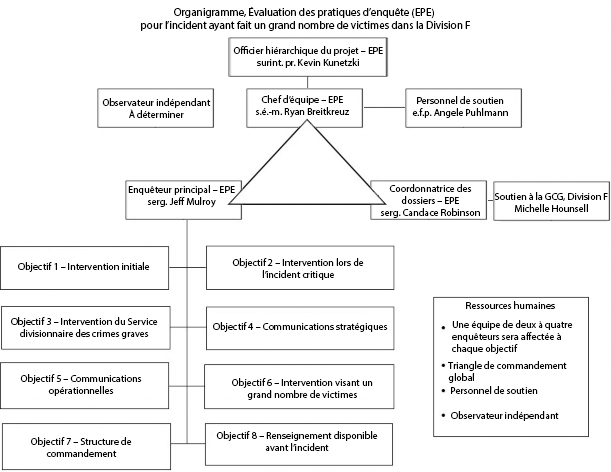
Description de l'image
15 cases blanches avec des bordures noires et du texte à l’intérieur sont disposées hiérarchiquement pour illustrer l’organigramme de l’EPE pour l’incident ayant fait un grand nombre de victimes dans la Division F. En haut de l’organigramme se trouve l’officier hiérarchique du projet d’EPE, le surintendant principal Kevin Kunetzki. En dessous, on trouve l’observateur indépendant (à déterminer) et le chef d’équipe de l’EPE, le sergent d’état-major Ryan Breitkreuz. Dans la même rangée et relié au chef d’équipe de l’EPE, le sergent d’état-major Ryan Breitkreuz, se trouve l’EFP Angele Puhlmann, personnel de soutien.
La troisième rangée est composée de l’enquêteur principal de l’EPE, Jeff Mulroy, et de la coordonnatrice des dossiers de l’EPE, la sergente Candance Robinson. L’image d’un triangle relie le chef d’équipe de l’EPE, le sergent d’état-major Ryan Breitkruez, l’enquêteur principal Jeff Mulroy et la coordinatrice des dossiers de l’EPE, la sergente Candace Robinson. Dans la même rangée, la sergente Candace Robinson, coordonnatrice des dossiers de l’EPE, est accompagnée de Michelle Hounsell, soutien à la GCG Division F.
Sous le sergent principal Jeff Mulroy de l’EPE se trouvent huit objectifs. Ces objectifs sont les suivants : Objectif 1 – Intervention initiale, Objectif 2 – Intervention lors de l’incident critique, Objectif 3 – Intervention du Service divisionnaire des crimes graves, Objectif 4 – Communications stratégiques, Objectif 5 – Communications opérationnelles, Objectif 6 – Intervention visant un grand nombre de victimes, Objectif 7 – Structure de commandement, et Objectif 8 – Renseignements disponibles avant l’incident.
Un encadré distinct, non inclus dans la hiérarchie, contient un texte qui précise la participation des ressources humaines. L’encadré contient quatre puces. La première puce indique que « Une équipe de deux à quatre enquêteurs sera affectée à chaque objectif». La deuxième puce est intitulée « Triangle de commandement global». La troisième puce indique « Personnel de soutien ». La quatrième puce indique « Observateur indépendant ».
À la conclusion de l’examen, un rapport d’évaluation indépendante des pratiques d’enquête sera rédigé en fonction des objectifs susmentionnés. Toutefois, avant que le rapport soit achevé, les membres du triangle de commandement et moi-même rencontrerons la haute direction de la Division F pour discuter des observations initiales et veiller à ce que les pratiques exemplaires et les recommandations formulées dans le rapport cadrent pleinement avec l’intention de votre lettre de mandat.
En préparation de l’évaluation des pratiques d’enquête, le chef d’équipe du BNPE communiquera avec le surintendant Grant St. Germaine pour obtenir tout renseignement pertinent et pour désigner des représentants de la Division F qui pourraient nous aider à réaliser l’examen. Une fois les membres de l’équipe d’examen désignés, on demandera un accès à l’ensemble des données du dossier.
Échéancier prévu :
- Lettre de mandat pour l’examen (23 septembre 2022)
- Désignation des ressources/préparatifs, logistique/exigences relatives aux objectifs (du 23 septembre au 14 octobre 2022)
- Examen en personne à la Division F (une semaine, du 16 au 22 octobre 2022)
- Examen à distance (de deux à trois semaines, du 24 octobre au 10 novembre 2022)
- Séance d’information de l’équipe d’examen (une semaine, du 14 au 18 novembre 2022)
- Séance d’information avec la haute direction de la Division F (pendant la semaine du 21 au 25 novembre 2022)
- Suivi et achèvement des tâches en suspens (de trois à quatre semaines, du 28 novembre au 23 décembre 2022)
- Rapport final (cinq semaines, 27 janvier 2023)
Remarque : L’échéancier pourrait changer selon les exigences opérationnelles. L’échéancier s’étend sur une période de 18 semaines, du début à la fin, ce qui comprend le temps accordé aux préparatifs et à la logistique ainsi qu’à l’élaboration du rapport final, qui comprendra des pratiques exemplaires et des recommandations.
En tout temps, si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées.
Surint. pr. Kevin Kunetzki
Officier responsable en second des enquêtes criminelles
Division K
- Date de modification :