Crimes et incidents motivés par la haine au Canada : Faits, tendances et informations pour les policiers de première ligne
Remarque
Ce document a été élaboré par le secteur de Politique stratégique et transformation, sous la direction de Sara Thompson, experte reconnue en la matière et professeure à l'Université métropolitaine de Toronto, alors qu'elle était sous contrat avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Le document a bénéficié des contributions et du soutien d'experts internes en la matière et de membres du Groupe de travail sur les crimes haineux, coprésidé par la GRC et la Fondation canadienne des relations raciales.
Les informations ont été initialement compilées en 2023, puis mises à jour en 2025, et continueront d'être mises à jour régulièrement.
Veuillez noter que la GRC n'a aucun lien avec les médias, les organisations non gouvernementales, les articles ou recherches universitaires, les sites Web, les rapports ou les enquêtes journalistiques qui peuvent être mentionnés dans le présent document. Tous les articles médiatiques et les références de recherche figurant dans ce répertoire sont fournis à titre indicatif uniquement et ne reflètent pas explicitement les opinions de la GRC.
Les informations compilées pour ce répertoire comprennent des données allant jusqu'à l'année civile 2024. Les nouveaux ensembles de données, s'ils sont disponibles, peuvent être consultés sur le Centre d'information sur les données policières de Statistique Canada.
Sur cette page
- Le crime haineux : concepts et définitions
- Les crimes haineux et le Code criminel du Canada
- Le crime haineux au Canada : tendances et caractéristiques
- Les victimes de crimes haineux : groupes ciblés
- Groupes haineux au Canada
- Discours haineux et liberté d’expression au Canada
- Crimes et incidents motivés par la haine : signalement par les victimes et la communauté et pourquoi c’est important
- Les répercussions de la haine sur les victimes, les communautés et la société
- Victimisation, traumatisme et importance d’une intervention policière centrée sur la victime : fiche d’information et glossaire des termes
- Soutien aux victimes de crimes haineux : un aspect essentiel de l’intervention policière et types de soutien dont les victimes ont besoin et qu’elles souhaitent
- Cyberhaine : fiche d’information
- Y a-t-il un lien entre les crimes haineux et l’extrémisme violent?
- Prévention des crimes haineux : un complément et un supplément importants aux approches réactives fondées sur l’application de la loi
- Références
Renseignements sur les droits d’auteur
Crimes et incidents motivés par la haine au Canada : Faits, tendances et informations pour les policiers de première ligne
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la Gendarmerie royale du Canada, 2025
- ISSN 2818-310X
- Numéro de catalogue PS61-56F-PDF
Liste des acronymes et abréviations
- 2ELGBTQI+
- Deux Esprits, Lesbienne, Gai, Bisexuel, Transgenre, Queer, Intersexuels, Plus
- ACCP
- Association canadienne des chefs de police
- ADL
- Anti-Defamation League (Ligue anti-diffamation américaine)
- DUC
- déclaration uniforme de la criminalité
- EVCI
- extrémisme violent à caractère idéologique
- EVCP
- extrémisme violent à caractère politique
- EVCR
- extrémisme violent à caractère religieux
- GRC
- Gendarmerie royale du Canada
- Incel
- célibataire involontaire
- SCRS
- Service canadien du renseignement de sécurité
Liste des figures
Liste des graphiques
- Graphique 1 : Crimes haineux déclarés par la police au Canada, 2009 à 2024
- Graphique 2 : Crimes haineux déclarés par la police au Canada selon la province ou le territoire de 2017 à 2024
- Graphique 3 : Crimes haineux signalés par type d'infraction, 2024
- Graphique 4 : Taux de crimes haineux violents et non violents déclarés par la police au Canada, 2015 à 2024
- Graphique 5 : Crimes haineux déclarés par la police ciblant la religion, 2015 à 2024
- Graphique 6 : Crimes haineux déclarés par la police selon la religion, 2020 à 2024
- Graphique 7 : Crimes haineux motivés par la race ou l’origine ethnique déclarés par la police, 2015 à 2024
- Graphique 8 : Crimes haineux motivés par l’orientation sexuelle déclarés par la police, 2015 à 2024
- Graphique 9 : Crimes haineux motivés par le sexe our le genre déclarés par la police, 2015 à 2024
Le crime haineux : concepts et définitions
Qu'est-ce qu'un crime haineux?
Le crime haineux est un terme juridique général qui englobe divers motifs, auteurs, victimes, comportements et préjudices.
Le Groupe de travail sur les crimes haineux définit un crime haineux comme une infraction pénale commise contre une personne ou un bien, motivée en tout ou en partie par des préjugés, des préjugés ou de la haine fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, le handicap mental ou physique, l'orientation sexuelle ou l'identité ou l'expression de genre, ou sur tout autre facteur similaire. Cette définition a été approuvée par l'Association canadienne des chefs de police (ACCP) et adoptée par l'Enquête sur la déclaration uniforme de la criminalité (DUC).
Les crimes haineux touchent non seulement les victimes individuelles, mais aussi l’ensemble de la communauté. Les crimes haineux ont également des conséquences qui vont bien au-delà d’un incident spécifique et sont particulièrement préoccupants car ils :
- peuvent présenter des caractéristiques particulièrement violentes et agressives;
- causent des traumatismes aux victimes, à leur famille et à leurs amis;
- peuvent faire craindre d’être la cible de futurs crimes;
- peuvent s’intensifier et entraîner des représailles;
- peuvent perturber les communautés;
- menacent les valeurs nationales de tolérance et d’inclusion.
Il est important de noter que si la haine peut être un facteur de motivation dans ce type d’infraction, elle n’est souvent pas le seul facteur sous-jacent. Des recherches démontrent que les crimes haineux sont souvent motivés par de multiples facteurs, notamment l’ignorance, la peur, la colère et les griefs sociaux et politiques (Janhevich, 2001; Tétrault, 2019; Thompson, Ismail et Couto, 2020), ce qui peut poser des défis juridiques pour déterminer et démontrer la motivation haineuse. En d'autres termes, pour qu'une personne soit reconnue coupable d'un crime haineux, il faut d'abord prouver devant un tribunal que l'infraction était motivée entièrement ou en partie par la haine.
Ressource supplémentaire
Série de vidéos informative :
Qu’entend-on par incident motivé par la haine?
Les incidents motivés par la haine présentent les mêmes caractéristiques que les crimes motivés par la haine, mais ne répondent pas aux critères juridiques requis pour être classés comme des infractions pénales en vertu du Code criminel du Canada. En d'autres termes, les incidents motivés par la haine sont des actes non criminels commis à l'encontre d'une personne ou d'un bien et motivés par des préjugés, des préjugés ou de la haine fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, le handicap mental ou physique, l'orientation sexuelle ou l'identité ou l'expression de genre, ou tout autre facteur similaire. Voici quelques exemples d'incidents motivés par la haine :
- Partager du matériel discriminatoire en personne ou le publier sur Internet;
- Intimider une personne sur les réseaux sociaux en raison de sa religion;
- Utiliser des insultes ou des épithètes racistes;
- Insulter quelqu’un en raison de son origine nationale ou ethnique;
- Faire des blagues offensantes sur la couleur de peau ou l’orientation sexuelle d’une personne.
Même si les incidents motivés par la haine ne donnent pas nécessairement lieu à des infractions pénales, il est important que les agents qui interviennent prennent ces incidents au sérieux et tiennent compte de leurs répercussions et des préjudices causés aux personnes et à leurs communautés. Cela inclut le risque de susciter la peur au sein des communautés touchées.
Une réponse rapide, empreinte de compassion et centrée sur les victimes contribue à atténuer les effets de la haine, à rassurer les victimes et leur communauté élargie, et à amorcer le processus de guérison.
Les crimes haineux et le Code criminel du Canada
Aperçu des articles applicables et des facteurs aggravantes généraux prévus par la loi
Les crimes haineux sont des incidents criminels dont il est établi qu'ils ont été motivés en tout ou en partie par la haine envers une personne ou un groupe identifiable. Selon le paragraphe 318(4) du Code criminel, les groupes identifiables sont définis comme toute partie du public qui se distingue par la couleur, la race, la religion, l'origine nationale ou ethnique, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, ou la déficience mentale ou physique. Il est important de reconnaître que les crimes et incidents haineux peuvent également être motivés en tout ou en partie par la haine envers une intersection de plusieurs de ces identités.
Le Code criminel contient plusieurs dispositions relatives aux crimes haineux :
- Encouragement au génocide [paragraphe 318(1)];
- Incitation publique à la haine [paragraphe 319(1)]; lorsqu’une personne encourage délibérément la haine à l’égard d’un groupe indentifiable.
- Fomenter volontairement la haine [paragraphe 319(2)]; toute personne qui, en communiquant des déclarations autres que dans le cadre d’une conversation privée, encourage délibérément la haine à l’égard d’un groupe identifiable. La déclaration peut être verbale, écrite ou enregistrée et peut inclure des gestes, des signes, des photographies et des dessins.
- Fomenter volontairement l’antisémitisme [paragraphe 319(2,1)];
- Les infractions liées aux thérapies de conversion (articles 320.101 à 104 et paragraphe 273.3(1)); toute forme de traitement qui vise à modifier activement l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre d’une personne.
- Méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc. [paragraphe 430(4,1)]; par exemple, vandaliser un lieu de culte tel qu'une église, une synagogue, un temple, un gurdwara ou une mosquée). Le sous-alinéa 718.2(a)(i) du Code criminel prévoit des peines plus sévères lorsqu'un délinquant est condamné pour une infraction pénale et qu'il existe des preuves que l'infraction était motivée uniquement ou en partie par la haine. En termes simples, tout acte criminel peut être considéré comme un crime motivé par la haine ou les préjugés si la motivation par la haine peut être prouvée.
- Les articles pertinents du Code criminel pour chacune de ces infractions, ainsi que les facteurs aggravants généraux prévus par la loi, sont reproduits ci-dessous.
En plus de ces infractions, le sous-alinéa 718.2(a)(i) du Code criminel contient une disposition clé qui prévoit des peines plus sévères lorsqu’un délinquant est condamné pour une infraction criminelle s’il existe des preuves que l’infraction a été motivée, en tout ou en partie, par la haine.
Les articles pertinents du Code criminel du Canada pour chacune de ces infractions, ainsi que les circonstances aggravantes générales, prévues par la loi, sont reproduits ci-dessous.
Consentement du procureur général
Il existe des procédures à suivre pour poursuivre les auteurs de crimes haineux. En vertu des articles 318(3) et 319(6) du Code criminel, le consentement du procureur général de la province doit être obtenu pour poursuivre les auteurs des infractions suivantes : encouragement au génocide, fomenter volontairement la haine et fomenter volontairement l'antisémitisme.
Lois relatives aux crimes haineux
Encouragement au génocide
- 318(1)
- Toute personne qui prône ou encourage le génocide est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans.
- 318(2)
-
Dans le présent article, le terme « génocide » désigne l'un des actes suivants commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie partie un groupe identifiable, à savoir :
- le meurtre de membres du groupe; ou
- le fait d'infliger délibérément au groupe des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique.
Incitation publique à la haine
- 319(1)
-
Quiconque, en communiquant des déclarations dans un lieu public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsque cette incitation est susceptible de troubler l'ordre public, est coupable :
- d'un acte criminel et est passible d'un emprisonnement maximal de deux ans; ou
- d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Fomenter volontairement la haine
- 319.2
-
Quiconque, par des déclarations faites autrement que dans une conversation privée, encourage délibérément la haine contre un groupe identifiable est coupable :
- d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; ou
- d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Fomenter volontairement l’antisémitisme
- 319(2.1)
-
Quiconque, par des déclarations faites autrement que dans le cadre d’une conversation privée, encourage délibérément l’antisémitisme en tolérant, niant ou minimisant l’Holocauste :
- est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; ou
- est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Thérapie de conversion
- 320.102
-
Toute personne qui, sciemment, soumet une autre personne à une thérapie de conversion, y compris en lui fournissant une telle thérapie, est :
- coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; ou
- coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Promotion ou publicité
- 320.103
-
Quiconque fait sciemment la promotion ou la publicité d’une thérapie de conversion est :
- coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; ou
- coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Avantage matériel
- 320.104
-
Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la prestation de thérapies de conversion est :
- coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; ou
- coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Passage d’enfants à l’étranger (aux fins d’une thérapie de conversion)
- 273.3(1)(c)
-
Expulser du Canada une personne qui réside habituellement au Canada et qui est âgée de moins de dix-huit ans, dans l’intention de commettre à l’étranger un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction :
- coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; ou
- coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.
- 430(4.1)
-
Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien visé à l’un des alinéas (4.101)a) à d), si le méfait est motivé par des préjugés, des préjugés ou de la haine fondés sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression sexuelle ou un handicap mental ou physique :
- est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; ou
- est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Les alinéas (4.101) a) à d) indiquent que les biens désignent :
- un bâtiment ou une structure, ou une partie d'un bâtiment ou d'une structure, qui est principalement utilisé pour le culte religieux — y compris une église, une mosquée, une synagogue ou un temple —, un objet associé au culte religieux situé dans ou sur le terrain d'un tel bâtiment ou d'une telle structure, ou un cimetière;
- un bâtiment ou une structure, ou une partie d'un bâtiment ou d'une structure, qui est principalement utilisé par un groupe identifiable tel que défini au paragraphe 318(4) comme établissement d'enseignement — y compris une école, une garderie, un collège ou une université —, ou un objet associé à cet établissement situé dans ou sur le terrain d'un tel bâtiment ou d'une telle structure;
- un bâtiment ou une structure, ou une partie d'un bâtiment ou d'une structure, qui est principalement utilisé par un groupe identifiable au sens du paragraphe 318(4) pour des activités ou des événements administratifs, sociaux, culturels ou sportifs — y compris une mairie, un centre communautaire, un terrain de jeux ou un aréna —, ou un objet associé à une telle activité ou à un tel événement situé dans ou sur le terrain d'un tel bâtiment ou d'une telle structure; ou
- un bâtiment ou une structure, ou une partie d'un bâtiment ou d'une structure, qui est principalement utilisé par un groupe identifiable au sens du paragraphe 318(4) comme résidence pour personnes âgées ou un objet associé à cette résidence situé dans ou sur le terrain d'un tel bâtiment ou d'une telle structure.
Principes de détermination de la peine
- 718.2
-
Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
- une peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
- que l’infraction a été motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre.
- une peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
Le crime haineux au Canada : tendances et caractéristiques
Remarque
Selon le Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, les tableaux et graphiques suivants illustrent diverses tendances observées au fil du temps en matière de crimes haineux. Des données supplémentaires sont disponibles auprès de Statistique Canada.
Les crimes haineux sont en hausse au Canada
Comme l’illustre le graphique 1 ci-dessous, de 2009 à 2024, le nombres de crimes haineux signalés àla police au Canada a quelques fluctuations mineures d’une année à l’autre, suivies d’augmentations constantes et parfois marquées d’une année à l’autre.
La première hausse marquée des crimes haineux a commencé en 2016 et a coïncidé avec la montée de la politique populiste et de la rhétorique incendiaire à l’encontre des immigrants, des groupes racialisés et des minorités religieuses. Après une légère baisse entre 2017 et 2018, les taux de crimes haineux ont généralement augmenté d’années en année. Le nombre de crimes haineux signalés à la police a presque doublé entre 2020 et 2024.
Graphique 1 : Crimes haineux déclarés par la police au Canada, 2009 à 2024
Version textuelle
| Année | Nombre d'événements |
|---|---|
| 2009 | 1 482 |
| 2010 | 1 401 |
| 2011 | 1 332 |
| 2012 | 1 414 |
| 2013 | 1 167 |
| 2014 | 1 295 |
| 2015 | 1 362 |
| 2016 | 1 409 |
| 2017 | 2 073 |
| 2018 | 1 817 |
| 2019 | 1 951 |
| 2020 | 2 646 |
| 2021 | 3 355 |
| 2022 | 3 612 |
| 2023 | 4 828 |
| 2024 | 4 882 |
Les niveaux de crimes haineux varient-ils dans le temps et dans l’espace?
Oui. Bien que le nombre total de crimes haineux signalés à la police ait augmenté au Canada ces dernières années, on observe des variations marquées au fil du temps et entre les provinces et les territoires. Comme le démontre le graphique 2, ces variations sont visibles au sein du nombre de crimes haineux signalés à la police dans chaque province et territoire entre 2017 et 2024.
Graphique 2 : Crimes haineux déclarés par la police au Canada selon la province ou le territoire de 2017 à 2024
Version textuelle
| Province ou territoire | Événements par année | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 17 | 19 | 29 |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 | 2 | 8 | 8 | 19 | 16 | 21 | 18 |
| Nouvelle-Écosse | 21 | 32 | 32 | 58 | 70 | 115 | 194 | 164 |
| Nouveau-Brunswick | 22 | 15 | 30 | 19 | 37 | 50 | 70 | 65 |
| Québec | 489 | 379 | 399 | 454 | 486 | 419 | 729 | 723 |
| Ontario | 1 023 | 807 | 848 | 1 159 | 1 624 | 1 950 | 2 499 | 2 575 |
| Manitoba | 36 | 42 | 55 | 58 | 73 | 61 | 112 | 79 |
| Saskatchewan | 20 | 30 | 33 | 51 | 53 | 80 | 112 | 107 |
| Alberta | 192 | 245 | 207 | 294 | 339 | 319 | 370 | 398 |
| Colombie-Britannique | 255 | 259 | 321 | 519 | 612 | 545 | 674 | 692 |
| Yukon | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 |
| Territoires du Nord-Ouest | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 15 | 4 | 11 |
| Nunavut | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 7 | 4 |
Bien que le nombre de crimes haineux signalés à la police varie d'une année à l'autre dans chacune des provinces et chacun des territoires, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nunavut, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ont généralement enregistré le moins de crimes haineux entre 2017 et 2024, tandis que la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec ont enregistré un nombre comparativement plus élevé.
Où les crimes haineux sont-ils les plus fréquents?
Au Canada, de 2011 à 2020 :
- 33 % des crimes haineux violents signalés à la police ont été commis dans un parc ou un champ.
- 2 % des crimes haineux violents signalés à la police ont été commis dans une résidence.
- 18 % des crimes haineux violents signalés à la police ont été commis dans un commerce.
Au Canada, de 2011 à 2020 :
- 30 % des crimes haineux non violents signalés à la police ont été commis dans un espace ouvert.
- 24 % des crimes haineux non violents signalés à la police ont été commis dans une résidence.
- 14 % des crimes haineux non violents signalés à la police ont été commis dans un établissement d’enseignement.
- 13 % des crimes haineux non violents signalés à la police ont été commis dans un commerce.
Les crimes et incidents haineux en ligne sont également en voie d’augmentation. Par exemple, le nombre de crimes haineux signalés à la police et classés comme cyberhaine a plus que doublé entre 2018 et 2022 (passant de 92 en 2018 à 219 en 2022. Comme pour tout crime haineux, il est important de reconnaître que ces chiffres sous-estiment le nombre réel d'actes de cyberhaine, car la plupart des crimes haineux ne sont pas signalés.
La nature de la victimisation liée aux crimes haineux
En 2024, selon Statistique Canada :
- 55 % de tous les crimes haineux étaient non violents.
- Le méfait était le type de crime haineux non violent le plus fréquemment signalé à la police, représentant 39 % (1 889) des cas.
- 45 % de tous les crimes haineux étaient violents.
- Les voies de fait simples (agression de niveau 1) constituaient le type de crime haineux violent le plus fréquemment signalé à la police, représentant 15 % (741) des cas.
Graphique 3 : Crimes haineux signalés par type d'infraction, 2024
Version textuelle
| Crimes haineux par type d’infractions | Nombre d'événements |
|---|---|
| Homicide et infractions reliées | 15 |
| Voies de fait graves | 7 |
| Aggression causant des lésions corporelles | 342 |
| Aggression, niveau 1 | 741 |
| Total des vols qualifiés | 39 |
| Harcèlement criminel | 222 |
| Communications indécentes et harcelantes | 124 |
| Profération de menances | 601 |
| Autres violations violentes | 86 |
| Actes de malveillance | 1 889 |
| Crimes contre les biens motivés par la haine | 276 |
| Autres infractions non violentes | 182 |
| Incitation publique â la haine | 125 |
| Autres infractions au code pénal | 222 |
| Autres infractions | 11 |
Comme le montre le graphique 4 ci-dessous, lorsque le nombre de crimes haineux violents et non violents a généralement augmenté entre 2015 et 2024 (avec quelques fluctuations mineures d'une année à l'autre), les crimes haineux non violents étaient statistiquement plus fréquents.
Graphique 4 : Taux de crimes haineux violents et non violents déclarés par la police au Canada, 2015 à 2024
Version textuelle
| Année | Événements par année | |
|---|---|---|
| Non violent | Violent | |
| 2015 | 785 | 487 |
| 2016 | 756 | 603 |
| 2017 | 1 272 | 796 |
| 2018 | 1 019 | 798 |
| 2019 | 1 086 | 865 |
| 2020 | 1 496 | 1 150 |
| 2021 | 1 881 | 1 474 |
| 2022 | 1 942 | 1 670 |
| 2023 | 2 632 | 2 196 |
| 2024 | 2 705 | 2 177 |
Ressource supplémentaire
Les victimes de crimes haineux : groupes ciblés
Certains segments de la population continuent d'être disproportionnellement visés par des crimes et incidents motivés par la haine. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des types de motivations courantes des crimes motivés par la haine, des segments de la population les plus susceptibles d'être visés et des tendances récentes en matière de victimisation pour chaque type de crime.
Nombre de crimes haineux par groupe identifiable ciblé
Entre 2020 et 2024, parmi les incidents signalés à la police, les groupes identifiables suivants ont été pris pour cible :
- race/ethnicité (9 941);
- religion (4 871);
- orientation sexuelle (2 752);
- sexe/genre (467); et
- autres motivations (797)*;
* Cette catégorie comprend les déficiences mentales ou physiques, la langue, les immigrants/nouveaux arrivants au Canada, l'âge ou d'autres facteurs, par exemple la profession ou les convictions politiques.
Les sections suivantes ventilent les types de crimes haineux afin de mettre en évidence les tendances au fil du temps et les segments de la population qui sont disproportionnellement visés.
Crimes haineux visant la religion
Comme le montre le graphique 5 ci-dessous, le nombre global de crimes haineux visant la religion signalée à la police a fluctué entre 2020 et 2024, bien que la tendance générale au cours de cette période soit à la hausse, ponctuée par des hausses en 2017, 2021 et 2023.
Graphique 5 : Crimes haineux déclarés par la police ciblant la religion, 2015 à 2024
Version textuelle
| Année | Nombre d'événements |
|---|---|
| 2015 | 469 |
| 2016 | 460 |
| 2017 | 842 |
| 2018 | 657 |
| 2019 | 613 |
| 2020 | 530 |
| 2021 | 886 |
| 2022 | 768 |
| 2023 | 1 345 |
| 2024 | 1 342 |
Le graphique 6 ci-dessous présente les données sur les crimes haineux signalés à la police entre 2020 et 2024, par type de religion visée. Au cours de cette période, la population juive du Canada a été la plus touchée par les crimes haineux (3 229).
- la population juive a été la plus touchée par les crimes haineux (3 229)
- population musulmane (784)
- la population catholique (360)
- La population ayant indiqué « religion non précisée » (463).
Graphique 6 : Crimes haineux déclarés par la police selon la religion, 2020 à 2024
Version textuelle
| Religion | Nombre d'événements | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Juive | 331 | 492 | 527 | 959 | 920 | ||
| Musulmane | 84 | 142 | 109 | 220 | 229 | ||
| Catholique | 43 | 155 | 52 | 49 | 61 | ||
| Religion non précisée | 72 | 97 | 80 | 105 | 109 | ||
Le rapport statistique annuel 2024 sur les crimes haineux (disponsible en anglais seulement) publié par le service de police de Toronto fait état d'une augmentation des crimes haineux par rapport à l'année précédente, visant le plus souvent la communauté juive. Le rapport révèle que les incidents liés aux méfaits contre la communauté juive représentent le pourcentage le plus élevé, soit 33 % (148 incidents), du total des crimes haineux signalés en 2024.
Crimes haineux visant la race/l’origine ethnique
Le graphique 7 présente les données sur les crimes haineux signalés à la police entre 2015 et 2024 qui visaient la race ou l'origine ethnique. En 2024, les crimes haineux motivés par la race ou l'origine ethnique représentaient 49 % de tous les crimes haineux signalés à la police au Canada.
Graphique 7 : Crimes haineux motivés par la race ou l’origine ethnique déclarés par la police, 2015 à 2024
Version textuelle
| Année | Nombre d'événements |
|---|---|
| 2015 | 641 |
| 2016 | 666 |
| 2017 | 878 |
| 2018 | 793 |
| 2019 | 884 |
| 2020 | 1 619 |
| 2021 | 1 745 |
| 2022 | 2 002 |
| 2023 | 2 198 |
| 2024 | 2 377 |
Entre 2020 et 2024,
- la population noire du Canada a été la plus touchée par les crimes haineux, avec un total de 3 859 cas;
- la population d'Asie de l'Est ou du Sud-Est a été victime de 1 078 crimes haineux;
- la population sud-asiatique a été victime de 1 098 crimes haineux;
- la population arabe ou d'Asie occidentale a été victime de 1 060 crimes haineux;
- la population blanche a été victime de 400 crimes haineux;
- les peuples autochtones ont été victimes de 352 crimes haineux; et
- populations issues d'« autres » origines raciales/ethniques (Amérique latine, Amérique du Sud et crimes haineux intersectionnels visant plusieurs races ou groupes ethniques; cibles de 1 535 crimes haineux).
Crime haineux visant l’orientation sexuelle
Comme le montre le graphique 8 ci-dessous, entre 2015 et 2024, les crimes haineux visant l'orientation sexuelle signalés à la police ont considérablement augmenté, avec une hausse en 2023 et 889 crimes signalés.
Graphique 8 : Crimes haineux motivés par l’orientation sexuelle déclarés par la police, 2015 à 2024
Version textuelle
| Année | Nombre d'événements |
|---|---|
| 2015 | 141 |
| 2016 | 176 |
| 2017 | 204 |
| 2018 | 186 |
| 2019 | 265 |
| 2020 | 258 |
| 2021 | 438 |
| 2022 | 509 |
| 2023 | 889 |
| 2024 | 658 |
Les recherches montrent que les victimes de crimes haineux ciblés en raison de leur orientation sexuelle :
- sont généralement jeunes et de sexe masculin; et
- sont trois fois plus susceptibles que les autres victimes de haine d'être victimes de violence grave.
Dans une étude menée par Paterson, Walters et Hall (2023) sur l'impact des crimes et incidents haineux sur la communauté 2SLGBTQI+ (disponsible en anglais seulement), ils ont constaté que « les crimes motivés par la haine envers l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne causent généralement plus de dommages physiques et émotionnels que les crimes comparables non motivés par la haine ».
Crime haineux visant le sexe/genre
Comme le démontre le graphique 9 ci-dessous, les crimes haineux ciblant le sexe/genre ont augmenté de manière constante entre 2015 et 2019, ont légèrement diminué en 2020, puis ont augmenté de manière assez significative jusqu'à la fin de 2024. Il convient de noter que, tout comme les crimes haineux visant l'orientation sexuelle, les crimes haineux visant le sexe/genre ont tendance à impliquer des actes de violence. Ils visent également de manière disproportionnée les filles et les femmes, et plus souvent celles issues de groupes racialisés et religieux – notamment les communautés musulmanes et autochtones – qui ont tendance à être les plus touchées par ce type de victimisation.
Graphique 9 : Crimes haineux motivés par le sexe our le genre déclarés par la police, 2015 à 2024
Version textuelle
| Année | Nombre d'événements |
|---|---|
| 2015 | 12 |
| 2016 | 24 |
| 2017 | 32 |
| 2018 | 54 |
| 2019 | 56 |
| 2020 | 49 |
| 2021 | 60 |
| 2022 | 90 |
| 2023 | 129 |
| 2024 | 139 |
La Fondation canadienne des femmes (disponsible en anglais seulement) fournit des informations sur Les faits sur la haine, le harcèlement et la violence en ligne fondés sur le genre, en rendant compte des expériences des femmes et des personnes de genre divers en matière de haine, d'abus et de harcèlement en ligne et numériques. Elle souligne en outre le rôle de l'intersectionnalité chez les femmes issues de minorités racialisées, les membres de la communauté 2SLGBTQ++, les personnes défavorisées sur le plan économique, les minorités religieuses, les personnes ayant une déficience mentale ou physique et les jeunes femmes, qui sont disproportionnellement ciblées.
Autres considérations particulièrement pertinentes pour la police
- Les crimes haineux sont 54 % plus susceptibles que les autres crimes d'impliquer des coauteurs. De plus, lorsque les crimes haineux impliquent plus d'un accusé, les blessures graves infligées à la victime sont 26 % plus susceptibles de se produire (Wang et Moreau, 2022). Pour plus d'informations sur les infractions commises en groupe, y compris les crimes haineux perpétrés par des membres de groupes haineux organisés, voir Groupes haineux au Canada.
- Selon Statistique Canada (2023):
- Sur les 2 872 personnes accusées d'au moins un crime haineux entre 2012 et 2018, la moitié (49 %) avaient déjà été accusées d'au moins un incident signalé à la police (pas nécessairement un crime haineux) au cours des trois années précédant leur première accusation de crime haineux. Plus précisément, 32 % avaient été accusées dans un incident antérieur, 40 % dans 2 à 5 incidents antérieurs et 28 % dans 6 incidents antérieurs ou plus. Parmi tous les incidents antérieurs, un peu plus d'un quart (28 %) impliquaient de la violence.
- Plus de la moitié (54 %) des 2 872 personnes accusées d'un crime haineux entre 2012 et 2018 ont à à nouveau étés en communication avec la police (pas nécessairement pour des faits liés à la haine) dans les trois ans suivant leur première accusation de crime haineux. Parmi celles-ci, 27 % ont été accusées dans le cadre d'un incident subséquent, 40 % dans le cadre de deux à cinq incidents subséquents et 33 % dans le cadre de six incidents subséquents ou plus. Parmi tous les incidents subséquents, 30 % impliquaient de la violence.
- Entre 2018 et 2021, un peu plus d'un crime haineux sur cinq (22 %) signalé à la police a donné lieu à des accusations; la grande majorité des crimes haineux commis au cours de cette période (69 %) n'ont pas été élucidés, car l'auteur n'avait pas été identifié. Les 9 % restants ont été résolus d'une autre manière, par l’entremise d’un avertissement, une mise en garde, un renvoi vers un programme communautaire ou par la demande de la victime de ne pas poursuivre l'accusé. Il est important de noter que les crimes haineux violents (38 %) étaient plus susceptibles de donner lieu à des poursuites ou à des recommandations de poursuites que les crimes haineux non violents (9 %).
Groupes haineux au Canada
Il existe deux bases de données consultables répertoriant les symboles, les personnages et les thèmes haineux afin de faciliter leur identification :
- La Ligue anti-diffamation américaine (ADL): celle-ci peut inclure certains groupes qui ne sont pas actuellement actifs au Canada et/ou ne pas inclure certains groupes qui le sont; et
- Le projet de recherche et d'éducation en ligne sur la haine du Musée de l'Holocauste de Toronto
Qu'est-ce qu'un groupe haineux?
L'Anti-Defamation League (disponsible en anglais seulement) définit ce terme comme une organisation ou un groupe d'individus dont les objectifs et les activités visent à attaquer ou à diffamer un groupe entier de personnes en raison de leur couleur de peau, de leur race, de leur religion, de leur origine nationale ou ethnique, de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité ou expression de genre, ou de leur déficience mentale ou physique. La présence de membres racistes ou ayant d'autres préjugés au sein d'une organisation ou d'un groupe plus large ne suffit pas à le qualifier de groupe haineux; pour être classifié comme tel, l'organisation ou le groupe lui-même doit être caractérisé par une orientation ou un objectif fondé sur la haine et en faire la promotion. De plus, l'organisation ou le groupe n'a pas besoin de se livrer à des activités criminelles pour être qualifié de groupe haineux; comme nous le verrons ci-dessous, certains groupes haineux découragent le recours à la violence pour faire avancer leurs objectifs et leurs convictions (Southern Law Poverty Group, 2025).
Combien y a-t-il de groupes haineux actifs au Canada?
Il est difficile d'estimer le nombre de groupes haineux actifs. En raison de la nature souventvolatiles des dirigeants et des membres de ces groupes, ceux-ci « se créent, se divisent et disparaissent sans cesse » à la suite de conflits internes. De plus, certains groupes haineux opèrent en ligne, d'autres impliquent des interactions en personne et d'autres encore sont structurés selon une approche hybride en ligne/hors ligne. Enfin, si certains groupes haineux sont organisés de manière très hiérarchique, d'autres sont plus lâchement affiliés et fragmentés. Tous ces facteurs rendent difficile le suivi du nombre de groupes haineux présentement actifs au Canada (Balgord et Smith, 2021).
Certains chercheurs ont toutefois tenté d’estimer le nombre de groupes haineux au Canada, mais les estimations varient. Certaines recherches suggèrent qu’au milieu des années 2010, il y avait plus de 100 groupes haineux organisés actifs au Canada (Amarasignam et Scrivens, 2017). D’ici2021, les estimations varient entre 70 et 100 jusqu’à 300 groupes de ce type, bien que des divergences entre ces estimations plus récentes soient probables et dépendent en grande partie des différences dans la manière dont les chercheurs comptent les groupes haineux. Selon Lantz, Wenger et Mills (2022), il semble y avoir un consensus par rapport au fait que le nombre de groupes haineux au Canada a augmenté ces dernières années, probablement en raison des facteurs suivants :
- La montée de la politique populiste et la normalisation d'un discours politique raciste et incendiaire qui désigne les minorités raciales et religieuses comme boucs émissaires pour toute une série de problèmes liés à la sécurité communautaire et nationale.
- Après l'apparition de la COVID-19, les accusations généralisées à l'encontre des personnes d'origine asiatique ont entraîné une augmentation des incidents de racisme, de discrimination et de violence à l'encontre des Asiatiques.
- Depuis leur apparition, les attentats inspirés par Daech en Amérique du Nord et en Europe ont inspiré des crimes haineux contre les musulmans dans le monde entier.
- Les crises successives liées aux migrants et aux réfugiés exposent les demandeurs d'asile et les immigrants à diverses formes de violence et de harcèlement découlant de discours problématiques affirmant que certains groupes d’immigrants et de réfugiés « abusent du système d'asile », « épuisent le système de protection sociale » et/ou « volent les emplois des Canadiens ».
Bon nombre des groupes stéréotypés par ces discours ont connu une forte augmentation des crimes haineux à leur encontre. En d'autres termes, il a été démontré que les crimes haineux contre certains segments de la population augmentent à la suite de discours incendiaires qui les présentent comme des menaces liés à la sécurité communautaire et à la sécurité nationale (Neidhardt et Butcher, 2022).
Les crimes haineux perpétrés en réponse à ces attaques illustrent la relation qui existe parfois entre les crimes haineux et l'extrémisme violent, les crimes haineux étant destinés à servir de forme de représailles indirectes contre des membres innocents de la communauté musulmane élargie.
Ces événements, parmi d'autres, ont servi de catalyseur pour rassembler des personnes partageant une vision particulière du monde et les mobiliser contre ces menaces et d'autres perçues comme telles. L’nternet a facilité ces connexions et fourni un moyen par lequel les groupes haineux peuvent diffuser instantanément leur propagande à un large éventail d’invidividus, recruter de nouveaux membres et organiser des manifestations et d'autres activités de groupe. C'est cette connectivité qui rend possible la communication transnationale entre les groupes haineux,La recherche démontre que les groupes haineux au sein d'un même pays peuvent apprendre et s'inspirer de ceux d'autres pays, ce qui peut compliquer les efforts d’exécution de la loipar la police et des agences partenaires (Aziz et Carvin, 2022; Hodge et Hallgrimsdottir, 2020).
Dans ce contexte .élargi, les groupes haineux au Canada semblent avoir augmenté tant en taille qu'en nombre. Le maintien de la culture et du patrimoine blancs « traditionnels » figure parmi les principaux objectifs de ces groupes, qui sont généralement fondés sur l'idéologie de la suprématie blanche et adhèrent à toute une série de croyances, notamment des sentiments antisémites et islamophobes, bien que de nombreux groupes se positionnent également contre les immigrants, les femmes, les personnes 2ELGBTQI+ et d'autres groupes minoritaires racialisés et religieux (O'Donnell, 2020; Perry et Scrivens, 2018).
Est-ce que tous les groupes haineux commettent des crimes et des actes de violence motivés par la haine?
Bien que la diffamation de groupes de personnes sur la base de caractéristiques identitaires (telles que le sexe, la nationalité, la race/l'origine ethnique ou la religion, ou une combinaison de ces caractéristiques) puisse inspirer ou être un précurseur de la violence, certains groupes haineux ne cautionnent pas le recours à la violence et ne commettent pas d'actes violents pour soutenir les objectifs généraux de l'organisation ou du groupe. La recherche suggère que cela peut, en partie, être une tactique de recrutement délibérée; certains groupes ont délibérément minimisé la promotion de la violence et de la haine, car cela rebute beaucoup de gens et ne constitue donc pas un moyen efficace de « développer le mouvement » (Southern Law Poverty Group, 2022; Tétrault, 2021). D'autres, cependant, privilégient et approuvent le recours à la violence. Ces orientations variées en matière de promotion de la violence peuvent rendre difficile l'évaluation et/ou l'identification des menaces potentielles, ce qui peut compliquer l'évaluation et/ou l'identification des menaces potentielles et les efforts visant à réduire le risque d'attaques motivées par la haine (il convient de noter que ces attaques peuvent toucher différents types de victimes, allant d'individus ou de petits groupes à des événements causant de nombreuses victimes). Bien que certains groupes haineux commettent effectivement des crimes haineux, la recherche démontre que la plupart des crimes haineux sont commis par des individus n'appartenant à aucun groupe haineux organisé (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, 2020; Balgord et Smith, 2021).
Pourquoi les gens se joignent-ils à des groupes haineux?
La recherche suggère que les gens se joignent à des groupes haineux pour diverses raisons, notamment, parce qu'ils ont des opinions haineuses à l'endroit de certains tronçons de la population (Jayson, 2017; Schweppe et Perry, 2021). Plus précisément, les gens rejoignent des groupes haineux pour les raisons suivantes :
- un sentiment d’aliénation et d’impuissance;
- un sentiment de solitude; un désir d’amitié et d’appartenance;
- la recherche d’un sens et d’une identité;
- la peur de ceux qui sont différents et/ou la crainte que son groupe social soit « menacé » par l’immigration et les changements démographiques;
- colère et frustration;
- besoin de réaffirmer un sentiment de domination et de privilège;
- tendance à adopter une pensée rigide binaire (c'est-à-dire un manque de capacité de réflexion critique);
- expériences traumatisantes pendant l’enfance (une étude américaine a révélé que 45 % des anciens membres de groupes haineux ont déclaré avoir été victimes de violences physiques pendant leur enfance, tandis que 20 % ont déclaré avoir été victimes d’abus sexuels pendant leur enfance);
- perturbations familiales pendant l’enfance, notamment le divorce, l’incarcération d’un parent ou la toxicomanie de la part d’un ou des deux parents.
Une enquête journalistique menée par CBC News a mis en évidence la présence de « clubs actifs au Canada » (disponsible en anglais seulement) et certains lieux publics ou entreprises où ils se réunissent, utilisant souvent des lieux communautaires pour comme lieu de tournage de vidéos de recrutement et mener des entraînements au combat.
En bref, on pense que les groupes haineux offrent à leurs membres un sentiment d'identité, d’appartenance et d'importance personnelle fondé sur leur affiliation au groupe. La recherche démontre que les groupes haineux restent « majoritairement blancs et masculins ». Le nombre defemmes membres sont relativement moins nombreux, mais elles jouent divers rôles actifs, notamment dans le recrutement, la collecte de renseignements, la diffusion de matériel de propagande et la participation directe à des actes de violence, bien qu'à un niveau moindre que leurs homologues masculins (Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 2019). Ces dernières années, certains groupes haineux aux États-Unis et au Canada ont activement recruté des membres issus de groupes racialisés afin d'adoucir leur image publique et de renforcer leur recrutement (German et Navarro, 2023). Les personnes qui rejoignent les groupes haineux proviennent désormais de tous les milieux socio-économiques et de toutes les professions, et semblent être de plus en plus diverses sur le plan racial/ethnique.
Les informations sur les groupes haineux canadiens restent fragmentaires et incomplètes, ce qui complique les efforts visant à mieux comprendre l’environnement et les risques. Tant que ces informations n'auront pas été systématiquement compilées, les policiers souhaitant mieux comprendre les groupes haineux actifs dans leur zone de compétence doivent contacter le service de leur région qui détient ces informations.
Ressource supplémentaire
L'Organisation pour la prévention de la violence a publié La haine au Canada : Guide des mouvements d'extrême droite (2022) (disponsible en anglais seulement).
Discours haineux et liberté d’expression au Canada
Qu’est-ce qu’un discours haineux?
Il n'existe actuellement aucune définition universelle du discours haineux dans le droit international relatif aux droits de la personne; ce concept fait toujours l'objet de débats parmi les universitaires et les praticiens.
Afin de fournir un cadre unifié pour lutter contre le problème des discours haineux à l'échelle mondiale, la Stratégie et le Plan d'action des Nations Unies sur les discours haineux définissent les discours haineux comme suit :
Tout type de communication, sous forme verbale, écrite ou comportementale, qui attaque ou utilise un langage péjoratif ou discriminatoire à l'égard d'une personne ou d'un groupe en raison de leur identité, c'est-à-dire de leur religion, de leur appartenance ethnique, de leur nationalité, de leur race, de leur couleur, de leur sexe ou de tout autre facteur identitaire.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une définition juridique, la conceptualisation du discours haineux par les Nations Unies comprend trois éléments fondamentaux :
- Les discours haineux peuvent être véhiculés par n’importe forme d’expression, y compris des images, des caricatures, des mèmes, des objets, des gestes et des symboles et peuvent être diffusés hors ligne ou en ligne.
- Le discours haineux est « discriminatoires » (biaisés, sectaire ou intolérants) ou « péjoratifs » (préjugé, méprisant ou dégradant) à l’égard d’un individu ou d’un groupe.
- Les discours haineux mettent en avant les « facteurs identitaires » réels ou perçus d’un individu ou d’un groupe, notamment : la religion, l’origine ethnique, la nationalité, la race, la couleur de peau, l’ascendance, le sexe, mais aussi des caractéristiques telles que la langue, l’origine économique ou sociale, les déficiences mentales ou physiques, l’état de santé ou l’orientation sexuelle, entre autres.
Exemples de discours haineux
Il est important de noter que les discours haineux ne peuvent viser que des individus ou des groupes d'individus, et non des religions, des idées, des philosophies, des partis politiques ou des États/nations et leurs institutions, symboles ou fonctionnaires publiques.
Le site web du Bureau du commissaire aux droits de la personne de la Colombie-Britannique fournit quelques exemples de ce que sont généralement les discours haineux.
- Décrire les membres d'un groupe comme des animaux, des sous-humains ou des êtres génétiquement inférieurs;
- Suggérer que les membres d'un groupe sont à l'origine d'un complot visant à prendre le contrôle en complotant pour détruire la civilisation occidentale.
- Nier, minimiser ou célébrer les persécutions ou tragédies passées dont ont été victimes les membres du groupe;
- Qualifier les membres du groupe d'agresseurs d'enfants, de pédophiles ou de criminels qui s'en prennent aux enfants;
- Blâmer les membres du groupe pour des problèmes tels que la criminalité et la maladie; et
- Traiter les membres du groupe de menteurs, d'escrocs, de criminels ou utiliser tout autre terme destiné à provoquer une réaction violente.
Liberté d’expression et limites existantes
« C’est un pays libre, je peux dire ce que je veux. » Dans une certaine mesure, c’est vrai. La Charte canadienne des droits et libertés (ci-après appelée « la Charte ») énonce les droits civils et humains garantis aux citoyens canadiens, aux résidents permanents et aux nouveaux arrivants au Canada.
L’un de ces droits est la liberté d’expression, qui est énoncée à l’alinéa 2b) de la Charte et qui consacre la liberté fondamentale de « pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication ».
Cela signifie que ceux qui souhaitent manifester pacifiquement ou exprimer un point de vue ont le droit de le faire, même si leurs opinions sont considérées comme offensantes par d'autres. Cependant, ces libertés ne sont pas absolues; l'article 1 de la Charte stipule : « La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés, sous réserve des limites raisonnables prescrites par la loi et qui peuvent être justifiées de façon démontrable dans une société libre et démocratique. » En d'autres termes, il existe des limites aux propos offensants que les gens peuvent légalement tenir.
Par exemple, dans une affaire particulière à Toronto, un individu a été accusé de 29 crimes (disponsible en anglais seulement) jugés motivés par la haine, notamment l'encouragement au génocide et l'incitation publique à la haine, pour avoir prétendument publié en ligne des déclarations encourageant des attaques contre la communauté juive.
En outre, la Cour suprême du Canada a confirmé les restrictions imposées aux formes d'expression jugées contraires à l'esprit de la Charte. Plus précisément, toute expression (verbale ou écrite) qui incite à la haine contre un groupe identifiable est susceptible d'enfreindre le Code criminel et peut donc donner lieu à des poursuites pénales.
Crimes et incidents motivés par la haine : signalement par les victimes et la communauté et pourquoi c’est important
Pourquoi certaines victimes décident-elles de ne pas faire de signalement?
Plusieurs facteurs contribuent à la décision des individus de ne pas signaler les incidents. Un rapport de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne décrit ces facteurs (qui ne sont pas limitatifs) :
- confusion/manque de connaissances sur ce qu'est un crime ou un incident motivé par la haine;
- ne pas savoir où ni comment signaler l'incident à la police;
- la crainte d'une escalade et/ou de représailles;
- gêne, humiliation ou honte d'être victime;
- expériences négatives antérieures avec la police, manque de confiance envers la police et/ou scepticisme quant à la volonté ou à la capacité de la police d'enquêter sur ces crimes;
- normalisation de la victimisation liée à la haine; des recherches montrent que les membres des groupes marginalisés pensent souvent que les insultes « quotidiennes », le harcèlement en ligne et d'autres formes d'hostilité ciblée ne sont pas suffisamment graves pour être signalés à la police. Certains craignent même de faire perdre du temps et des ressources à la police ou pensent qu'ils doivent gérer ces problèmes eux-mêmes;
- pour les membres des communautés 2ELGBTQI+ la crainte des répercussions liées au fait d'être « démasqué »;
- la crainte de compromettre leur statut d'immigrant;
- la conviction que l'accusé ne serait pas condamné ou ne serait pas puni de manière adéquate;
- le fait de traiter le crime ou l'incident motivé par la haine d'une autre manière;
- la crainte de ne pas être pris au sérieux ou de ne pas être cru; et
- les barrières culturelles et linguistiques.
Pour compliquer encore davantage les choses, le niveau d'expertise variable des policiers dans l'identification des crimes motivés par la haine signifie que parfois, lorsque les victimes signalent ces crimes à la police, ceux-ci ne sont pas reconnus ou traités comme tels.
Pourquoi est-il important de signaler les crimes et les incidents motivés par la haine?
Il est important que les crimes et les incidents motivés par la haine soient signalés à la police et consignés par celle-ci pour plusieurs raisons, notamment :
- les crimes et les incidents motivés par la haine qui ne sont pas signalés ne peuvent faire l’objet d’une enquête ou (dans le cas de crimes motivés par la haine) de poursuites, ce qui signifie que les accusées ne sont pas tenus responsables et peuvent être encouragés à récidiver;
- les victimes qui ne signalent pas les crimes et les incidents motivés par la haine ne peuvent généralement pas bénéficier des droits et des ressources prévus dans la Charte canadienne des droits des victimes;
- les crimes et les incidents motivés par la haine qui ne sont pas signalés ne sont pas officiellement comptabilisés, ce qui masque l’ampleur réelle du problème et la nécessité urgente d’agir;
- veiller à ce que les opérations soient adaptées à l'ampleur du problème. Actuellement, au Canada (comme dans d'autres pays), les unités chargées des crimes haineux ont tendance à manquer de ressources, en partie parce que les taux de signalement sont généralement faibles. Cela nuit à la capacité des services de police à réagir efficacement aux crimes et incidents haineux, à soutenir les victimes, à rassurer les communautés touchées et de mettre en œuvre des programmes et des initiatives proactifs axés sur la prévention et l'intervention.
La Fondation canadienne des relations raciales a élaboré une trousse à l'intention des communautés qui fournit des renseignements sur la façon de signaler les crimes et incidents motivés par la haine et sur la manière dont les organisations communautaires peuvent soutenir les personnes ciblées par la haine.
Comment les services de police peuvent-ils améliorer la détection et le signalement des crimes haineux?
L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (2021) et Thompson, Ismail et Couto (2020) soulignent que les services de police de tout le Canada ont redoublé d'efforts ces dernières années pour faciliter l'identification et le signalement des crimes et incidents motivés par la haine, notamment :
- renforcement des capacités institutionnelles: en janvier 2019, 14 des 20 plus grands services de police municipaux du Canada disposaient d'agents et/ou d'unités spécialisés dans les crimes haineux;
- démontrer que la police réagira rapidement et avec compassion à tous les crimes et incidents motivés par la haine qui lui seront signalés;
- maximiser la sensibilisation culturelle afin de mieux communiquer et travailler avec des personnes issues de divers horizons ethniques, raciaux et religieux;
- recours accru à la formation policière sur les crimes haineux et importance d'une intervention policière centrée sur les victimes et tenant compte des traumatismes subis; une formation solide peut aider les agents à reconnaître les crimes et incidents haineux et à y réagir efficacement. Il est toutefois important de noter que de nombreux services de police canadiens (en particulier les petits services disposant de moins de ressources) n'ont pas encore mis en place une telle formation et ne la proposent pas à leurs membres;
- développer des méthodes innovantes pour encourager le signalement des actes haineux, notamment par le biais de diverses initiatives communautaires, partenariats et programmes éducatifs, ainsi que de protocoles visant à apaiser les craintes et à rassurer les communautés victimes d'actes haineux et d'incidents;
- lutter contre les perceptions et les pratiques discriminatoires dans le domaine du maintien de l'ordre afin d'améliorer les relations et la confiance avec les diverses communautés et de renforcer la légitimité perçue de la police;
- condamner publiquement les crimes et incidents motivés par la haine et exprimer son soutien et sa solidarité envers les victimes et leurs communautés au sens large;
- rendre publiques les données relatives aux crimes et incidents motivés par la haine (la publication de données et de rapports montre que la police reconnaît les victimes de crimes motivés par la haine et s'engage à accroître la transparence et à sensibiliser le public au problème de la haine, ce qui peut contribuer à renforcer la confiance du public et à améliorer les taux de signalement);
- mobiliser et soutenir les communautés les plus vulnérables aux crimes haineux; et
- proposer différentes méthodes de signalement, notamment des options de signalement par des tiers et anonymes.
La sous-déclaration des crimes et incidents motivés par la haine est un phénomène courant dans tout le pays. Les individus peuvent ne pas vouloir signaler un crime ou un incident motivé par la haine à la police pour diverses raisons, notamment la crainte de représailles, une désensibilisation à la victimisation ou une méfiance envers la police. Il est nécessaire de poursuivre les efforts de sensibilisation et d'éducation des communautés sur les crimes motivés par la haine, les avantages du signalement et le potentiel d'une intervention précoce afin de développer une compréhension approfondie des défis auxquels les communautés sont confrontées dans ce domaine.
Il est important de noter que les changements dans les pratiques de signalement et la fourniture d'un soutien supplémentaire aux personnes victimes et à leurs communautés peuvent avoir des répercussions sur les statistiques relatives aux crimes haineux. En d'autres termes, les taux plus élevés de crimes haineux signalés à la police dans certaines juridictions peuvent, en partie, refléter des différences ou des changements dans la reconnaissance, le signalement et l'enquête sur ces incidents par la police et les membres de la communauté. Parallèlement, l'augmentation du nombre de crimes et d'incidents haineux peut également refléter une augmentation réelle de ces crimes et incidents.
Les répercussions de la haine sur les victimes, les communautés et la société
Contexte
La recherche démontre que les répercussions des crimes haineux peuvent être profondes, durables et plus graves que celles d'autres types de victimisation. Elles s'étendent également au-delà des personnes directement victimes, comme un effet d'entraînement, pour toucher plus généralement les membres du groupe ciblé (Pickles, 2020; Schweppe et Perry, 2021). Reconnaître l'impact des crimes haineux permet donc de traiter les victimes, leurs familles et leurs communautés avec respect et sensibilité, et peut aider les premiers intervenants et les organismes d'aide aux victimes à mieux comprendre et répondre à leurs besoins souvent complexes. Pour plus d'informations sur les besoins et les services aux victimes, voir Soutien aux victimes de crimes haineux : un aspect essentiel de l'intervention policière et Types de soutien dont les victimes ont besoin et qu'elles souhaitent.
La figure 1 illustre comment les crimes et incidents motivés par la haine servent de « crimes symboliques » destinés à intimider et à contrôler, et comment les vagues de préjudice dépassent les victimes pour toucher également leurs amis et les membres de leur famille, leurs communautés (locales, nationales, internationales et/ou en ligne) et, finalement, la société (Iganski, 2001; Schweppe et Perry, 2021).
Figure 1 : Ondes des préjudices découlant d’un crimes haineux
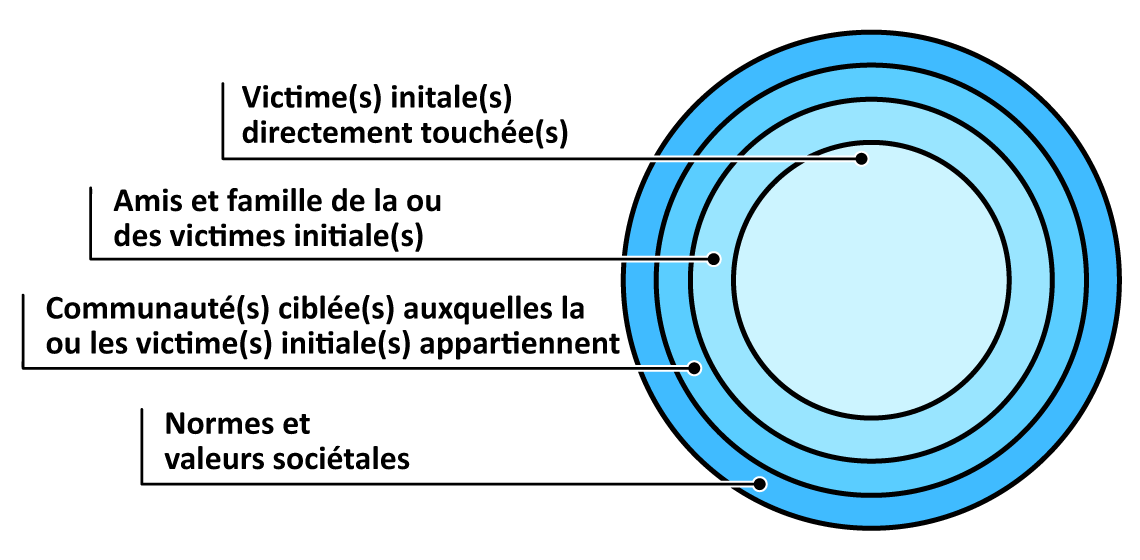
Provenant de : Adapté de Iganski, P. (2001) « Hate Crimes Hurt More », American Behavioral Scientist 45(4): 629.
Version textuelle
Quatre cercles concentriques. Chaque cercle représente une onde de préjudice. L’onde primaire est le cercle central, appelé « Victime(s) initale(s) directement touchées(s) ». L’onde secondaire est le cercle suivant, appelé « Amis et famille de la ou des victimes initiale(s) ». L’onde tertiaire est le cercle suivant, appelé « Communauté(s) ciblée(s) auxquelles la ou les victime(s) initiale(s) appartiennent ». Le cercle le plus extérieur est appelé « Normes et valeurs sociétales ».
Les répercussions des crimes et incidents motivés par la haine
Les répercussions découlant de la victimisation liée aux crimes haineux sont vastes et peuvent être influencées par un certain nombre de facteurs, notamment (mais sans s'y limiter) les expériences antérieures de victimisation, la nature et les caractéristiques du crime ou de l'incident haineux, la gravité du crime et des blessures, la race/l'origine ethnique, l'âge, le sexe, la religion, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, les expériences antérieures de discrimination et la disponibilité de cercles de soutien social (amis, famille, chefs religieux, etc.). La nature souvent intersectionnelle de l'identité d'un individu peut également aggraver et intensifier le préjudice subi. Il est donc essentiel que la police et les organismes partenaires adoptent une approche intersectionnelle lorsqu'ils interviennent dans le cadre de crimes et d'incidents motivés par la haine, afin de s'assurer que les multiples préjugés qui ont motivé le crime ou l'incident sont reconnus (par exemple, la haine fondée sur la race/l'origine ethnique et l'identité de genre) et que les nuances du préjudice qui en découlent sont reconnues et prises en compte (International Association of Chiefs of Police Response to Victims of Crime, 2018; Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, 2020).
Un reportage de CBC News (disponsible en anglais seulement) a relaté l'expérience vécue par un élève du secondaire d'Edmonton, où l'intersectionnalité des identités est devenue un facteur important dans l'augmentation de sa peur d'être victimisé, même dans le cas où il n'était pas lui-même victime.
Compte tenu de la nature vaste et diffuse de la victimisation liée aux crimes haineux, il est utile de répertorier les répercussions de la haine selon que l'individu soit touché directement ou indirectement.
Les répercussions directes sont subies par la ou les victimes initiales d'un crime ou d'un incident motivé par la haine et peuvent inclure divers préjudices physiques, psychologiques, émotionnels, financiers et sociaux qui peuvent évoluer à court et à long terme. Les répercussions indirectes, quant à elles, sont des préjudices « indirects » ou « par procuration » subis par des personnes qui ne sont pas directement touchées par le crime ou l'incident motivé par la haine, notamment la famille, les amis, les témoins et les membres de la communauté.
La recherche démontre que les répercussions indirectes sont souvent similaires aux répercussions directes; le simple fait de connaître quelqu'un qui a été victime d'un crime haineux suffit souvent à provoquer ces effets (Pickles, 2020).
Les répercussions directes et indirectes de la victimisation liées aux crimes haineux peuvent inclure :
- blessures physiques;
- détresse émotionnelle et psychologique;
- traumatisme;
- colère;
- dépression, anxiété et idées suicidaires;
- effets à long terme sur la santé, notamment au niveau cardiaque, hépatique, auto-immunitaire et pulmonaire (maladie pulmonaire obstructive chronique);
- sentiment extrême d'isolement;
- sentiment réduit de sécurité et de sûreté;
- sentiment accru de vulnérabilité et crainte d'être à nouveau victime;
- honte et humiliation;
- être plus soucieux de sa sécurité et éviter les situations à risque, ce qui implique souvent le recours à des stratégies d'adaptation pour éviter de nouvelles victimisations, comme déménager, changer ses habitudes, éviter les personnes, les lieux et les situations perçus comme potentiellement dangereux, dissimuler certains aspects de son identité sociale (par exemple, ne pas tenir la main de son partenaire du même sexe en public, ne pas porter de vêtements ou de symboles religieux ou culturels, etc.);
- problèmes à l'école ou au travail;
- problèmes relationnels avec la famille et les amis;
- sentiments de rejet et d'exclusion sociale pouvant entraîner une souffrance et une détresse émotionnelles et psychologiques;
- abus de substances et comportements autodestructeurs; et
- préjudices financiers découlant de leur expérience de victimisation en termes de perte de salaire (due à des blessures et/ou à la participation à la procédure pénale) et/ou de perte ou de dommages matériels.
Il est important de reconnaître que les premiers intervenants peuvent également subir des répercussions indirectes découlant de leur exposition aux victimes de la haine. Le traumatisme vicariant, parfois appelé « coût de l'aide », « fatigue compassionnelle » ou « stress traumatique secondaire », désigne les répercussions émotionnelles et psychologiques subies par les personnes qui travaillent dans des professions d'aide – par exemple, les policiers, les autres premiers intervenants et les travailleurs sociaux de première ligne – en raison de leur exposition aux victimes de traumatismes et de violence (Greinacher et al, 2019; Association internationale des chefs de police, Enhancing Law Enforcement Response to Victims Strategy, 2018).
Outre les préjudices directs et indirects subis par les victimes, leurs amis, leurs familles, leurs communautés élargie et les professionnels de première ligne qui interviennent, les crimes et incidents motivés par la haine ont également des répercussions et des conséquences qui s’étendent sur la société. Par exemple, si les crimes motivés par la haine ne sont pas traités ou font l'objet d'une réponse inappropriée ou non professionnelle, les victimes et leurs communautés élargie peuvent perdre confiance au niveau du processus de justice pénale. Les crimes et incidents motivés par la haine peuvent également nuire à la coexistence saine et positive entre les différents segments d'une communauté. Cela peut réduire le niveau de cohésion sociale et augmenter le risque de représailles et de troubles civils, autant d'éléments qui portent atteinte aux droits humains, aux principes d'égalité et, par extension, à des aspects importants de notre processus démocratique (Müller et Schwarz, 2021; RAN Health, 2023).
Les services d’aide aux victimes au Canada : Le rapport complet est maintenant disponible fournit des informations sur les pratiques exemplaires, les défis et les possibilités liés à l'état actuel des services offerts aux victimes au Canada, et formule des recommandations pour améliorer leur accessibilité et leur efficacité. (CRRF, 2022)
Victimisation, traumatisme et importance d’une intervention policière centrée sur la victime : fiche d’information et glossaire des termes
Contexte
Les victimes de crimes haineux subissent souvent des conséquences plus graves que les victimes d'infractions équivalentes non motivées par la haine. Les membres de la communauté qui partagent les caractéristiques identitaires qui ont fait de la ou des victimes la cible de la haine sont également touchés négativement par les crimes haineux, tout comme ceux qui sont témoins du crime ou de l'incident (Mellgren, Andersson et Ivert, 2017).
Les agents qui interviennent sont souvent les premiers représentants du système de justice pénale que rencontrent les victimes d'actes criminels. À ce titre, ils ont une occasion importante de sécuriser les lieux, de stabiliser la ou les victimes et de fournir des informations importantes, de l’assistance et un accès à des services de soutien qui peuvent aider à entamer le processus de rétablissement immédiatement après un acte criminel.
Il est essentiel de comprendre les répercussions que les crimes et incidents motivés par la haine peuvent avoir sur les victimes, leurs familles et leurs communautés élargies après les faits afin de fournir des services éclairés, sensibles et respectueux, et d'aider les agents intervenants à identifier les besoins des victimes et à commencer à y répondre.
Cette fiche d'information fournit un glossaire des termes liés à la victimisation, ainsi que des concepts et des approches visant à améliorer la réponse de la police aux victimes de crimes et d'incidents motivés par la haine. Elle fournit également des hyperliens vers des informations supplémentaires pour ceux qui souhaitent en savoir plus.
Glossaire des termes
Les droits des victimes au Canada
La Charte canadienne des droits des victimes consacre les droits des victimes dans la loi fédérale, notamment le droit à (Reproduit à partir du site Web du Bureau de l'Ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels) :
- Information
- Les victimes ont le droit de recevoir des informations sur le système de justice et sur les services et programmes qui leur sont proposés. Elles peuvent également obtenir des informations spécifiques sur l’avancement de l’enquête ou les poursuites et la condamnation de la personne qui leur a causé un préjudice.
- Protection
- Les victimes ont le droit à ce que leur sécurité et leur vie privée soient prises en considération à toutes les étapes du processus pénal, et à bénéficier d'une protection raisonnable et nécessaire contre l'intimidation et les représailles. Les victimes ont également le droit de demander une aide au témoignage lors des comparutions devant le tribunal.
- Participation
- Les victimes ont le droit de présenter des déclarations sur l'impact de l'infraction et de les faire prendre en considération par le tribunal. Les victimes ont également le droit d'exprimer leur opinion sur les décisions qui affectent leurs droits.
- Demander une restitution
- les victimes ont le droit de demander au tribunal d'envisager de rendre une ordonnance de restitution et de faire exécuter une ordonnance de restitution non payée par un tribunal civil.
Ressource supplémentaire
- Guide d'information pour aider les victimes
Victime
La Charte canadienne des droits des victimes définit une victime comme « une personne qui a subi un préjudice physique ou émotionnel, des dommages matériels ou une perte économique à la suite d'un crime ». La présente fiche d'information désigne les personnes touchées par des crimes haineux comme des victimes afin d'être conforme à la terminologie couramment utilisée par les juristes et les praticiens. Il est toutefois important de reconnaître que les termes.
Les termes « survivant » et/ou « victime survivante » sont parfois préférés, car ils mettent l'accent sur la force, l'autonomie et la résilience plutôt que de se concentrer uniquement sur le statut de victime d'un acte criminel.
Les approches centrées sur la victime mettent l'accent sur la sécurité, les droits, le bien-être, les besoins exprimés et les choix de la victime, tout en garantissant la prestation de services et de soutiens empathiques et sensibles, sans jugement (Goodman, Tax et Mahamed, 2022).
Les approches centrées sur les victimes pour répondre aux crimes haineux mettent également l'accent sur les identités souvent intersectionnelles des victimes de la haine. Le concept d'intersectionnalité fait référence à la manière dont plusieurs caractéristiques identitaires (race, ethnicité, genre, religion, orientation sexuelle, etc.) s'entrecroisent et interagissent pour produire des dynamiques et des expériences uniques.
Une femme noire, par exemple, est à la fois noire et femme, ce qui peut l'exposer à une discrimination (et, potentiellement, à des crimes haineux) fondée à la fois sur sa race et son sexe. Il est souvent impossible de dissocier son identité de personne noire de son identité de femme, ni d'isoler laquelle de ces caractéristiques identitaires a motivé sa victimisation, car les deux peuvent avoir joué un rôle (Crenshaw, 1991).
Il est important d'appliquer une perspective intersectionnelle aux crimes haineux, car cela permet de mieux comprendre l'expérience de la victime, ce qui est essentiel pour garantir que les services et le soutien offerts sont adaptés aux besoins spécifiques et parfois distincts des victimes (Perry, 2009). Les agents doivent donc veiller à prendre en compte tous les aspects de l'identité de la victime lorsqu'ils évaluent, enregistrent et traitent les incidents et crimes haineux potentiels.
Les approches adaptées à la culture font référence à la capacité d'un individu ou d'une organisation à comprendre, à apprendre et à interagir efficacement avec des personnes de cultures différentes, notamment en s'appuyant sur les valeurs, les traditions, les croyances spirituelles, les coutumes, les langues et les comportements culturels dans la conception et la mise en œuvre de la prestation de services.
La sensibilité culturelle « permet aux individus et aux organisations de répondre de manière respectueuse et efficace aux personnes de toutes cultures, langues, classes, races, origines ethniques, déficiences mentales ou physiques, religions, genres, orientations sexuelles et autres facteurs de diversités » d'une manière qui reconnaît, affirme et valorise leur importance. Être sensible à la culture nécessite d'être capable de comprendre les différences culturelles, de reconnaître les préjugés potentiels et de dépasser les différences afin de travailler de manière productive avec les enfants, les familles et les communautés dont le contexte culturel est différent du sien » (Association nationale des travailleurs sociaux, 2015).
Traumatisme
Un traumatisme individuel résulte de l'exposition à un événement ou à une série d'événements perturbants sur le plan émotionnel et/ou mettant la vie en danger. Un traumatisme peut avoir des effets néfastes importants sur le bien-être mental, physique, social, émotionnel et/ou spirituel d'une personne qui, sans intervention, peuvent persister dans le temps (Center for Health Care Strategies, What is Trauma, 2021). Les effets du traumatisme peuvent être atténués et le processus de guérison peut être amorcé grâce au soutien des amis et de la famille, à l'aide de la communauté, aux ressources et stratégies personnelles d'adaptation et à l'accès à des traitements de santé mentale adaptés au traumatisme.
Il est important de garder à l'esprit que les symptômes liés aux traumatismes varient considérablement d'un individu à l'autre et d'une communauté culturelle à l'autre. La police et les organismes partenaires d'aide aux victimes doivent discuter avec les victimes de leurs besoins et de leurs préférences en matière de soutien, et s'efforcer de les mettre en relation avec des organismes locaux appropriés, adaptés à leur culture et sensibilisés aux traumatismes.
Le traumatisme vicariant, parfois appelé « coût de l'aide », « fatigue compassionnelle » ou « stress traumatique secondaire », désigne les répercussions émotionnelles et psychologiques subies par les personnes qui exercent des professions d'aide, par exemple les policiers, les autres premiers
et les travailleurs sociaux de première ligne – en raison de leur exposition aux victimes de traumatismes et de violence (Greinacher et al, 2019; et International Association of Chiefs of Police, Enhancing Law Enforccite lang="en"ent Response to Victims, 2018).
Heureusement, le traumatisme vicariant peut être traité et ses symptômes atténués grâce à des consultations psychologiques et à une intervention précoce. Il est essentiel d'identifier et de traiter les symptômes le plus tôt possible afin de protéger la santé mentale des agents qui exercent cette profession très stressante et, par conséquent, d'améliorer la qualité des services fournis à la communauté (Torchalla et Killoran, 2022). L'American Psychological Association (disponsible en anglais seulement) fournit des informations supplémentaires portant sur la compréhension et le traitement du traumatisme vicariant chez les premiers intervenants.
Les approches tenant compte des traumatismes désignent la prestation de services et de soutiens qui tiennent compte des vulnérabilités et des expériences des personnes ayant subi un traumatisme. Ces approches accordent la priorité au rétablissement du sentiment de sécurité, de choix et de contrôle de la victime.
Les victimes de crimes et d'incidents motivés par la haine qui signalent leur victimisation à la police font confiance au système de justice pénale alors qu'elles sont extrêmement vulnérables; l'attitude des acteurs au sein du système peut parfois traumatiser à nouveau les victimes, ce qui peut aggraver le préjudice subi (Office of Justice Programs : Model Standards for Serving Victims and Survivors of Crime, 2023).
Le Bureau des institutions démocratiques et des droits de la personne (disponsible en anglais seulement) fournit des exemples de façons dont les représentants du système de justice pénale, y compris la police, peuvent potentiellement contribuer à la retraumatisation, notamment:
- Une incapacité à reconnaître les crimes et les incidents motivés par la haine en raison d’un manque de sensibilisation et de formation;
- Absence de réaction, ou réaction perçue par les victimes comme inutile ou non professionnelle;
- Le fait d'attribuer la responsabilité du crime aux victimes (blâmer les victimes);
- Minimiser la gravité d'un crime haineux et/ou banaliser l'expérience et les préjudices subis par la victime;
- Nier le point de vue de la victime dans l'évaluation et l'appréciation du crime et/ou ne pas tenir compte de la motivation fondée sur des préjugés ou la rejeter comme non pertinente;
- Afficher des attitudes négatives ou préjudiciables envers la ou les victimes;
- Exprimer de la sympathie et de la compréhension envers l'auteur du crime;
- Manque de connaissances, d'expérience et de compétences appropriées pour reconnaître l'importance de l'identité de la victime (ou des aspects croisés de son identité) pour la victimisation qu'elle a subie et les services et le soutien dont elle a besoin pour se rétablir; et
- Un manque de considération pour les besoins et les préférences des victimes, en particulier le besoin d'informations et d'accès à des services et à un soutien approprié.
Il est important que tous les professionnels travaillant avec des organismes qui viennent en aide aux victimes de crimes haineux (y compris la police et les autres acteurs de la justice pénale) reconnaissent que leurs actions et leurs attitudes peuvent avoir des répercussions considérables sur les victimes de crimes haineux.
Traditionnellement, le système de justice pénale s'est concentré sur l'identification, l'arrestation, la poursuite et la responsabilisation des délinquants pour leurs actes; les besoins des victimes sont souvent négligés. En reconnaissant que les approches centrées sur les victimes, tenant compte des traumatismes et adaptées à la culture sont des éléments essentiels d'une réponse efficace aux victimes, les agents qui interviennent peuvent donner prioriser l'accès rapide des victimes à de l’information et aux services de soutien, amorçant ainsi le processus de rétablissement.
Les agents qui interviennent peuvent prendre des mesures pour réduire le risque de traumatiser à nouveau les victimes par inadvertance, tout en s'efforçant de garantir l’accès aux services centrés sur les victimes, tenant compte des traumatismes subis et adaptés à la culture. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a publié un document intitulé « Traitement attentif et respectueux des victimes de crimes haineux » (PDF, 270 ko), qui présente les éléments clés à prendre en considération et les pratiques de communication efficaces pour aider à réduire le risque de revictimiser.
Soutien aux victimes de crimes haineux : un aspect essentiel de l’intervention policière et types de soutien dont les victimes ont besoin et qu’elles souhaitent
Introduction
L'aide aux victimes est un élément essentiel, mais souvent négligé, d'une réponse policière globale aux crimes et incidents motivés par la haine.
Traditionnellement, le système de justice pénale s'est concentré sur l'identification, l'arrestation, la poursuite et la responsabilisation des délinquants pour leurs actes; les besoins des victimes sont souvent négligés. Le fait de ne pas comprendre les besoins des victimes et de ne pas leur fournir en temps opportun des soins appropriés et adéquats peut aggraver les préjudices subis. En revanche, la fourniture d'une aide et d'un soutien significatifs peut avoir un impact profond sur le processus de rétablissement, habiliter les victimes, renforcer la confiance avec la police et faciliter la coopération avec celle-ci et le système de justice pénale afin de responsabiliser les auteurs en justice.
Il en va de même pour le traitement respectueux et digne des victimes, qui devrait être la pierre angulaire de l'intervention policière.
Les agents intervenants doivent adopter une approche centrée sur la victime qui met l'accent sur la protection des droits, la sécurité, le bien-être et les besoins et choix exprimés par les victimes lorsqu'ils interviennent dans des cas de crimes et d'incidents motivés par la haine. Les agents intervenants doivent également reconnaître que les besoins des victimes sont diversifiés, complexes et peuvent évoluer au fil du temps, ce qui nécessite une prise en charge continue à court et à long terme impliquant divers organismes partenaires disposant d'une expertise, de ressources et de services que de nombreux services de police ne peuvent fournir à eux seuls.
Sept besoins essentiels des victimes et recommandations des agents d’intervention
L'Association internationale des chefs de police et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de la personne ont tous deux publié des rapports soulignant les besoins critiques des victimes d'actes criminels (IACP 2018; ODHIR, 2020). Les victimes d'actes criminels ont besoin d'un soutien et de services continus pour se rétablir. Répondre aux sept besoins essentiels des victimes décrits ci-dessous peut servir de base à des pratiques centrées sur les victimes et tenant compte des traumatismes subis. Bien que les besoins des victimes varient, ces sept catégories mettent en évidence les domaines d'intervention prioritaires pour la police, qui joue un rôle essentiel pour garantir que les besoins des victimes soient compris et pris en compte avec compassion et dans le respect de leur dignité.
1. Sécurité et sureté personnelles
À la suite d’un crime ou d’un incident haineux, les victimes peuvent se sentir profondément en danger et les policiers doivent assurer à ces victimes que des mesures appropriées seront prises pour les soutenir et les protéger. Dans la mesure du possible, les policiers doivent :
- fournir des renseignements sur la réduction des risques et la probabilité d’une nouvelle victimisation;
- recommander des mesures à prendre en cas d’intimidation et de crainte de préjudices futurs.
La sécurité physique, émotionnelle et psychologique est importante pour les victimes après un crime. Dans la mesure du possible, les policiers doivent :
- reconnaître que les préoccupations des victimes en matière de sécurité peuvent également être partagées par les enfants, les membres de la famille, les amis et les membres de la communauté;
- créer un environnement où les victimes se sentent en sécurité lorsqu’elles signalent des crimes et expriment leurs pensées, leurs craintes et leurs besoins.
2. Soutien personnalisé
À la suite d'un crime ou d'un incident motivé par la haine, certaines victimes auront besoin d'aide pour faire face aux conséquences et aux répercussions immédiates. Cela peut inclure toute une gamme de services de soutien fournis par divers organismes locaux. Bien que la Charte canadienne des droits des victimes consacre le droit des victimes à recevoir des informations sur les services et les programmes qui leur sont offerts, la police manque souvent l'occasion de mettre les victimes en contact avec l'aide dont elles ont besoin. Dans la mesure du possible, les agents devraient:
- permettre aux personnes de soutien choisies par les victimes d’être présentes lorsque cela est possible. Lorsque cela n’est pas possible, expliquer pourquoi;
- discutez avec les victimes pour connaître leurs besoins et leurs préférences en matière de soutien;
- facilitez la mise en relation avec les organismes et les services locaux qui correspondent aux besoins et aux choix exprimés par la victime en matière de soutien et d’assistance continus.
3. Informations
Les victimes de crimes haineux auront besoin d'informations sur leurs droits, sur le déroulement de l'enquête et sur les points de contact à venir au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête. Dans la mesure du possible, les agents doivent:
- fournir aux victimes des informations sur leurs droits et des conseils sur la manière de les exercer; fournir des informations de différentes manières (par exemple, lors d'entretiens, par le biais de documents écrits/brochures, sur les sites web des agences); et
- Fournir des informations actualisées sur l'enquête. Informer les victimes lorsqu'une affaire ne donne pas lieu à une arrestation et à des poursuites. Expliquer pourquoi et comment les décisions sont prises, en se référant à des motifs juridiques spécifiques, le cas échéant (par exemple, parce que l'incident ne remplissait pas les conditions requises pour donner lieu à des poursuites pénales).
4. Accès au processus de justice pénale et assistance dans ce cadre
Les victimes doivent avoir la possibilité de participer aux procédures pénales. Dans la mesure du possible, les agents doivent:
- Veiller à ce que les informations relatives aux différentes étapes de la procédure pénale et à ce à quoi les victimes peuvent s'attendre leur soient fournies dans les langues utilisées par les membres de la communauté (par exemple, langues parlées, langue des signes, braille); et
- Tenir les victimes informées de l'évolution de leur affaire tout au long du processus pénal.
5. Continuité
Les victimes sont amenées à rencontrer de nombreux professionnels et à suivre plusieurs procédures dans le cadre du système de justice pénale. Dans la mesure du possible, les agents doivent:
- collaborer avec d'autres professionnels de la justice pénale, des organismes communautaires et des prestataires de services aux victimes;
- comprendre les rôles et les responsabilités des autres professionnels;
- utiliser un langage cohérent et une approche centrée sur la victime, tenant compte des traumatismes et adaptée à la culture; et
- faciliter les transferts vers d'autres professionnels de la police, de la justice pénale et des services d'aide aux victimes tout au long de l’enquête.
6. Voix
La victimisation criminelle implique des préjudices physiques, émotionnels ou autres, directs ou menacés, résultant d'actes commis par autrui. La réponse à la criminalité implique également des décisions et des actions de la part d'autrui. Il est important que les victimes puissent s'exprimer dans le système de justice pénale.Lles victimes veulent et ont besoin d'être entendues, comprises, crues et prises au sérieux. Dans la mesure du possible, les agents doivent:
- encourager les victimes à poser des questions et écouter leurs préoccupations; et
- invitez les victimes et le personnel des services d'aide aux victimes à participer aux discussions relatives à l'enquête.
7. Justice
De nombreuses enquêtes ne débouchent pas sur l'arrestation, la poursuite et la condamnation des auteurs d'infractions. La justice procédurale (disponsible en anglais seulement), qui fait référence au concept d'équité dans les processus de résolution des litiges et d'allocation des ressources, peut constituer la seule forme de justice dont bénéficient certaines victimes. Dans la mesure du possible, les agents doivent:
- Reconnaître que toutes les victimes ne définissent pas la justice de la même manière;
- Expliquer les processus du système de justice pénale et la manière dont les décisions sont prises;
- Mener des enquêtes approfondies tenant compte des traumatismes subis et axées sur les délinquants;
- Faire leur part pour que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes; et
- Demander aux victimes leur avis et leur point de vue.
Types de services aux victimes
Selon Justice Canada, les victimes ont besoin de divers types de soutien, notamment :
Services d’aide aux victimes axés sur le système
Ces services sont indépendants de la police, des tribunaux et des procureurs de la Couronne. Les services liés au système aident les victimes tout au long de leur parcours dans le système de justice pénale. Ces services peuvent inclure (sans s'y limiter) :
- fourniture d’informations, soutien, orientation
- conseil à court terme
- préparation et accompagnement au tribunal
- préparation de la déclaration de la victime
- assurer la liaison avec la police, les tribunaux, le procureur et les services correctionnels.
Services d’aide aux victimes offerts par la police
Ces services sont généralement proposés après le premier contact de la victime avec la police. Bien que les organismes d'aide aux victimes puissent être situés dans les commissariats ou les détachements de police, leur personnel n'est pas toujours composé d'employés de la police; de nombreux services d'aide aux victimes basés dans les commissariats disposent d'un coordinateur, de personnel civil et de bénévoles formés. Les services proposés peuvent inclure (sans s'y limiter):
- fourniture d'informations et d'orientations
- assistance et soutien
- orientation vers les tribunaux
Services d’aide aux victimes dans les tribunaux
Ces services apportent un soutien aux victimes ou aux témoins. Les services d'aide aux victimes proposés par les tribunaux fournissent des informations, une assistance et des orientations aux victimes et aux témoins dans le but de rendre la procédure judiciaire moins intimidante. Ces services peuvent inclure (sans s'y limiter):
- orientation, préparation et accompagnement au tribunal
- mises à jour sur l'avancement de l'enquête
- coordination des réunions avec le procureur de la Couronne
- évaluation de la disponibilité d'un enfant victime/témoin pour témoigner.
Services d’aide aux victimes dans la communauté
Ces services fournissent une aide directe aux victimes, notamment (mais sans s'y limiter):
- soutien émotionnel
- aide pratique
- informations
- orientation judiciaire
- orientation vers d'autres services
Bénévoles et organisations non gouvernementales
De nombreux services d'aide aux victimes offerts par la police et les collectivités font appel à des bénévoles formés pour les aider à mettre en œuvre leurs programmes. Ces organisations peuvent exercer leurs activités à l'échelle locale, provinciale et nationale, en offrant une gamme variée de services et de mesures de soutien.
Le soutien aux victimes est un élément essentiel, mais souvent négligé, d'une réponse policière globale aux crimes et incidents motivés par la haine. Comprendre les besoins critiques des victimes de crimes motivés par la haine et s'efforcer d'y répondre peut contribuer à faire respecter les droits consacrés dans la Charte canadienne des droits des victimes, à aider les victimes tout au long du processus de justice pénale et à amorcer leur rétablissement.
Ressource additionnelle
- Le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels a publié une étude intitulée Renforcer l'accès à la justice pour les victimes de crimes motivés par la haine au Canada (2024), qui met en évidence les lacunes structurelles au niveau des ressources et des connaissances disponibles pour soutenir les victimes de crimes haineux.
Cyberhaine : fiche d’information
Qu’est-ce que la cyberhaine?
Le terme « cyberhaine » désigne les discours haineux qui se produisent en ligne et impliquent l'utilisation de technologies de communication électroniques, notamment l’internet (c'est-à-dire les sites web, les réseaux sociaux, les contenus générés par les utilisateurs, les sites de rencontre, les blogs, les jeux en ligne, les messages instantanés et les courriels), ainsi que d'autres technologies générées par ordinateur et téléphone portable (telles que les textos). La cyberhaine se produit lorsque des personnes sont la cible de discours haineux en ligne en raison de leur couleur de peau, de leur race, de leur religion, de leur origine nationale ou ethnique, de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité ou expression de genre, ou de leur déficience mentale ou physique.
Cette fiche d'information utilise le terme « cyberhaine » pour désigner les discours haineux en ligne, bien que ces termes soient souvent utilisés de manière interchangeable.
Qu’est-ce qu’un discours haineux?
Le concept de discours haineux désigne tout type de communication qui attaque ou utilise un langage péjoratif ou discriminatoire en référence à une personne ou à un groupe en raison de leurs caractéristiques identitaires. Les discours haineux peuvent être communiqués verbalement ou par écrit, ou par le biais d'images, de caricatures, de mèmes, d'objets, de gestes et de symboles, et peuvent avoir lieu aussi bien en ligne que hors ligne (Nations Unies, Comprendre les discours haineux, 2023).
Exemples de cyberhaine
Il importe de souligner que les discours haineux ne peuvent viser que des personnes ou des groupes de personnes; ce ne sont pas des discours contre une religion, des idées, des philosophies, des partis politiques ou des États ou nations et leurs bureaux, symboles et fonctionnaires associés.
La cyberhaine prend de nombreuses formes et peut trouver son origine dans le racisme, la misogynie, l’homophobie, la transphobie, l’antisémitisme, l’islamophobie et la suprématie blanche, seuls ou en combinés.
Le Bureau du commissaire aux droits de la personne de la Colombie-Britannique (disponsible en anglais seulement) fournit quelques exemples de ce que comprennent généralement les discours haineux:
- Décrire les membres du groupe comme des animaux, des sous-humains ou génétiquement inférieurs;
- Suggérer que les membres du groupe sont à l'origine d'un complot visant à prendre le contrôle en complotant pour détruire la civilisation occidentale;
- Nier, minimiser ou célébrer les persécutions ou les tragédies passées dont ont été victimes les membres du groupe;
- Qualifier les membres du groupe d'agresseurs d'enfants, de pédophiles ou de criminels qui s'en prennent aux enfants;
- Accuser les membres du groupe d'être responsables de problèmes tels que la criminalité et les maladies; et
- Traiter les membres du groupe de menteurs, de tricheurs, de criminels ou utiliser tout autre terme visant à provoquer une réaction violente.
La cyberhaine et le Code criminel
Les discours haineux/la cyberhaine sont traités par le Code criminel de la manière suivante :
- Encouragement du génocide – paragraphe 318
- Incitation publique à la haine – paragraphe 319(1)
- Promotion délibérée de la haine par – paragraphe 319(2)
- Promotion délibérée de l'antisémitisme – paragraphe 319(2.1)
Les discours haineux sont également interdits par les codes provinciaux/territoriaux des droits de la personne (souvent par le biais de l'interdiction des « discours discriminatoires »); les plaignants individuels sont tenus de déposer plainte auprès du tribunal des droits de la personne de leur province/territoire d'origine.
Cyberhaine : tendances au fil du temps
Le nombre total de crimes haineux signalés à la police et également classés comme cyberhaine a plus que doublé entre 2018 et 2022, passant de 92 incidents signalés en 2018 à 219 incidents en 2022 (Wang et Moreau, 2022). Comme pour les crimes haineux en général, il est important de reconnaître que ces chiffres sous-estiment le nombre réel de cas de cyberhaine, car la plupart des incidents ne sont jamais signalés. De plus, certains services de police canadiens n'ont pas été en mesure de fournir des données sur la cyberhaine entre 2016 et 2022, ce qui aggrave le problème de sous-déclaration.
Entre 2018 et 2022, une grande majorité des crimes de cyberhaine signalés à la police (82 %) étaient violents (18 % étaient non violents). Les comportements de harcèlement et de menace (tels que les menaces verbales, le harcèlement criminel et les communications indécentes ou harcelantes à l'encontre de membres d'un groupe identifiable) représentaient la grande majorité (97 %) de ces incidents violents. Parmi les crimes de cyberhaine non violents, l'incitation publique à la haine (encourager et/ou mobiliser un groupe de personnes sur un forum en ligne à commettre des actes de violence) représentait un peu plus de la moitié (52 %) des incidents.
Victimisation liée à la cyberhaine
Selon Wang et Moreau (2022), les groupes les plus susceptibles d’être ciblés en ligne sont les mêmes que ceux qui sont ciblés en personne; une part disproportionnée des actes de haine en ligne signalés à la police vise les membres des communautés suivantes :
- les musulmans (16 % des victimes signalées entre 2016 et 2020);
- les Noirs (15 % des victimes signalées entre 2016 et 2020);
- les juifs (13 % des victimes signalées entre 2016 et 2020);
- 2ELGBTQI+ (13 % des victimes signalées entre 2016 et 2020); et
- Jeunes: la victimisation liée à la cyberhaine est particulièrement élevée chez les adolescents et les jeunes adultes au début de la vingtaine, en grande partie en raison du temps qu'ils consacrent à leurs études, à leur travail et à leurs loisirs en ligne (jeux, forums de discussion, etc.) (Vogels, Gelles-Watnick et Massarat, 2022).
Entre 2018 et 2022, les hommes et les garçons (53 %) étaient plus susceptibles que les filles et les femmes (47 %) d'être victimes de cyberhaine signalée à la police. La seule exception notable à cette tendance concernait les jeunes femmes âgées de 12 à 24 ans, en particulier celles issues de minorités raciales, religieuses et/ou de la communauté 2ELGBTQI+ Plus précisément, la plus grande proportion de victimes de cyberhaine signalées à la police au cours de cette période était constituée de filles âgées de 12 à 17 ans (représentant 23 % des victimes) et de jeunes femmes âgées de 25 à 34 ans (qui représentaient la deuxième proportion la plus élevée, soit 18 %, des victimes de cyberhaine signalées à la police). Les jeunes femmes âgées de 18 à 24 ans étaient également les plus exposées aux formes les plus graves de cyberhaine, en particulier les types de harcèlement et d'abus sexuels particulièrement graves (Fondation canadienne des femmes, 2023).
Après 2020, on a également constaté une augmentation significative des crimes haineux – tant en ligne que hors ligne – à l'encontre de la population asiatique, en raison d’un discours les rendant responsables de la pandémie de COVID-19 et des restrictions qui en découlent. Par exemple, les crimes haineux signalés à la police visant les communautés asiatiques ont doublé à deux reprises entre 2019 et 2021, et le Conseil national des Canadiens d'origine chinoise a signalé plus de 900 incidents en 2021, soit une augmentation de 47 % par rapport à l'année précédente (Balintec, 2022).
En 2020, la Commission canadienne des droits de la personne a publié un article convaincant intitulé « Le racisme anti-asiatique : une tendance inquiétante », qui documente l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la communauté asiatique.
Il peut être problématique de se fier aux données officielles sur les victimes de cyberhaine signalées à la police, car la plupart des cas de cyberhaine ne sont pas portés à l'attention de la police et ne sont donc pas pris en compte dans les statistiques officielles. Les résultats de recherches qui utilisent d'autres moyens pour documenter les cas de cyberhaine peuvent donc être utiles pour combler l'écart entre les cas signalés et non signalés.
Des recherches canadiennes récentes suggèrent que cet écart est important. Par exemple:
- Une étude menée en 2023 par le Leadership Lab de l'Université métropolitaine de Toronto a interrogé 2 000 Canadiens (âgés de 16 ans et plus) sur leurs expériences personnelles en matière de cyberhaine. Quarante pour cent des personnes interrogées ont déclaré être exposées à la cyberhaine chaque mois ou chaque semaine, 5 % supplémentaires ont déclaré y être exposées quotidiennement et 8 % des personnes interrogées ont déclaré avoir été la cible de haine en ligne qui les a amenées à craindre pour leur sécurité (Andrey, 2023).
- Une enquête nationale sur les discours haineux en ligne signalés par des femmes et des personnes de divers genres âgées de 16 à 30 ans a révélé que 44 % des personnes interrogées ont déclaré avoir été personnellement victimes de discours haineux en ligne. Les groupes les plus susceptibles d'être ciblés en ligne étaient les personnes avec une déficience mentale ou physique, qui sont 70 % plus susceptibles d'être victimes de haine en ligne, les Autochtones (59 %), les personnes 2ELGBTQI+ (également 59 %) et les personnes noires (53 %) (Fondation canadienne des femmes, 2023).
Cyberhaine : considérations pour la police
- Les répercussions de la cyberhaine comme celles des crimes haineux en général, sont ressenties par les victimes individuelles et leurs communautés au sens large (pour plus d'informations, voir Les répercussions de la haine sur les victimes, les communautés et la société), mais aussi par la société en général. Comprendre les répercussions générales de la haine peut aider la police et les organismes partenaires d'aide aux victimes à répondre à leurs besoins diversifiés et souvent complexes.
- La cyberhaine peut être une forme de communication en ligne initiée par des groupes haineux/extrémistes organisés dans le but de recruter des sympathisants, de communiquer, de mobiliser et de coordonner des actions collectives (par exemple, en encourageant le rejet, la haine et la violence à l'égard de certaines personnes et de certains groupes). Il est toutefois important de reconnaître que les auteurs individuels qui ne sont pas affiliés de manière e à des groupes haineux organisés semblent être les plus susceptibles de commettre des actes de cyberhaine (Thorsten et Festl, 2017). Pour plus d'informations, voir Groupes haineux au Canada.
- La cyberhaine augmente souvent, parfois de manière spectaculaire, à la suite d'événements « déclencheurs » hors ligne d'importance locale, nationale et/ou mondiale, tels que des manifestations et des émeutes, en plus des crimes violents très médiatisés, des attentats terroristes (et anniversaires de ces attentats) et les procès (Williams et Burnap, 2016). Ainsi, la cyberhaine refléterait un désir de vengeance à l'encontre de membres innocents du groupe plus large considéré comme responsable ou associé à l'événement déclencheur (King et Sutton, 2023). Il semble que la période de risque extrêmement élevé de cyberhaine à la suite d'un événement déclencheur soit de 24 à 48 heures, ce qui signifie qu'il y a une « augmentation forte et mesurable » des crimes et incidents de cyberhaine 24 à 48 heures après la survenue de l'événement déclencheur (48 à 72 heures est la période de risque extrêmement élevé de hausses de crimes haineux hors ligne à la suite d'un événement déclencheur) (Sadique, Tangen et Perowne, 2018).
En 2024, les médias ont rapporté une histoire concernant des nouveaux arrivants sud-asiatiques au Canada qui étaient de plus en plus souvent ciblé en ligne sur les réseaux sociaux. L'impact de la cyberhaine sur leur vie a été documenté dans cet article (disponsible en anglais seulement).
Réagir à la cyberhaine
Les crimes haineux commis sur Internet posent des défis à la police. Williams et al. (2020) ont mis en évidence certains de ces défis, notamment
- le volume des communications en ligne;
- le manque de capacités pour surveiller et répondre à la cyberhaine (en termes de ressources, de compétences technologiques, etc.);
- la nature interjuridictionnelle du cyberespace, qui peut créer des problèmes de compétence pénale et compliquer les efforts visant à identifier les victimes et les auteurs;
- la facilité, la rapidité et l’anonymat avec lesquels le contenu peut être diffusé.
Ces défis, parmi d'autres, font que les réponses officielles actuelles à la cyberhaine sont généralement de nature réactive et reposent sur le signalement par les utilisateurs de contenus offensants et haineux aux plateformes médiatiques et/ou aux services de police compétents pour examen et éventuelle réparation (c'est-à-dire suppression du contenu offensant, dépôt de plaintes pénales, etc.).
Les policiers qui reçoivent des signalements de cyberhaine doivent reconnaître l'applicabilité des articles existants du Code criminel aux actes criminels motivés par la haine perpétrés sur l’internet.
En 2023, le projet Online Hate Research and Education Project, en collaboration avec le Centre d'éducation sur l'Holocauste, a publié un guide en ligne intitulé Hatepedia: Guide to Online Hate (disponsible en anglais seulement) (Hatepedia : guide sur la haine (disponsible en anglais seulement) en ligne) afin d'aider la police et le public à identifier les symboles, les termes, les personnages et les thèmes qui apparaissent souvent dans l'expression de la haine, en ligne et hors ligne.
Y a-t-il un lien entre les crimes haineux et l’extrémisme violent?
Informations générales
Le concept d'extrémisme violent fait référence aux croyances et aux actions des personnes qui soutiennent ou recourent à la violence pour atteindre des objectifs idéologiques, religieux ou politiques extrêmes (Centre canadien pour l'engagement communautaire et la prévention de la violence, 2018). En d'autres termes, l'extrémisme violent est un terme large et inclusif qui décrit un éventail d'idéologies et de systèmes de croyances; la violence extrémiste n'est pas spécifique à un groupe, un milieu, une religion ou une culture en particulier. En effet, les recherches démontrent systématiquement que les auteurs de tels actes de violence proviennent de divers milieux socio-économiques, religieux et raciaux/ethniques (Horgan, 2008).
Le gouvernement canadien et les organismes de sécurité ont adopté une typologie, ou un système de classification, dérivée des définitions de l'extrémisme violent figurant dans le Code criminel canadien (article 83.01) et dans la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (article 2c), qui comprend trois catégories principales d'extrémisme violent : motivé par des raisons idéologiques, motivé par des raisons politiques et motivé par des raisons religieuses. Il est important de noter que ces catégories ne s'excluent pas mutuellement, étant donné que les idéologies et les systèmes de croyances extrémistes découlent souvent des griefs personnels d'un individu donné et sont adaptés à ceux-ci. Le rapport public du Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) de 2024 a présenté les définitions suivantes :
- L’extrémisme violent à caractère idéologique (EVCI)
- Motivé par une combinaison d'idées et de griefs, plutôt que par un système de croyances unique, il comprend la violence fondée sur le genre (y compris la violence INCEL et anti-2ELGBTQI+), la violence xénophobe (y compris la violence anti-immigrés, raciste et ethno-nationaliste), la violence anti-autoritaire (y compris la violence anti-gouvernementale, la violence contre les forces de l'ordre et la violence anarchiste) et d'autres formes de violence motivées par des griefs (y compris la violence commise par des individus sans lien avec un groupe organisé ou une organisation externe).
- L’extrémisme violent à caractère politique (EVCP)
- Encourage le recours à la violence pour établir de nouveaux systèmes politiques ou instaurer de nouvelles structures ou normes au sein des système existants.
- L’extrémisme violent à caractère religieux (EVCR)
- Encourage le recours à la violence dans le cadre d’un conflit spirituel ou d’une lutte contre un système perçu comme immoral.
À quoi ressemble actuellement le paysage de la menace extrémiste au Canada?
Dans ses recherches, Sara Thompson, de l'Université métropolitaine de Toronto, a constaté que l'extrémisme violent au Canada est plus courant qu'on ne le pense généralement. Ses recherches montrent que le Canada a été confronté à plus de 1 846 incidents de violence de ce type entre 1960 et 2015, tant sur son territoire qu'à l'étranger. Les organisations et les idéologies qui ont façonné la violence extrémiste au Canada ont évolué au fil du temps et selon les régions. Dans les années 1960 et au début des années 1970, on a assisté à une hausse des activités extrémistes en Colombie-Britannique et au Québec, perpétrées par des groupes extrémistes canadiens motivés par des considérations religieuses et politiques, tels que les Sons of Freedom en Colombie-Britannique et le Front de libération du Québec (FLQ) au Québec. Cette recrudescence a été suivie d'un déclin des incidents associés à ces groupes au milieu des années 1970.
Dans les années 1980, on a assisté à une hausse des incidents liés à diverses factions de l'extrémisme international (à savoir le Front de libération de la Terre et des « écoterroristes » non identifiés) qui utilisaient le Canada comme base pour régler des griefs étrangers. Dans les années 2000, on a constaté une nouvelle augmentation des menaces et des incidents liés à l'extrémisme environnemental qui visaient l'industrie pétrolière et gazière, principalement dans le centre et l'ouest du Canada.
Depuis le début des années 2000, le paysage sécuritaire au Canada a changé (et est devenu plus complexe) avec la croissance des activités terroristes/extrémistes liées à des groupes transnationaux tels qu'Al-Qaida, al Shabaab et Daech. Cette période a également été marquée par une augmentation des formes d'activités extrémistes motivées par l'idéologie, une catégorie qui englobe l'extrémisme racial et suprémaciste blanc, la violence antigouvernementale, anti-forces de l'ordre et anarchiste, la misogynie violente et l'extrémisme anti-2ELGBTQI+L'extrémisme motivé par l'idéologie se manifeste de diverses façons et semble, ces dernières années, être alimenté par un mélange d'opinions – appelé extrémisme violent composite, extrémisme « salad bar » ou extrémisme mixte, instable ou ambigu (MUU) – plutôt que par une idéologie cohérente. Il reste l'une des menaces les plus complexes et les plus importantes pour la sécurité nationale au Canada aujourd'hui. La pandémie de COVID-19, associée à une rhétorique politique populiste de plus en plus incendiaire alimentée par la désinformation et la mésinformation, a intensifié l'idéologie haineuse et extrémiste et exacerbé la violence qui y est associée ici au Canada, comme dans d'autres pays.
Les menaces persistantes pour la sécurité nationale au Canada concernent également les voyageurs extrémistes – communément appelés « combattants étrangers » – qui ont quitté le Canada pour prendre les armes dans des zones de conflit à l'étranger; certains ont survécu et sont rentrés chez eux, souvent accompagnés de jeunes familles. L'évaluation des risques pour cette population est extrêmement difficile, mais essentielle compte tenu des ressources limitées disponibles pour la gérer. Les préoccupations concernant les adversaires étrangers sont également importantes, tout comme la menace de violences causant des pertes massives perpétrées par des auteurs isolés ou des groupes motivés par diverses croyances idéologiques et/ou des griefs personnels.
Plus que jamais, le paysage des menaces au Canada est hétérogène et complexe, composé de groupes établis et organisés, de cellules, de « loups solitaires » et d'entités désorganisées et vaguement affiliées qui adhèrent à un éventail de systèmes de croyances diffusés et renforcés dans le cadre de relations et de contextes en face à face et en ligne (Thompson, 2023).
Y a-t-il un lien entre les crimes haineux et l’extrémisme violent?
Cela peut être le cas, mais ce n'est souvent pas le cas. La recherche démontre que les crimes haineux et l'extrémisme violent partagent certaines similitudes importantes et devraient donc être considérés comme des « cousins proches » (Mills, Freilich et Chermak, 2015). En effet, dans chaque cas, la cible de l'infraction est choisie en raison de son identité collective, et non en raison de son comportement individuel, et parce que les crimes haineux et l'extrémisme violent visent spécifiquement à semer la peur parmi un plus grand nombre de personnes que celles directement touchées.
Il peut exister un lien temporel (une succession d'événements dans le temps) entre la haine et la violence extrémiste, c'est-à-dire que l'une peut déclencher l'autre. Plus précisément, certaines recherches ont démontré que l'extrémisme violent peut parfois être un précurseur des crimes haineux, tandis que d'autres recherches ont montré l'inverse, à savoir que les crimes haineux peuvent parfois être un précurseur de la violence extrémiste.
La recherche a démontré que certains crimes haineux sont perpétrés en réponse à des actes de violence extrémiste, servant ainsi de forme de représailles indirectes contre des membres innocents du groupe considéré comme responsable de l'acte extrémiste. L'augmentation marquée des crimes haineux visant les musulmans à la suite des attentats du 11 septembre 2001 illustre bien cette relation (Mills, Freilich et Chermak, 2015). Le risque de victimisation par des crimes haineux par procuration augmente – souvent de manière significative – au cours des quatre premières semaines suivant une attaque extrémiste, même si la première semaine semble généralement être la période où le risque de victimisation par des crimes haineux est le plus élevé.
Il semble également que les crimes haineux puissent servir d'indicateur de la violence extrémiste future. Bien que les preuves à cet égard soient limitées, certaines recherches récentes suggèrent que les expressions de haine (qui se manifestent sous forme de crimes et d'incidents haineux) peuvent être le signe d'une escalade, passant d'incidents mineurs et/ou non criminels à des formes plus violentes (et donc criminelles) d'extrémisme violent. Cette escalade repose sur le concept de radicalisation vers la violence, un processus par lequel un individu ou un groupe en vient à croire que la violence est un moyen légitime, voire préférable, pour faire avancer un système de croyances particulier ou une cause idéologique. Par exemple, la recherche démontre que les Incels (célibataires involontaires) se livrent à la cyberhaine (c'est-à-dire à des propos misogynes et suprémacistes blancs sur les forums numériques), mais à mesure que leurs opinions deviennent plus extrêmes, leurs actions peuvent également le devenir, comme le démontrent clairement plusieurs attentats meurtriers très médiatisés au Canada et aux États-Unis (Hoffman, Ware et Shapiro, 2020).
Les conclusions des recherches sur le lien qui existe parfois entre les crimes haineux et la violence extrémiste ont des implications évidentes pour les services de police, qui peuvent jouer un rôle important en matière de réassurance, de prévention et de soutien communautaire à la suite de tels incidents.
Prévention des crimes haineux : un complément et un supplément importants aux approches réactives fondées sur l’application de la loi
Contexte
La récente hausse significative des crimes et incidents motivés par la haine a incité les services de police partout au Canada à faire de la prévention et du contrôle des crimes haineux une priorité opérationnelle. Bien que les approches réactives axées sur l'application de la loi constituent un moyen important de tenir les personnes accusées responsables et d'offrir un accès à la justice et du soutien aux victimes qui cherchent à obtenir réparation, une réponse policière globale aux crimes haineux doit également mettre l'accent sur la prévention.
Travailler de manière proactive à la prévention des crimes haineux peut contribuer à isoler la vague de crimes et d'incidents haineux et les dommages immenses qu'ils causent aux victimes, à leurs communautés et à la société en général. Mettre l'accent sur la prévention des crimes haineux, tout en fournissant une réponse forte, solidaire et immédiate, envoie également le message que les services de police compétents s'engagent à concevoir, développer et mettre en œuvre des stratégies solides et multidimensionnelles pour lutter contre la haine.
Outre la prévention, la réduction et la lutte contre les crimes et incidents motivés par la haine, les avantages d'une double approche axée sur l'application de la loi et la prévention peuvent également inclure un sentiment accru de sécurité dans les communautés touchées, ainsi qu'un niveau plus élevé de satisfaction et de confiance envers les services de police compétents. La recherche démontre que ces avantages sont également généralement associés à une augmentation de la légitimité perçue de la police, ce qui renforce la probabilité que les membres de la communauté signalent les crimes haineux dont ils sont victimes et les infractions à la police et coopèrent autrement avec le processus de justice pénale (Bradford, Jackson et Stanko, 2009; Lee et al., 2019).
Ce bref résumé de recherche donne un aperçu des termes clés et des activités associés au travail de prévention des crimes haineux, ainsi que des recommandations spécifiques et fondées sur des preuves que les agents de première ligne peuvent appliquer pour améliorer la qualité de leurs interactions avec les civils, contribuant ainsi à renforcer les relations et la confiance au sein de la communauté.
Terminologie clé
La police communautaire est une philosophie qui fait la promotion de stratégies organisationnelles favorisant le recours à des partenariats et à des techniques collaboratives de résolution de problèmes afin d'aborder de manière proactive les questions de sécurité communautaire. Selon Dario et Crichlow (2022), la police communautaire comporte trois éléments principaux :
- des partenariats actifs entre la police et la communauté afin d’identifier les problèmes locaux;
- l’adaptation de la gestion organisationnelle, de la structure et des systèmes d’information afin de mieux soutenir la communauté; et
- une approche proactive et collaborative pour traiter les problèmes locaux.
Le concept de légitimité de la police fait référence à la conviction que la police est l'autorité appropriée pour maintenir l'ordre social, gérer les conflits et résoudre les problèmes au sein de la communauté. Selon Jackson et al (2012), la légitimité de la police est souvent mesurée en termes de :
- La confiance du public dans la police.
- La volonté de se soumettre à la loi et à l’autorité policière.
- La conviction que les actions de la police sont justifiées et adaptées aux circonstances.
La perception de la légitimité de la police est importante, car elle détermine dans quelle mesure un individu respecte la loi et est disposé à aider la police lorsque cela est nécessaire pour lutter contre la criminalité dans la communauté, que le résultat soit favorable ou non à son cas (Tyler, 2011).
Mettre l'accent sur la justice procédurale dans le maintien de l'ordre est un moyen important d'améliorer les relations avec la communauté et d'accroître le niveau de légitimité perçue de la police (Tyler et Fagan, 2008). La recherche démontre que lorsque les gens perçoivent leurs interactions avec les agents comme étant équitables sur le plan procédural, c'est-à-dire qu'ils estiment avoir été traités avec dignité et respect, ils sont beaucoup plus enclins à considérer la police comme légitime et, par extension, à respecter la loi et à coopérer avec la police pour aider à lutter contre la criminalité dans la communauté. Vous trouverez ci-dessous des informations spécifiques sur la manière de garantir des interactions équitables sur le plan procédural avec les civils.
Prévention des crimes haineux : en quoi consiste-t-elle et pourquoi est-elle importante?
La plupart des activités de prévention des crimes haineux reposent sur un cadre de police communautaire, qui implique lui-même un engagement communautaire profond et soutenu afin d'atteindre les objectifs suivants :
- Établir des relations et renforcer la confiance entre la police et les communautés qu’elle sert, en mettant particulièrement l’accent sur les communautés les plus vulnérables aux crimes haineux;
- Promouvoir la connaissance et la préparation de la communauté en matière de crimes haineux;
- Augmenter le nombre de signalements par les victimes et les communautés;
- Dissuader les auteurs potentiels d’infractions; et
- Améliorer la réponse globale de la police aux crimes haineux.
Plus précisément, le lien qui unit ces activités est l’accent mis sur la prévention des crimes et incidents motivés par la haine, afin d’empêcher qu’ils ne se produisent ou ne se reproduisent, en :
- Établir des relations afin de développer une structure et un réseau auxquels il est possible de faire appel lorsque des tensions apparaissent, qu'une enquête est menée ou qu'un incident grave se produit. Des études montrent que le renforcement des relations entre la police et la communauté peut :
- augmenter la probabilité que les victimes signalent des crimes et incidents haineux à la police, et que les auteurs soient ensuite identifiés et tenus responsables;
- encourager la communauté à coopérer davantage avec la police, notamment en partageant des informations sur l'identité des auteurs et/ou en signalant de manière proactive à la police les personnes suspectes au sein de la communauté. À ce titre, il est essentiel de cultiver des relations et une confiance qui faciliteront le signalement afin d'empêcher que des crimes et incidents motivés par la haine ne se produisent ou ne se reproduisent dans la communauté.
- Travailler de manière proactive avec les membres et les groupes de la communauté afin de :
- sensibiliser la communauté aux crimes haineux en organisant des campagnes de sensibilisation du public qui informent les membres de la communauté sur la distinction entre les crimes et les incidents haineux, les protections juridiques contre les crimes haineux, ainsi que les formes d'aide et d'action disponibles;
- améliorer la préparation générale à la prévention de la victimisation ou de la revictimisation en menant des audits de sécurité et en renforçant les mesures de sécurité pour les personnes et les biens particulièrement exposés au risque d'être victimes de haine.
- Dissuader les auteurs potentiels d’infractions :
- La mise en œuvre d’approches solides et globales en matière de lutte contre les crimes haineux peut également avoir un effet dissuasif essentiel dans la mesure où ces approches dénoncent publiquement les crimes et incidents haineux et font savoir aux auteurs potentiels que tout acte de ce type fera l'objet d'une enquête rigoureuse.
Justice procédurale dans le domaine policier : un modèle pour renforcer les relations et la confiance entre la police et la communauté
Si les mesures répressives et préventives constituent des éléments importants d'une réponse policière complète aux crimes et incidents motivés par la haine, leur simple présence ne suffit pas à elle seule à améliorer les relations et à instaurer la confiance. La recherche suggère que la qualité des interactions entre les policiers et les membres de la communauté joue un rôle essentiel; des interactions positives avec le public et des décisions équitables peuvent améliorer la perception que le public a de la police, contribuer à renverser le déficit de confiance et renforcer la légitimité de la police (Tyler, Goff et MacCoun, 2015).
Le concept de justice procédurale (ou équité procédurale) est expliqué plus en détail sur le site web His Majesty’s (HM) Inspectorate of Probation’s (disponsible en anglais seulement) au Royaume-Uni, où un cadre utile est présenté pour aider les agents à établir des interactions positives entre la police et les civils, y compris certains des avantages documentés. La justice procédurale dans le domaine policier consiste à appliquer les quatre principes de la justice procédurale dans tous les contacts courants avec le public. Ces principes sont les suivants :
- 1. Voix
- Les gens doivent avoir la possibilité de donner leur version des faits et sentir que les autorités les écoutent et les prennent sincèrement en considération avant de prendre une décision.
- 2. Neutralité
- Les gens doivent percevoir les autorités comme des décideurs neutres et intègres, qui appliquent les règles de manière cohérente et transparente et ne fondent pas leurs décisions sur des opinions personnelles ou des préjugés.
- 3. Respect
- Les gens ont besoin de se sentir respectés et traités avec courtoisie par les autorités, de croire que leurs droits sont considérés comme égaux à ceux des autres et que leurs problèmes seront prises au sérieux.
- 4. Motifs dignes de confiance
- Les gens ont besoin de voir les figures d'autorité comme des personnes aux motivations dignes de confiance, sincères et authentiques, qui écoutent et se soucient d'eux, et qui essaient de faire ce qui est juste pour toutes les personnes concernées.
Rassurer la population grâce au maintien de l’ordre
Un deuxième mécanisme qui, selon la recherche, peut accroître la satisfaction des victimes qui ont affaire à la police est la politique de « rappel » (c'est-à-dire la « police de réassurance »), qui consiste à communiquer de manière proactive avec les victimes après leur premier contact – par téléphone ou en personne (ce dernier étant généralement réservé aux victimes de crimes violents graves) – quel que soit l'état d'avancement de leur dossier (Fielding et Innes, 2006). L'objectif principal du rappel est de prendre des nouvelles des victimes et de leur offrir l'accès à une multitude de ressources et de soutiens afin de faciliter le processus de guérison; cela montre aux victimes que la police de la juridiction concernée s'engage à leur apporter une solidarité et un soutien qui vont au-delà du signalement initial. Les recherches suggèrent que les rappels rassurent effectivement les victimes et peuvent améliorer leur niveau de satisfaction à l'égard de la police, ce qui est un facteur important pour accroître la légitimité perçue de la police. Certaines recherches suggèrent également que ces effets peuvent être particulièrement prononcés pour les victimes issues de groupes minoritaires racialisés et religieux (Mckee, Ariel et Harinam, 2023).
La notion de maintien de l'ordre rassurant a été élargie dans le contexte des crimes haineux afin d'inclure la sécurité et le soutien aux communautés touchées à la suite de crimes haineux perpétrés localement, ailleurs au Canada ou dans d'autres pays. Par exemple, en 2017, une attaque perpétrée par un suprémaciste blanc pendant la prière du soir au Centre culturel islamique de Québec a entraîné la mort de six fidèles et blessé gravement cinq autres personnes. Cette attaque a suscité une peur immense au sein des communautés musulmanes, qui craignaient que cet incident n'inspire d'autres actes de violence similaires dans des mosquées d'autres régions. En réponse, les services de police compétents au Canada et à l'étranger ont déployé différentes mesures de maintien de l'ordre rassurant, consistant le plus souvent en une présence policière importante et visible dans les mosquées locales et en des patrouilles à proximité de celles-ci. Cette réponse visait à reconnaître la gravité de ce qui s'était passé au Centre culturel islamique, à prendre conscience du risque potentiel plus large pesant sur les lieux et les événements islamiques, à manifester sa solidarité avec les communautés musulmanes et à apaiser la peur intense qui régnait au sein de la communauté. Ces mesures policières de réassurance très visibles visent également à dissuader les auteurs potentiels de commettre des crimes et des incidents motivés par la haine, en augmentant le risque perçu d'être détecté et arrêté.
Le renforcement des capacités en matière de prévention des crimes haineux nécessite des adaptations organisationnelles et des stratégies qui favorisent le recours systématique à l'engagement communautaire, aux partenariats et aux approches proactives pour identifier et traiter les problèmes de sécurité communautaire. Si de nombreux services de police ont intégré des stratégies de police communautaire et d'engagement communautaire dans leurs plans opérationnels généraux, des recherches internationales montrent que le niveau d'engagement organisationnel dans ce domaine est inégal: certains services s'engagent de manière approfondie et durable dans la police communautaire et l'engagement communautaire parallèlement à des activités axées sur l'application de la loi, tandis que d'autres font preuve d'un engagement moindre en faveur d'un engagement proactif et de l'établissement de relations au sein de la communauté (Kappeler, Gaines et Schaefer, 2020).
Dans tous les cas, chaque agent peut contribuer à élargir les efforts de prévention et d'engagement en appliquant les principes de justice procédurale à toutes les interactions avec les citoyens et en rassurant, après un incident, les victimes de haine et leurs communautés au sens large. La recherche démontre que le respect constant des principes de justice procédurale et de maintien de l'ordre rassurant peut jouer un rôle clé dans le renforcement de la légitimité perçue de la police et, par extension, de la coopération des citoyens, ce qui peut contribuer à prévenir, réduire et/ou répondre à toute une série de problèmes de sécurité communautaire, y compris (mais sans s'y limiter) les crimes et incidents motivés par la haine (Pryce et Whitaker, 2023).
Références
- Amarasingam, A. et Scrivens, R., (2017). Acknowledging that Canada’s hate Groups Exist (disponsible en anglais seulement), Policy Options Politiques.
- Andrey, Sam (2023). Survey of Online Harms in Canada (disponsible en anglais seulement).
- Armstrong, A., (2017). Les crimes haineux déclarés par la police au Canada, 2017. Juristat.
- Aziz, N. et Carvin, S., (2022). Hate in Canada: A Short Guide to Far Right Extremism Movements (disponsible en anglais seulement), Organisation pour la prévention de la violence.
- Balgord, Evab et Smith, Peter, (2021). How Many Hate Groups are There in Canada? (disponsible en anglais seulement), Antihate.ca.
- Balintec, Vanessa, (2022). 2 years into the pandemic, anti-Asian hate is still on the rise in Canada, report shows (disponsible en anglais seulement), CBC News.
- Bradford, B., Jackson, J. et Stanko, E., (2009). Contact et confiance : réexamen de l'impact des rencontres publiques avec la police, Policing and Society 19, no 1, p. 20-46.
- Fondation canadienne des femmes, (2024). The Facts About Gendered Digital Hate, Harassment, and Violence and Girls in Canada (disponsible en anglais seulement).
- CBC Radio Canada, (2017). Canadians appear to be more hateful online: Here’s what you can do about it (disponsible en anglais seulement), CBC News.
- Center for Health Care Strategies, (2021). What is Trauma? (disponsible en anglais seulement), Soins tenant compte des traumatismes : Centre de ressources pour la mise en œuvre.
- Crenshaw, K., (1991). Cartographier les marges : intersectionnalité, politique identitaire et violence contre les femmes de couleur, Stanford Law Review 43, no 6, p. 1241-1299.
- Dario, L. et Crichlow, V.J., (2022). Dimensions émergentes de la police communautaire, Crime & Delinquency 68, no 3 p. 409–438.
- Fielding, N. et Innes, M., (2006). Policing rassurant, police communautaire et mesure des performances policières, Policing and Society 16, no 2, p. 127-145.
- Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, (2021). Encouraging hate crime reporting - The role of law enforcement and other authorities (disponsible en anglais seulement), Union européenne pour les droits fondamentaux.
- German, M. et Navarro, M., (2023). Why White Supremacist Groups Attract Latinos to Their Ranks (disponsible en anglais seulement), Brennan Center for Justice.
- Goodman, D., Tax, B. et Mahamed, Z., (2022). UNHCR’s journey towards a victim-centred approach (disponsible en anglais seulement), Humanitarian Practice Network, no 8.
- Gouvernement du Canada, (2025). Rapport public du SCRS 2024
- Gouvernement du Canada, (2016). Droits des victimes au Canada.
- Greinacher, A., Derezza-Greeven, C., Herzog, W. et Nikendei, C., (2019). Traumatisme secondaire chez les premiers intervenants : une revue systématique, European Journal of Psychotraumatology, 10.
- Hoffman, B., Ware, J. et Shapiro, E., (2020). Évaluation de la menace de violence des incels, Studies in Conflict & Terrorism, 43, no 7, p. 565-587.
- Hodge, E., & Hallgrimsdottir, H. (2019). Networks of Hate: The Alt-right, “Troll Culture”, and the Cultural Geography of Social Movement Spaces Online (disponsible en anglais seulement). Journal of Borderlands Studies, 35(4), 563–580.
- Horgan, J. H. (2008). From profiles to pathwaysand roots to routes: Perspectives from psychology on radicalization into terrorism. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 618(1), 80–94.
- Iganski, Paul, (2002). Action Agenda for Community Organizations and Law Enforcement to Enhance the Response to Hate Crimes, American Behavioral Scientist, 45, no 4, p. 631-32.
- Association internationale des chefs de police, Comité des avocats pour les droits civils sous la loi (2019). Action Agenda for Community Organizations and Law Enforcement to Enhance the Response to Hate Crimes (disponsible en anglais seulement).
- Association internationale des chefs de police, (2018). Enhancing Law Enforcement Response to Victims (ELERV) Strategy (disponsible en anglais seulement).
- Association internationale des chefs de police, (2018). Response to Victims of Crime (PDF, 1 388 Ko)
- Association internationale des chefs de police, (2018). Responding to Hate Crimes: A Police Officer’s Guide to Investigation and Prevention (disponsible en anglais seulement)
- Jackson, Jonathan, et al., (2012). Why Do People Comply with the Law? Legitimacy and the Influence of Legal Institutions, British Journal of Criminology, 52, no 6, p. 1051-1071.
- Jackson, Pamela, Iving, (2022). Hate Crimes Nourish Domestic Terror in the United States and Europe, Democracy and Security, 18, no 4 p. 349-380.
- Janhevich, D. (2001). Les crimes haineux au Canada : un aperçu des questions et des sources de données.
- Jayson, Sharon, (2017). What Makes People Join Hate Groups?, US News and World Report.
- Kappeler, Victor E., Gaines, Larry K. et Schaefer, Brian P., (2020). Police communautaire : une perspective contemporaine.
- King, Ryan D., et Sutton, Gretchen, M., (2013). High Times for Hate Crime: Explaining the Temporal Clustering of Hate Motivated Offending (disponsible en anglais seulement), Criminology, 51, no 4, p. 871-94.
- Lantz, B., (2022). Women who commit hate-motivated violence: Advancing a gendered understanding of hate crime (disponsible en anglais seulement), Social Science Research, 104 : p. 1-12.
- Lantz, B., Wenger, M.R., Mills J.M., (2023). Peur, légitimation politique et racisme : examen de la xénophobie anti-asiatique pendant la pandémie de COVID-19. Race and Justice, 13(1) p. 80–104. doi : 10.1177/21533687221125817.
- Lee, H.D., Cao, L., Kim, D. et Woo, Y., (2019). Contacts avec la police et confiance dans la police dans une ville de taille moyenne, International Journal of Law Crime and Justice, 56, p. 70–78.
- McKee, J., Ariel, B. et Harinam, V., (2023) "Mind the Police Dissatisfaction Gap": The Effect of Callbacks to Victims of Unsolved Crimes in London (disponsible en anglais seulement), Justice Quarterly, 40, no 5, p. 744-763.
- Mellgren, C., Andersson, M., et Ivert, A-K., (2017). For Whom Does Hate Crime Hurt More? A Comparison of Consequences of Victimization Across Motives and Crime Types, Journal of Interpersonal Violence, 36, no 3-4, p. 1512-1536.
- Mills, C.E., Freilich, J.D. et Chermak, S.M., (2015). Haine extrême : réexamen de la relation entre les crimes haineux et le terrorisme afin de déterminer s'ils sont « proches cousins » ou « parents éloignés », Crime and Delinquency, 63, no 10, p. 1191-1293.
- Müller, K. et Schwarz, C., (2021). Attiser les flammes de la haine : les réseaux sociaux et les crimes haineux, Journal of the European Economic Association, 19, no 4, p. 2131-2167.
- Association nationale des travailleurs sociaux, (2007). Normes et indicateurs de compétence culturelle dans la pratique du travail social (disponsible en anglais seulement).
- National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, Violent Hate Crime Offenders (disponsible en anglais seulement), (2020).
- Neidhardt, A-H et Butcher, P., (2022). Disinformation on Migration: How Lies, Half-Truths, and Mischaracterizations Spread, Migration Policy Institute.
- O’Donnell, C., (2020). Canada’s Silent Pandemic: Far-Right Hate Groups, McGill Journal of Political Science.
- Office of Justice Programs: Office for Victims of Crime, (2023) Achieving Excellence: Model Standards for Serving Victims and Survivors of Crime.
- Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme, (2020). Hate Crime Victim Support: Understanding the Needs of Hate Crime Victims (disponsible en anglais seulement), Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, p. 11-13.
- Pickles, J., (2020). La socialité de la haine : la transmission de la victimisation parmi les personnes LGBT+ à travers les réseaux sociaux, Revue internationale de victimologie 27, no 3, p. 313.
- Perry, B., (2021) The extreme right in Canada: what it is, and what to do about it? , Commission canadienne pour l'UNESCO.
- Perry, B. et Scrivens, R., (2018). Un climat propice à la haine? Une exploration du paysage extrémiste de droite au Canada, Critical Criminology, 26, no 2, p. 169-187.
- Perry, B., (2009). La sociologie de la haine : approches théoriques, dans Levin, B. (éd.) Crimes haineux, volume I : comprendre et définir les crimes haineux, p. 55-76.
- Pryce, D.K. et Whitaker, I.P., (2022). Le rôle de la justice procédurale dans le maintien de l'ordre : une évaluation qualitative des perceptions et des expériences des Afro-Américains dans une grande ville américaine, Du Bois Review : Social Science Research on Race, 20, no 1 p. 89-109, doi:10.1017/S1742058X22000066.
- Sécurité publique Canada, (2018). Stratégie nationale de lutte contre la radicalisation menant à la violence (PDF, 426 ko), Centre canadien pour l'engagement communautaire et la prévention de la violence.
- Direction générale de la migration et des affaires intérieures, (2022). The ‘how’ and ‘why’ of hate crime and the implications for mental health practitioners (disponsible en anglais seulement), RAN Health.
- Sadique, K., Tangen, J. et Perowne, A., (2018). The Importance of Narrative in Responding to Hate Incidents Following ‘Trigger’ Events (disponsible en anglais seulement), Tell MAMA UK.
- Schweppe, J. et Perry, B., (2021). Un continuum de haine : délimiter le champ des études sur la haine, Crime, Law, and Social Change, 77, no 5, p. 503-528.
- Southern Law Poverty Group, (2025). Frequently asked questions about hate and antigovernment groups.
- Thorsten, Q. & Festl, R., (2017). Cyberhate, The International Encyclopedia of Media Effects.
- Thompson, Sara K., Ismail, Feras et Couto, Joe L., (2020). Hate/Bias Crime: A Review of Policies, Practices, and Challenges (disponsible en anglais seulement, PDF, 3,1 Mo), préparé pour l'Association des chefs de police de l'Ontario.
- Thompson, Sara K., (2023). Polarisation, extrémisme violent et réponses axées sur la résilience au Canada, dans McNeil-Willson, R. et Triandafyllidou, A. (Eds.) Handbook on Violent Extremism and Resilience.
- Tétrault, J. (2019). Quel est le rapport avec la haine? Les mouvements d'extrême droite et le stéréotype de la haine. Current Sociology.
- Torchalla, I. et Killoran, J., (2022). Thérapie interdisciplinaire axée sur les traumatismes et aide au retour au travail pour un policier souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique lié au travail : étude de cas, Journal of Contemporary Psychotherapy, 52, no 4, p. 319-327.
- Tyler, Tom R., Goff, Phillip Atiba et MacCoun, Robert J., (2015). L'impact de la science psychologique sur le maintien de l'ordre aux États-Unis : justice procédurale, légitimité et application efficace de la loi, Psychological Science in the Public Interest, 16, no p. 75-109.
- Tyler, Tom R., (2011). Confiance et légitimité : les services de police aux États-Unis et en Europe, European Journal of Criminology, 8, no 4, p. 254-266.
- Nations Unies. Qu'entend-on par « discours de haine ».
- Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, (2019). Manuel sur les dimensions sexospécifiques des réponses pénales au terrorisme, ONU p. 1-202.
- Vogels, E.A., Gelles-Watnick, R. et Massarat, N., (2022). Teens, Social Media and Technology 2022, Pew Research Center.
- Wang, J.H. et Moreau, G., (2022). Les crimes haineux déclarés par la police au Canada, 2020, Juristat.
- Williams, M.L et Burnap, P., (2016). Cyberhate on Social Media in the Aftermath of Woolwich: A Case Study in Computational Criminology and Big Data (disponsible en anglais seulement), The British Journal of Criminology, 56, no 2 p. 211–238.
- Williams, M.L., et al., (2020). Hate in the Machine: Anti-Black and Anti-Muslim Social Media Posts as Predictors of Offline Racially and Religiously Aggravated Crime (disponsible en anglais seulement), The British Journal of Criminology, 60, no 1, p. 93-117.
- Date de modification :